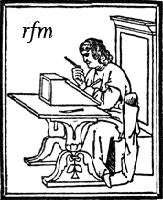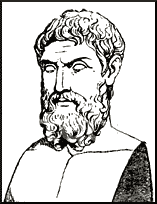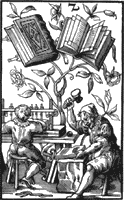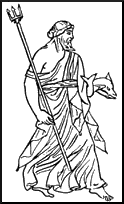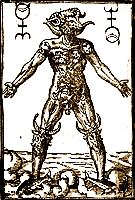Traité des trois imposteurs. Moïse, Jésus-Christ, Mahomet
Traité des trois imposteurs
Chapitre III. — Ce que signifie le mot Religion. Comment et pourquoi il s’en est introduit un si grand nombre dans le monde. Toutes les religions sont l’ouvrage de la politique.
Conduite de Moïse pour établir la religion judaïque.
Examen de la naissance de Jésus-Christ, de sa politique, de sa morale et de sa réputation après sa mort.
Artifices de Mahomet pour établir sa religion. Succès de cet imposteur, plus grand que celui de Jésus-Christ.
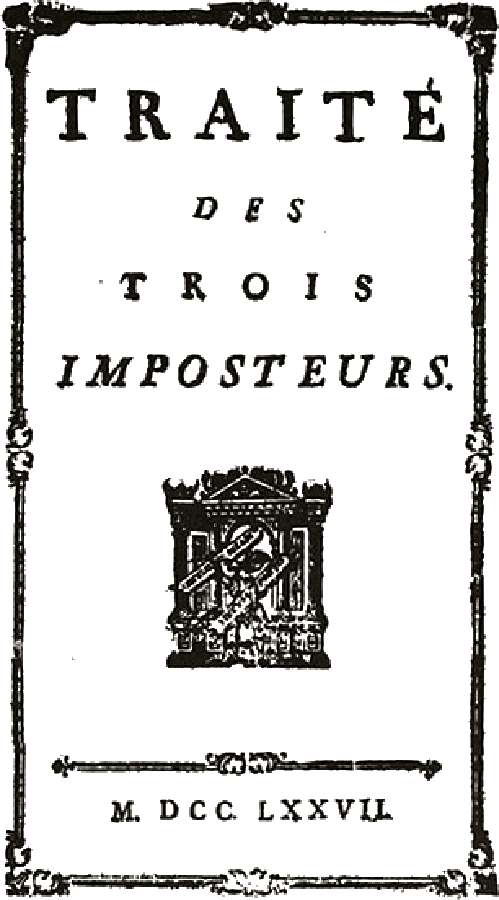
Chapitre I: De Dieu ⮵
Fausses idées que l’on a de la Divinité, parce qu’au lieu de consulter le bon sens et la raison, on a la faiblesse de croire aux opinions, aux imaginations, aux visions des gens intéressés à tromper le peuple et à l’entretenir dans l’ignorance et dans la superstition.
Quoiqu’il importe à tous les hommes de connaître la vérité, il y en a très peu cependant qui jouissent de cet avantage. Les uns sont incapables de la rechercher par eux-mêmes, les autres ne veulent pas s’en donner la peine. Il ne faut donc pas s’étonner si le monde est rempli d’opinions vaines et ridicules; rien n’est plus capable de leur donner cours que l’ignorance; c’est là l’unique source des fausses idées que l’on a de la Divinité, de l’Ame, des Esprits et de presque tous les autres objets qui composent la Religion. L’usage a prévalu, l’on se contente des préjugés de la naissance et l’on s’en rapporte sur les choses les plus essentielles à des personnes intéressées qui se font une loi de soutenir opiniâtrement les opinions reçues et qui n’osent les détruire de peur de se détruire eux-mêmes.
II — Ce qui rend le mal sans remède, c’est qu’après avoir établi les fausses idées qu’on a de Dieu, on n’oublie rien pour engager le peuple à les croire, sans lui permettre de les examiner; au contraire, on lui donne de l’aversion pour les philosophes ou les véritables savants, de peur que la raison qu’ils enseignent ne lui fasse connaître les erreurs où il est plongé. Les partisans de ces absurdités ont si bien réussi qu’il est dangereux de les combattre. Il importe trop à ces imposteurs que le peuple soit ignorant, pour souffrir qu’on le désabuse. Ainsi on est contraint de déguiser la vérité, ou de se sacrifier à la rage des faux savants, ou des âmes basses et intéressées.
III — Si le peuple pouvait comprendre en quel abîme l’ignorance le jette, il secouerait bientôt le joug de ses indignes conducteurs, car il est possible de laisser agir la raison sans qu’elle découvre la vérité.
Ces imposteurs l’ont si bien senti, que pour empêcher les bons effets qu’elle produirait infailliblement, ils se sont avisé de nous la peindre comme un monstre qui n’est capable d’inspirer aucun bon sentiment, et quoiqu’ils blâment en général ceux qui sont déraisonnables, il seraient cependant bien fâchés que la vérité fut écoutée. Ainsi l’on voit tomber sans cesse dans des contradictions continuelles ces ennemis jurés du bon sens; et il est difficile de savoir ce qu’ils prétendent. S’il est vrai que la droite raison soit la seule lumière que l’homme doive suivre, er si le peuple n’est pas aussi incapable de raisonner qu’on tâche de le persuader, il faut que ceux qui cherchent à l’instruire s’appliquent à rectifier ses faux raisonnements, et à détruire ses préjugés; alors on verra ses yeux se dessiller peu à peu et son esprit se convaincre de cette vérité, que Dieu n’est point ce qu’il s’imagine ordinairement.
IV — Pour en venir à bout, il n’est besoin ni de hautes spéculations, ni de pénétrer fort avant dans les secrets de la nature. On n’a besoin que d’un peu de bon sens pour juger que Dieu n’est ni colère, ni jaloux; que la justice et la miséricorde sont des faux titres qu’on lui attribue; et que ce que les Prophètes et les Apôtres en ont dit ne nous apprend ni sa nature, ni son essence.
En effet, à parler sans fard et à dire la chose comme elle est, ne faut-il pas convenir que ces Docteurs n’étaient ni plus habiles, ni mieux instruits que le reste des hommes; que bien loin de là, ce qu’ils disent au sujet de Dieu est si grossier, qu’il faut être tout à fait peuple pour le croire? Quoique la chose soit assez évidente d’elle-même, nous allons la rendre encore plus sensible, en examinant cette question: S’il y a quelque apparence que les Prophètes et les Apôtres aient été autrement conformés que les hommes?
V — Tout le monde demeure d’accord que pour la naissance et les fonctions ordinaires de la vie, ils n’avaient rien qui les distinguât du reste des hommes; ils étaient engendrés par des hommes, ils naissent des femmes, et ils conserveraient leur vie de la même façon que nous. Quant à l’esprit, on veut que Dieu animât bien plus celui des Prophètes que des autres hommes, qu’il se communiquât à eux d’une façon toute particulière: on le croit d’aussi bonne foi que si la chose était prouvée; et sans considérer que tous les hommes se ressemblent, et qu’ils ont tous une même origine, on prétend que ces hommes ont été d’une trempe extraordinaire; et choisis par la Divinité pour annoncer ses oracles. Mais, outre qu’ils n’avaient ni plus d’esprit que le vulgaire, ni l’entendement plus parfait, que voit-on dans leurs écrits qui nous oblige à prendre une si haute opinion d’eux? La plus grande partie des choses qu’ils ont dites est si obscure que l’on n’y entend rien, et en si mauvais ordre qu’il est facile de s’apercevoir qu’ils ne s’entendaient pas eux-mêmes, et qu’ils n’étaient que des fourbes ignorants. Ce qui é donné lieu à l’opinion que l’on a conçue d’eux, c’est la hardiesse qu’ils ont eue de se vanter de tenir immédiatement de Dieu tout ce qu’ils annonçaient au peuple; créance absurde et ridicule, puisqu’ils avouent eux-mêmes que Dieu ne leur parlait qu’en songe. Il n’est rien de plus naturel à l’homme que les songes, par conséquent, il faut qu’un homme soit bien effronté, bien vain et bien insensé, pour dire que Dieu lui parle par cette voie, et il faut que celui qui y ajoute foi, soit bien crédule et bien fol pour prendre des songes pour des oracles divins. Supposons pour un moment que Dieu se fit entendre à quelqu’un par des songes, par des visions, ou par telle autre voie qu’on voudra imaginer, personne n’est obligé d’en croire sur sa parole un homme sujet à l’erreur, et même au mensonge et à l’imposture; aussi voyons-nous que dans l’ancienne Loi l’on n’avait pas, à beaucoup près, pour les Prophètes autant d’estime qu’on en a aujourd’hui. Lorsqu’on était las de leur babil, qui ne tendait souvent qu’à semer la révolte et à détourner le peuple de l’obéissance, on les faisait taire par divers supplices; Jésus-Christ lui-même n’échappa point au juste châtiment qu’il méritait; il n’avait pas, comme Moïse, une armée à sa suite pour défendre ses opinions; ajoutez à cela que les Prophètes étaient tellement accoutumés à se contredire les uns les autres, qu’il ne s’en trouvait pas dans quatre cents un seul véritable. De plus, il est certain que le but de leur Prophéties, aussi bien que des lois des plus célèbres législateurs, était d’éterniser leur mémoire, en faisant croire aux peuples qu’ils conféraient avec Dieu. Les plus fins politiques en ont toujours usé de la sorte, quoique cette ruse n’ai pas toujours réussi à ceux qui, à l’imitation de Moïse, n’avaient pas le moyen de pourvoir à leur sûreté.
VI — Cela posé, examinons un peu l’idée que les Prophètes ont eu de Dieu. S’il faut les en croire, Dieu est un être purement corporel; Michée le voit assis; Daniel, vêtu de blanc et sous la forme d’un vieillard; Ezéchiel le voit comme un feu, voilà pour le Vieux Testament. Quant au Nouveau, les Disciples de Jésus-Christ s’imaginent le voir sous la forme d’une colombe, les Apôtres sous celle de langues de feu, et saint Paul, enfin, comme une lumière qui l’éblouit et l’aveugle. Pour ce qui est de la contradiction de leurs sentiments, Samuel, croyait que Dieu ne se repentait jamais de ce qu’il avait résolu; au contraire, Jérémie nous dit que Dieu se repent des conseils qu’il a pris. Joël nous apprend qu’il ne se repent que du mal qu’il a fait aux hommes: Jérémie dit qu’il ne s’en repent point. La Genèse nous enseigne que l’homme est maître du péché et qu’il ne tient qu’à lui de bien faire, au lieu que Saint Paul 4 assure que les hommes n’ont aucun empire sur la concupiscence sans une grâce de Dieu toute particulière, etc. telles sont les idées fausses et contradictoires que ces prétendus inspirés nous donnent de Dieu, et que l’on veut que nous en ayons, sans considérer que ces idées nous représentent la Divinité comme un être sensible, matériel et sujet à toutes les passions humaines. Cependant on vient nous dire après cela que Dieu n’a rien de commun avec la matière, et qu’il est un être incompréhensible pour nous. Je souhaiterais fort savoir comment tout cela peut s’accorder, s’il est juste d’en croire des contradictions si visibles et si déraisonnables, et si l’on doit enfin s’en rapporter au témoignage d’hommes assez grossiers pour s’imaginer, nonobstant les sermons de Moïse, qu’un Veau était leur Dieu ! Mais sans nous arrêter aux rêveries d’un peuple élevé dans la servitude et dans l’absurdité, disons que l’ignorance a produit la croyance de toutes les impostures et les erreurs qui règnent aujourd’hui parmi nous.
Chapitre II. Des raisons qui ont engagé les hommes à se figurer un Être invisible qu’on nomme communément Dieu. ⮵
De l’ignorance des causes physiques et de la crainte produite par des accidents naturels, mais extraordinaires ou terribles, est venue l’idée de l’existence de quelque puissance invisible; idée dont la politique et l’imposture n’ont pas manqué de profiter. Examen de la nature de Dieu. Opinion des Causes Finales réfutée comme contraire à la saine physique.
Ceux qui ignorent les causes physiques ont une crainte naturelle qui procède de l’inquiétude et du doute où ils sont s’il existe un Être ou une puissance qui ait le pouvoir de leur nuire ou de les conserver. De là le penchant qu’ils ont à feindre des causes invisibles, qui ne sont que des Fantômes de leur imagination, qu’ils invoquent dans l’adversité et qu’ils louent dans la prospérité. Ils s’en font des Dieux à la fin et cette crainte chimérique des puissances invisibles est la source des Religions que chacun se forme à sa mode. Ceux à qui il importait que le peuple fut contenu et arrêté par de semblables rêveries ont entretenu cette semence de religion, en ont fait une loi et ont enfin réduit les peuples, par les terreurs de l’avenir, à obéir aveuglément.
II — La source des Dieux étant trouvée, les hommes ont cru qu’ils leur ressemblaient et qu’ils faisaient comme eux toutes choses pour quelque fin. Ainsi ils disent et croient unanimement que Dieu n’a rien fait que pour l’homme, et réciproquement que n’est fait que pour Dieu. Ce préjugé est général, et lorsqu’on réfléchit sur l’influence qu’il a dû nécessairement avoir sur les mœurs et les opinions des hommes, on voit clairement que c’est là qu’ils ont pris occasion de se former des idées fausses du bien et du mal, du mérite et du démérite, de l’honneur et de la honte, de l’ordre et de la confusion, de la beauté et de la difformité et des autres choses semblables.
III — Chacun doit demeurer d’accord que tous les hommes sont dans une profonde ignorance en naissant, et que la seule chose qui leur soit naturelle, est de chercher ce qui leur est utile et profitable: de là vient: 1° qu’on croît qu’il suffit d’être libre de sentir par soi-même qu’on peut vouloir et souhaiter sans se mettre nullement en peine des causes qui disposent à vouloir et à souhaiter, parce qu’on ne les connaît pas; 2° comme les hommes ne font rien que pour une fin qu’ils préfèrent à toute autre, et ils n’ont pour but que de connaître les causes finales de leurs actions, et ils imaginent qu’après cela ils n’ont plus aucun sujet de doute, et comme ils trouvent en eux-mêmes et hors d’eux plusieurs moyens de parvenir à ce qu’ils se proposent, vu qu’ils ont, par exemple, un soleil pour les éclairer, etc., ils ont conclu qu’il n’y a rien dans la nature qui ne soit fait pour eux, et dont ils ne puissent jouir et disposer; mais comme ils savent que ce n’est point eux qui ont fait toutes ces choses, ils se sont cru bien fondés à imaginer un être suprême auteur de tout, en un mot, ils ont pensé que tout ce qui existe était l’ouvrage d’une ou de plusieurs Divinités. D’un autre côté, la nature des Dieux que les hommes ont admis leur étant inconnue, ils en ont jugé par eux-mêmes, s’imaginant qu’ils étaient susceptibles des mêmes passions qu’eux; et comme les inclinations des hommes sont différentes, chacun a rendu à sa Divinité un culte selon son humeur, dans la vue d’attirer ses bénédiction et de la faire servir par là toute la nature à ses propres désirs.
IV — C’est de cette manière que le préjugé s’est changé en superstition; il s’est enraciné de telle sorte, que les gens les plus grossiers se sont cru capables de pénétrer dans les causes finales, comme s’ils en avaient une entière connaissance. Ainsi, au lieu de faire voir que la nature ne fait rien en vain, ils ont cru que Dieu et la nature pensaient à la façon des hommes. L’expérience ayant fait connaître qu’un nombre infini de calamités troublent les douceurs de la vie, comme les orages, les tremblements de terre, les maladies, la faim, la soif, etc., on attribua tous ces maux à la colère céleste, on crut la Divinité irritée contre les offenses des hommes, qui n’ont pu ôter de leur tête une pareille chimère, ni se désabuser de ces préjugés par les exemples journaliers qui leur prouvent que les biens et les maux ont été de tout temps communs aux bons et aux méchants. Cette erreur vient de ce qu’il leur fut plus facile de demeurer dans leur ignorance naturelle que d’abolir un préjugé reçu depuis tant de siècles et d’établir quelque chose de vraisemblable.
V — Ce préjugé les a conduits à un autre, qui est de croire que les jugements de Dieu étaient incompréhensibles, et que par cette raison, la connaissance de la vérité était au-dessus des forces de l’esprit humain; erreur où l’on serait encore, si les mathématique la physique et quelques autres sciences ne l’avaient détruite.
VI — Il n’est pas besoin de longs discours pour montrer que la nature ne se propose aucune fin, et que toutes les causes finales e sont que des fictions humaines. Il suffit de prouver que cette doctrine ôte à Dieu les perfections qu’on lui attribue. C’est ce que nous allons faire voir.
Si Dieu agit pour une fin, soit pour lui-même, soit pour quelque autre, il désire ce qu’il n’ point, et il faudra convenir qu’il y a un temps auquel Dieu n’ayant pas l’objet pour lequel il agit, il a souhaité l’avoir; ce qui est faire un Dieu indigent. Mais pour ne rien omettre de ce qui peut appuyer le raisonnement de ceux qui tiennent l’opinion contraire; supposons par exemple, qu’une pierre, qui se détache d’un bâtiment, tombe sur une personne et la tue, il faut bien, disent nos ignorants, que cette pierre soit tombée à dessein pour tuer cette personne; or, cela n’a pu arriver que parce que Dieu l’a voulu. Si on leur répond que c’est le vent qui a causé cette chute dans le temps que ce pauvre malheureux passait, ils vous demanderont d’abord, pourquoi il passait précisément dans ce moment que le vent ébranlait cette pierre. Répliquez-leur qu’il allait dîner chez un de ses amis qu’il l’en avait prié, ils voudront savoir pourquoi cet ami l’avait plutôt prié dans ce temps-là que dans un autre; ils vous feront aussi une infinité de questions bizarres pour remonter de causes en causes et vous faire avouer que la seule volonté de Dieu, qui est l’asile des ignorants, est la cause première de la chute de cette pierre. De même, lorsqu’ils voient la structure du corps humain, ils tombent dans l’admiration; et de ce qu’ils ignorent les causes des effets qui leur paraissent si merveilleux, ils concluent que c’est un effet surnaturel, auquel les causes qui nous sont connues ne peuvent avoir aucune part. De là vient que celui qui veut examiner à fond les œuvres de la création, et pénétrer en vrai savant dans leurs causes naturelles, sans s’asservir aux préjugés formés par l’ignorance, passe pour un impie, ou est bientôt décrié par la malice de ceux que le vulgaire reconnaît pour les interprètes de la nature et des dieux. Ces âmes mercenaires savent très bien que l’ignorance, qui tient le peuple dans l’étonnement, est ce qui les fait subsister et qui conserve leur crédit.
VII — Les hommes s’étant donc imbus de la ridicule opinion que tout ce qu’ils voient est fait pour eux, se sont fait un point de Religion d’appliquer tout à eux-mêmes et de juger des choses par le profit qu’ils en retirent. C’est là-dessus qu’ils ont formé des notions qui leur servent à expliquer la nature des choses, à juger du bien et du mal, de l’ordre et du désordre, du chaud et du froid, de la beauté et de la laideur, etc., qui dans le fond ne sont point ce qu’ils s’imaginent: maîtres de former ainsi leurs idées, ils se flattèrent d’être libres; ils se crurent en droit de décider de la louange et du blâme, du bien et du mal; ils ont appelé bien ce qui tourne à leur profit et ce qui regarde le culte divin et mal, au contraire, ce qui ne convient ni à l’un ni à l’autre et comme les ignorants ne sont capables de juger de rien, et n’ont aucune idée des choses que par le secours de l’imagination, qu’ils prennent pour le jugement, ils nous disent que l’on ne connaît rien dans la nature, et se figurent un ordre particulier dans le monde. Enfin, ils croient les choses bien ou mal ordonnées, suivant qu’ils ont de la facilité ou de la peine à les imaginer, quand le sens les leur représente; et comme n s’arrêter volontiers à ce qui fatigue le moins le cerveau, on se persuade d’être bien fondé à préférer l’ordre à la confusion; comme si l’ordre était autre chose qu’un pur effet de l’imagination des hommes. Ainsi, dire que Dieu a tout fait avec ordre, c’est prétendre que c’est en faveur de l’imagination humaine qu’il a créé le monde, de la manière la plus facile à être conçue par elle: ou, ce qui, au fond est la même chose, que l’on connaît avec certitude les rapports et les fins de tout ce qui existe, assertion trop absurde pour mériter d’être réfutée sérieusement.
VIII — Pour ce qui est des autres notions, ce sont de purs effets de la même imagination, qui n’ont rien de réel, et qui ne sont que des différentes affections ou modes dont cette faculté est susceptible: quand, par exemple, les mouvements que les objets impriment dans les nerf, par le moyen des yeux, sont agréables aux sens, on dit que ces objets sont beaux. Les odeurs sont bonnes ou mauvaises, les saveurs douces ou amères, ce qui se touche dur ou tendre, les sons rudes et les sons frappent ou pénètrent les sens; c’est d’après ces idées qui se trouve des gens qui croient que Dieu se plaît à la mélodie, tandis que d’autres ont cru que les mouvements célestes étaient un concert harmonieux: ce qui marque bien que chacun se persuade que les choses sont telles qu’il se les figure, ou que le monde est purement imaginaire. Il n’est dont point étonnant qu’il se trouve à peine deux hommes d’une même opinion et qu’il y en ait même qui se fassent gloire de douter de tout: car, quoique les hommes aient un même corps et qu’ils se ressemblent tous à beaucoup d’égards, il diffèrent néanmoins à beaucoup d’autres; de là vient que ce qui semble bon à l’un devient mauvais pour l’autre, que ce qui plaît à celui-ci déplaît à celui-là. D’où il est aisé de conclure que les sentiments ne diffèrent qu’en raison de l’organisation et de la diversité des co-existences, que le raisonnement y a peu de part et qu’enfin les notions des choses du monde ne sont qu’un pur effet de la seule imagination.
IX — Il est donc évident que toutes les raisons dont le commun des hommes a coutume de se servir, lorsqu’il se mêle d’expliquer la nature, ne sont que des façons d’imaginer, qui ne peuvent rien moins que ce qu’il prétend; l’on donne à ces idées des noms, comme si elles existaient ailleurs que dans un cerveau prévenu; on devrait les appeler, non des êtres, mais des pures chimères. A l’égard des arguments fondés sur ces notions, il n’est rien de plus aisé que de les réfuter, par exemple:
S’il était vrai, nous dit-on, que l’Univers fût un écoulement et une suite nécessaire de la nature divine, d’où viendraient les imperfections et les défauts qu’on y remarque? Cette objection se réfute sans nulle peine. On ne saurait juger de la perfection et de l’imperfection d’un être, qu’autant qu’on en connaît l’essence et la nature et c’est s’abuser étrangement que de croire qu’une chose est plus ou moins parfaite suivant qu’elle plaît ou déplaît, et qu’elle est utile ou nuisible à la nature humaine. Pour fermer la bouche à ceux qui demandent pourquoi Dieu n’a point créé tous les hommes bons et heureux, il suffit de dire que tout est nécessairement ce qu’il est, et que dans la nature, il n’y a rien d’imparfait, puisque tout découle de la nécessité des choses.
X — Cela posé, si l’on demande ce que c’est que Dieu, je réponds que ce mot nous représente l’Être universel dans lequel, pour parler comme saint Paul, nous avons la vie, le mouvement et l’être. C’est notion n’a rien qui soit indigne de Dieu; car, si tout est Dieu, tout découle nécessairement de son essence et il faut absolument qu’il soit tel que ce qu’il contient, puisqu’il est incompréhensible que des êtres tout matériels soient maintenus et contenus dans un être qui ne le soit point. Cette opinion n’est point nouvelle; Tertullien, l’un des plus savants hommes que les chrétiens aient eu, a prononcé contre Appelles, que ce qui n’est pas corps n’est rien, et contre Praxéas, que toute substance est un corps. Cette doctrine, cependant n’a pas été condamnée dans les quatre premiers Conciles œcuméniques ou généraux.
XI — Ces idées sont claires, simples et les seules mêmes qu’un bon esprit puisse se former de Dieu. Cependant, il y a peu de gens qui se contentent d’une telle simplicité. Le peuple grossier et accoutumé aux flatteries des sens demande un Dieu qui ressemble aux Rois de la terre. Cette pompe, ce grand éclat qui les environne, l’éblouit de telle sorte que lui ôter l’espérance d’aller, après la mort, grossir le nombre des courtisans célestes, pour jouir avec eux des mêmes plaisirs qu’on goûte à la Cour des Rois; c’est priver l’homme de la seule consolation qui l’empêche de se désespérer dans les misères de la vie. On dit qu’il faut un Dieu juste et vengeur qui punisse et récompense; on veut un Dieu susceptible de toutes les passions humaines, on lui donne des pieds, des mains, des yeux et des oreilles, et cependant on ne veut point qu’un Dieu constitué de la sorte ait rien de matériel. On dit que l’homme est son chef-d’œuvre et même son image, mais on ne veut pas que la copie soit semblable à l’original. Enfin, le Dieu du peule d’aujourd’hui est sujet à bien plus de formes que le Jupiter des Païens. Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que plus ces notions se contredisent et choquent le bon sens, plus le vulgaire les révère, parce qu’il croit opiniâtrement ce que les Prophètes en ont dit, quoique ces visionnaires ne fussent parmi les Hébreux que ce qu’étaient les augures et les devins chez les Païens. On consulte la Bible, comme si Dieu et la nature s’y expliquaient d’une façon particulière; quoique ce livre ne soit qu’un tissu de fragments cousus ensemble en divers temps, ramassés par diverses personnes et publiés de l’aveu des rabbins, qui ont décidé, suivant leur fantaisie, de ce qui devait être approuvé ou rejeté, selon qu’ils l’ont trouvé conforme ou opposé à la Loi de Moïse. Telle est la malice et la stupidité des hommes. Ils passent leur vie à chicaner et persistent à respecter un livre où il n’y a guère plus d’ordre que dans l’Alcoran de Mahomet; un livre, dis-je, que personne n’entend, tant il est obscur et mal conçu; un livre qui ne sert qu’à fomenter des divisions. Les Juifs et les Chrétiens aiment mieux consulter ce grimoire que d’écouter la Loi naturelle que Dieu, c’est-à-dire la Nature, en tant qu’elle est le principe de toutes choses, a écrit dans le cœur des hommes. Toutes les autres lois ne sont que des fictions humaines, et de pures illusions mises au jour, non par les Démons ou mauvais Esprits, qui n’existèrent jamais qu’en idée, mais par la politique des Princes et des Prêtres. Les premiers nt voulu par là donner plus de poids à leur autorité, et ceux-ci ont voulu s’enrichir par le débit d’une infinité de chimères qu’ils vendent cher aux ignorants.
Toutes les autres lois qui ont succédé à celle de Moïse, j’entends les lois des Chrétiens, ne sont appuyées que sur cette Bible dont l’original ne se trouve point, qui contient des choses surnaturelles et impossibles, qui parle de récompenses et de peines pour les actions bonnes ou mauvaises, mais qui ne sont que pour l’autre vie, de peur que la fourberie ne soit découverte, nul n’en étant jamais revenu. Ainsi, le peuple, toujours flottant entre l’espérance et la crainte, est retenu dans son devoir par l’opinion qu’il a que Dieu n’a fait les hommes que pour les rendre éternellement heureux ou malheureux. C’est là ce qui a donné lieu à une infinité de Religions.
Chapitre III — Ce que signifie ce mot Religion: comment et pourquoi il s’en est introduit un si grand nombre dans le monde ⮵
Toutes les religions sont l’ouvrage de la politique. Conduite de Moïse pour établir la religion judaïque. Examen de la naissance de Jésus-Christ, de sa politique, de sa morale et de sa réputation après sa mort. Artifices de Mahomet pour établir sa religion. Succès de cet imposteur, plus grand que celui de Jésus-Christ.
Avant que le mot Religion se fût introduit dans le monde, on n’était obligé qu’à suivre la loi naturelle, c’est-à-dire à se conformer à la droite raison. Ce seul instinct était le lien auquel les hommes étaient attachés; et ce lien, tout simple qu’il est, les unissait de telle sorte que les divisions étaient rares. Mais dès que la crainte eût fait soupçonner qu’il y a des Dieux et des Puissances invisibles, ils s’élèvent des autels à ces êtres imaginaires, et, secouant le joug de la nature et de la raison, ils se lièrent par de vaines cérémonies et par un culte superstitieux aux vains fantômes de l’imagination. C’est de là que dérive le mot de Religion qui fait tant de bruit dans le monde. Les hommes ayant admis des Puissances invisibles qui avaient tout pouvoir sur eux, ils les adorèrent pour les fléchir, et, de plus, ils s’imaginèrent que la nature était un être subordonné à ces Puissances. Dès lors, ils se la figurèrent comme une masse morte, ou comme une esclave qui n’agissait que suivant l’ordre de ces Puissances. Dès que cette fausse idée eût frappé leur esprit, ils n’eurent plus que du mépris pour la nature, et du respect pour ces êtres prétendus, qu’ils nommèrent leurs Dieux. De là est venue l’ignorance où tant de peuples sont plongés, ignorance d’où les vrais savants les pourraient retirer, quelque profond qu’en soit l’abîme, si leur zèle n’était traversé par ceux qui mènent ces aveugles, et qui ne vivent qu’à la faveur de leurs impostures.
Mais quoi qu’il y ait bien peu d’apparence de réussir dans cette entreprise, il ne faut pas abandonner le parti de la vérité, quand ce serait qu’en considération de ceux qui se garantissent des symptômes de ce mal; il faut qu’une âme généreuse dise les choses comme elles sont. La vérité, de quelque nature qu’elle sot, ne peut jamais nuire, au lieu que l’erreur, quelque innocente et quelque utile même qu’elle paraisse, doit nécessairement avoir à la longue des effets très funestes.
II — La crainte qui a fait les Dieux a fait aussi la Religion et, depuis que les hommes se sont mis en tête qu’il y avait des anges invisibles qui étaient cause de leur bonne u mauvaise fortune, ils ont renoncé au bon sens et à la raison, et ils ont pris leurs chimères pour autant de divinités qui avaient soin de leur conduite. Après donc s’être forgé des Dieux, ils voulurent savoir quelle était leur nature, et s’imaginant qu’ils devaient être de la même substance que l’âme, qu’ils croient ressembler aux fantômes qui paraissent dans le miroir ou pendant le sommeil; ils crurent que leurs Dieux étaient des substances réelle; mais si ténues et si subtiles que, pour les distinguer des Corps, ils les appelèrent, Esprits, bien que ces corps et ces esprits ne soient, en effet, qu’une même chose, et ne diffèrent que du plus ou moins, puisqu’être Esprit ou incorporel, est une chose incompréhensible. La raison est que tout esprit a une figure qui lui est propre, et qu’il est renfermé dans quelque lieu, c’est-à-dire qu’il a des bornes, et que, par conséquent, c’est un corps, quelque subtil qu’on le suppose.
III — Les Ignorants (c’est-à-dire la plupart des hommes) ayant fixé de cette sorte la nature de la substance de leurs Dieux, tâchèrent aussi de pénétrer par quels moyens ces anges invisibles produisaient leurs effets; mais n’en pouvant venir à bout, à cause de leur ignorance, ils en crurent leurs conjectures; jugeant aveuglément de l’avenir par le passé; comme si l’on pouvait raisonnablement conclure de ce qu’une chose est arrivée autrefois de telle et telle manière, qu’elle arrivera ou qu’elle doive arriver constamment, de la même manière; surtout lorsque les circonstances et toutes les causes qui influent nécessairement sur les événements et actions humaines, et qui en déterminent la nature et l’actualité, sont diverses. Ils envisagèrent donc le passé et augurèrent bien ou mal pour l’avenir, suivant que la même entreprise avait autrefois bien ou mal réussi. C’est ainsi que Phormion ayant défait les Lacédémoniens dans la bataille de Naupacte, les athéniens, après sa mort, élirent un autre Général du même nom. Annibal ayant succombé sous les armes de Scipion l’Africain, à cause de ce bi-on succès, les Romains envoyèrent dans la même Province un autre Scipion contre César, ce qui ne réussit ni aux athéniens ni aux Romains. Ainsi, plusieurs nations, après deux ou trois expériences, ont attaché aux lieux, aux objets et aux noms leurs bonnes ou mauvaises fortunes; d’autres se sont servis de certains mots qu’ils appellent des enchantements et les ont cru si efficaces qu’ils s’imaginent par leur moyen faire parler les arbres, faire un homme ou un Dieu d’un morceau de pain, et métamorphoser tout ce qui paraissait devant eux.
IV — L’empire des Puissances invisibles étant établi de la sorte, les hommes ne les révélèrent d’abord que comme leurs Souverains; c’est-à-dire par des marques de soumission et de respect, tels que sont les présents, les prières, etc. Je dis d’abord, car la nature n’apprend point à user de Sacrifices sanglants en cette rencontre: ils n’ont été institués que pour la subsistance des Sacrificateurs et des Ministres destinés au service de ces Dieux imaginaires.
V — Ce germe de Religion (je veux dire de l’espérance et la crainte), fécondé par les passions et opinions diverses des hommes, a produit ce grand nombre de croyances bizarres qui sont les causes de tant de maux et de tant de révolutions qui arrivent dans les Etats.
Les honneurs et les grands revenus qu’on a attachés au Sacerdoce, ou aux Ministères des Dieux, ont flatté l’ambition et l’avarice de ces hommes rusés qui ont su profiter de la stupidité des peuples; ceux-ci ont si bien donné dans leurs pièges qu’ils se sont fait insensiblement une habitude d’encenser le mensonge et de haïr la vérité.
VI — Le mensonge étant établi, et les ambitieux épris de la douceur d’être élevés au-dessus de leurs semblables, ceux-ci tâchèrent de se mettre en réputation en feignant d’être les amis des Dieux invisibles que le vulgaire redoutait. Pour y mieux réussir, chacun les peignit à sa mode et prit la licence de les multiplier au point qu’on en trouvait à chaque pas.
VII — La matière informe du monde fut appelée le Dieu Chaos. On fit de même un Dieu du Ciel, de la Terre, de la Mer, du Feu, des Vents et des Planètes. On fit le même honneur aux hommes et aux femmes; les oiseaux, les reptiles, le crocodile, le veau, le chien, l’agneau, le serpent et le pourceau, en un mot toutes sortes d’animaux et de plantes furent adorés. Chaque fleuve, chaque fontaine porta le nom d’un Dieu, chaque maison eut le sien, chaque homme eut son génie. Enfin, tout était plein, tant dessus que dessous la terre, de Dieux, d’Esprits, d’Ombres et de Démons. Ce n’était pas encore assez de feindre des Divinités dans tous les lieux imaginables; on eût cru offenser le temps, le jour, la nuit, la concorde, l’amour, la paix, la victoire, la contention, la rouille, l’honneur, la vertu, la fièvre et la santé; on eût, dis-je, cru faire outrage à de telles Divinités qu’on pensait toujours prêtes à fondre sur la tête des hommes, si on ne leur eût élevé des temples et des autels. Ensuite, on s’avisa d’adorer son génie, que quelques-uns invoquèrent sous le nom de Muses; d’autres sous le nom de Fortune, adorèrent leur propre ignorance. Ceux-ci sanctifièrent leur débauches sous le nom de Cupidon, leur colère sous celui de Furies, leurs parties sexuelles sous le nom de Priape; en un mot, il n’y eut rien à quoi ils ne donnassent le nom d’un Dieu ou d’un Démon.
VIII — Les fondateurs des Religions, sentant bien que la base de leurs impostures était l’ignorance des peuples, s’avisèrent de les y entretenir par l’adoration des images dans lesquelles ils feignirent que les Dieux habitaient; cela fit tomber sur leurs Prêtres une pluie d’or et des Bénéfices que l’on regarda comme des choses saintes, parce qu’elles furent destinées à l’usage des ministres sacrés et personne n’eut la témérité ni l’audace d’y prétendre, ni même d’y toucher. Pour mieux tromper le Peuple, les Prêtres se proposèrent des Prophètes, des Devins, des Inspirés capables de pénétrer dans l’avenir, ils se vantèrent d’avoir commerce avec les Dieux; et comme il est naturel de vouloir savoir sa destinée, ces imposteurs n’eurent garde d’omettre une circonstance si avantageuse à leur dessein. Les uns s’établirent à Délos, les autres à Delphes et ailleurs, où, par des oracles ambigus, ils répondirent aux demandes qu’on leur faisait: les femmes même s’en mêlaient; les Romains avaient recours, dans les grandes calamités, aux Livres des Sybilles. Les fous passaient pour des inspirés. Ceux qui feignaient d’avoir un commerce familier avec les morts étaient nommés Nécromanciens; d’autres prétendaient connaître l’avenir par le vol des oiseaux ou par les entrailles des bêtes. Enfin, les yeux, les mains, le visage, un objet extraordinaire, tout leur semble d’un bon ou mauvais augure, tant il est vrai que l’ignorance reçoit telle impression qu’on veut, quand on a trouvé le secret de s’en prévaloir.
IX — Les ambitieux, qui ont toujours été de grands maîtres dans l’art de tromper, ont suivi cette route lorsqu’ils donnèrent des lois; et, pour obliger le Peuple de se soumettre volontairement, ils lui ont persuadé qu’ils les avaient reçues d’un Dieu ou d’une Déesse.
Quoi qu’il en soit de cette multitude de Divinités, ceux chez qui elles ont été adorées et qu’on nomme Païens, n’avaient point de système général de Religion. Chaque République, chaque Etat, chaque ville et chaque particulier avait ses rites propres et pensait de la Divinité à sa fantaisie. Mais il s’est élevé par la suite des législateurs plus fourbes que les premiers, qui ont employé des moyens plus étudiés et plus sûrs en donnant des lois, des cultes, des cérémonies propres à nourrir le fanatisme qu’ils voulaient établir.
Parmi un grand nombre, l’Asie en a vu naître trois qui se sont distingués tant par les lois et les cultes qu’ils ont institués, que par l’idée qu’ils ont donnée de la Divinité et par la manière dont ils s’y sont pris pour faire recevoir cette idée et rendre leur lois sacrées. Moïse fut le plus ancien. Jésus-Christ, venu depuis, travailla sous son plan et en conservant le fond de ses lois, il abolit le reste. Mahomet, qui a paru le dernier sur la scène, a pris dans l’une et dans l’autre Religion de quoi composer la sienne et s’est ensuite déclaré l’ennemi de toutes les deux. Voyons les caractères de ces trois législateurs, examinons leur conduite, afin qu’on juge après cela lesquels sont les mieux fondés, ou ceux qui les révèrent comme des hommes divins, ou ceux qui les traitent de fourbes ou d’imposteurs.
De Moïse, X ⮵
Le célèbre Moïse, petit-fils d’un grand Magicien au rapport de Justin Martyr, eut tous les avantages propres à le rendre ce qu’il devint par la suite. Chacun sait que les Hébreux, dont il se fit le chef, étaient une nation de Pasteurs, que le roi Pharaon Osiris I reçut en son pays en considération des services qu’il avait reçus de l’un d’eux dans le temps d’une grande famine: Il leur donna quelques terres à l’orient de l’Egypte, dans une contrée fertile en pâturages et, par conséquent, propre à nourrir leurs troupeaux. Pendant près de deux cents ans, ils se multiplièrent considérablement, soit parce qu’y étant considérés comme étrangers, on ne les obligeât point de servi dans les armées, soit à cause des privilèges qu’Osiris leur avait accordés, plusieurs naturels du pays se joignirent à eux, soit enfin que quelques bandes d’Arabes fussent venues se joindre à eux en qualité de leurs frères, car ils étaient d’une même race. Quoi qu’il en soit, ils multiplièrent si étonnamment que, ne pouvant plus tenir dans la contrée de Gossen, ils se répandirent dans toute l’Egypte et donnèrent à Pharaon une juste raison de craindre qu’ils ne fussent capables de quelques entreprises dangereuses au cas que l’Egypte fut attaquée (comme cela arrivait alors assez souvent) par les Ethiopiens, ses ennemis assidus. Ainsi, une raison d’Etat obligea ce Prince à leur ôter leurs privilèges et à chercher les moyens de les affaiblir et de les asservir.
Pharaon Orus, surnommé Burisis à cause de sa cruauté, lequel succéda à Memnon, suivit son plan à l’égard des Hébreux et, voulant éterniser sa mémoire par l’érection des Pyramides et en bâtissant la ville de Thèbes, il condamna les hébreux à travailler les briques, à la formation desquelles les terres de leur pays étaient très propres. C’est pendant cette servitude que naquit le célèbre Moïse; la même année que le Roi ordonna qu’on jetât dans le Nil tous les enfants mâles des Hébreux, voyant qu’il n’y avait pas de plus sûr moyen de faire périr cette peuplade d’étrangers. Ainsi Moïse fut exposé à périr par les eaux dans un panier enduit de bitume, que sa mère plaça dans les joncs sur les bords du fleuve. Le hasard voulut que Thermutis, fille du Pharaon Orus, vint se promener de ce côté-là et qu’ayant ouï les cris de cet enfant, la compassion si naturelle à son sexe lui inspirât le désir de le sauver. Orus étant mort, Thermutis lui succéda et Moïse lui ayant été présenté, elle lui fit donner une éducation telle qu’on pouvait la donner à un fils de la reine d’une nation alors la plus savante et la plus polie de l’univers. En un mot, en disant qu’il fut élevé dans toutes les sciences des Egyptiens, c’est tout dire, et c’est nous présenter Moïse comme le plus grand politique, le plus savant naturaliste et le plus fameux magicien de son temps. Outre qu’il est fort apparent qu’il fut admis dans l’ordre des Prêtres, qui étaient, en Egypte, ce que les Druides étaient dans les Gaules. Ceux qui ne savent pas quel était alors le gouvernement de l’Egypte ne seront peut-être pas fâché d’apprendre que ses fameuses Dynasties ayant pris fin et tout le pays dépendant d’un seul souverain, elle était divisée alors en plusieurs contrées qui n’avaient pas une trop grande étendue. On nommait Monarques les Gouverneurs de ces contrées et ces gouverneurs étaient ordinairement du puissant ordre des Prêtres, qui possédaient près d’un tiers de l’Egypte. Le roi nommait à ces Monarchies, et, si l’on en croit les auteurs qui ont écrit de Moïse, en comparant ce qu’ils en ont dit avec ce que Moïse en a lui-même écrit, on conclura qu’il devait son élévation à Thermutis, à qui il devait aussi la vie. Voilà quel fut Moïse en Egypte, où il eut tout le temps et mes moyens d’étudier les mœurs des Egyptiens et de ceux de sa nation, leurs passions dominantes, leurs inclinations; connaissances dont il se servit dans la suite pour exciter la révolution dont il fut le moteur.
Thermutis étant morte, son successeur renouvela la persécution contre les Hébreux et Moïse, déchu de la faveur où il avait été, eut peur de ne pouvoir justifier quelques homicides qu’il avait commis; ainsi il prit le parti de fuir. Il se retira dans l’Arabie Pétrée, qui confine à l’Egypte; le hasard l’ayant conduit chez un chef de quelque tribu du pays, les services qu’il rendit et les talents que son maître crut remarquer ici que Moïse était si mauvais Juif et qu’il connaissait alors si peu le redoutable Dieu qu’il imagina dans la suite, qu’il épousa une idolâtre et qu’il ne passa pas seulement à circonscrire ses enfants.
C’est dans les déserts de cette Arabie qu’en gardant les troupeaux de son beau-père et de son beau-frère, il conçut le dessein de se venger de l’injustice que le Roi d’Egypte lui avait faite, en portant le trouble et la sédition dans le cœur de ses Etats. Il se flattait de pouvoir aisément réussir, tant à cause de ses talents, que par les dispositions où il savait trouver ceux de sa nation, déjà irrités contre le gouvernement par les mauvais traitements qu’on leur faisait éprouver.
Il paraît, par l’histoire qu’il a laissée de cette révolution, ou du moins que nous a laissée l’auteur des Livres qu’on attribue à Moïse, que Jéthro, son beau-père, était du complot, aussi bien que son frère Aaron et sa sœur Marie, qui était restée en Egypte et avec qui il avait sans doute entretenu une correspondance.
Quoi qu’il en soit, on voit par l’exécution qu’il avait formé un vaste plan en bon politique, et qu’il sut mettre en œuvre contre l’Egypte toute la science qu’il y avait apprise, je veux dire sa prétendue Magie: en quoi il était plus subtil et plus habile que tous ceux qui faisaient métier des mêmes tours d’adresse à la Cour de Pharaon.
C’est par ces prétendus prodiges qu’il fit soulever, et auxquels se joignirent les mutins et mécontents Egyptiens, Ethiopiens et Arabes. Enfin, vantant la puissance de sa Divinité, les fréquents entretiens qu’il avait avec elle, en la faisant intervenir dans toutes les mesures qu’il prenait avec les chefs de la révolte, il les persuada si bien qu’ils le suivirent au nombre de six mille hommes combattants, sans les femmes et les enfants, à travers les déserts de l’Arabie, dont il connaissait tous les détours. Après six jours de marche, dans une pénible retraite, il prescrivit à ceux qui le suivaient de consacrer le septième jour à son Dieu par un repos public, afin de leur faire croire que Dieu le favorisait, qu’il approuvait sa domination, et afin que personne n’eût l’audace de le contredire.
Il n’y eu jamais de peuple plus ignorant que les Hébreux, ni, par conséquent, plus crédule. Pour être convaincu de cette ignorance profonde, il ne faut que se souvenir dans quel état ce peuple était en Egypte, lorsque Moïse le fit révolter; il était haï des Egyptiens à cause de sa profession de pâtre, persécuté par le souverain, et employé aux travaux les plus vils. Au milieu d’une telle populace, il ne fut pas bien difficile à Moïse de faire valoir se talents. Il leur fit accroire que son Dieu (qu’il nomma quelque fois simplement un Ange), le Dieu de leurs Pères lui était apparu: que c’était par son ordre qu’il prenait soin de les conduire; qu’il l’avait choisi pour les gouverner, et qu’ils seraient le Peuple favori de ce Dieu, pourvu qu’ils crussent ce qu’il leur dirait de sa part. L’usage adroit de ses prestiges et de la connaissance qu’il avait de la nature, fortifia ces exhortations et il confirmait ce qu’il leur avait dit par ce qu’on appelle des prodiges, qui sont capables de faire toujours beaucoup d’impression sur la populace imbécile.
On peut remarquer surtout qu’il crut avoir trouvé un moyen sûr de tenir les Hébreux soumis à ses ordres en leur persuadant que Dieu était lui-même conducteur de nuit sous la figure d’une colonne de feu, et de jour sous la forme d’une nuée. Mais aussi on peut prouver que ce fut là la fourberie la plus grossière de cet imposteur. Il avait appris, pendant le séjour qu’il avait fait en Arabie, que, comme le pays était vaste et inhabité, c’était la coutume de ceux qui voyageaient par troupes de prendre des guides qui les conduisaient, la nuit, par le moyen d’un brasier dont ils suivaient la flamme, et, de jour, par la fumée du même brasier, que tous les membres de la caravane pouvaient découvrir, et, par conséquent, ne se point égarer. Cette coutume était encore en usage chez les Mèdes et les Assyriens; Moïse s’en servit et la fit passer pour un miracle et pour une marque de la protection de son Dieu. Qu’on ne m’en croie pas quand je dis que c’est un fourbe; qu’on en croie Moïse lui-même, qui, au 10° Chapitre des Nombres (V. 19), jusqu’au 33°, prie son beau-frère Hobad de venir avec les Ismaëlites, afin qu’il leur montrât le chemin, parce qu’il connaissait le pays. Ceci est démonstratif, car si c’était Dieu qui marchait devant Israël nuit et jour en nuée et en colonne de feu, pouvaient-ils avoir un meilleur guide? Cependant, voilà Moïse qui exhorte son beau-frère par les motifs les plus pressants à lui servir de guide; donc la nuée et la colonne de feu n’étaient Dieu que pour le peuple, et non pour Moïse.
Les pauvres malheureux, ravis de se voir adoptés par le Maître des Dieux au sortir d’une cruelle servitude, applaudirent à Moïse et jurèrent de lui obéir aveuglément. Son autorité étant confirmée, il voulut la rendre perpétuelle et, sous le prétexte spécieux d’établir le culte de ce Dieu, dont il se disait le Lieutenant, il fit d’abord son frère et ses enfants chefs du Palais Royal; c’est-à-dire, du lieu où il trouvait à propos de faire rendre les oracles: ce lieu était hors de la vue et de la présence du peuple. Ensuite, il fit ce qui s’est toujours pratiqué dans les nouveaux établissements, savoir des prodiges, des miracles dont les simples étaient éblouis, quelques-uns étourdis, qui faisaient pitié à ceux qui étaient pénétrants et qui lisaient au travers de ces impostures.
Quelque rusé que fût Moïse, il eût eu bien de la peine à se faire obéir s’il n’avait eu la force en main. La fourberie sans les armes réussit rarement.
Malgré le grand nombre de dupes qui se soumettaient aveuglément aux volontés de cet habile législateur, il se trouva des personnes assez hardies pour lui reprocher sa mauvaise foi, en lui disant que, sous de fausses apparences de justice et d’égalité, il s’était emparé de tout; que l’autorité souveraine étant attachée à sa famille, nul n’avait plus droit d’y prétendre, et qu’il était enfin moins le Père que le tyran du Peuple. Mais dans ces occasions, Moïse, en profond politique, perdait ces Esprits forts et n’épargnait aucun de ceux qui blâmaient son gouvernement.
C’est donc avec de pareilles précautions et en colorant toujours de la vengeance divine ses supplices qu’il régna en Despote absolu; et, pour en finir de la manière qu’il avait commencé, c’est-à-dire en fourbe et imposteur, il se précipita dans un abîme qu’il avait fait creuser au milieu d’une solitude où il se retirait de temps en temps, sous prétexte d’aller conférer secrètement avec Dieu, afin de se concilier, par là, le respect et la soumission de ses sujets. Au reste, il se jeta dans ce précipice préparé de longue main, afin que son corps ne se trouvât point et qu’on crût que Dieu l’avait enlevé pour le rendre semblable à lui; il n’ignorait pas que la mémoire des Patriarches qui l’avaient précédé était en grande vénération, quoiqu’on eût trouvé leurs sépultures, mais cela ne suffisait pas pour contenter son ambition: il fallait qu’on le révérât comme un Dieu, sur qui la mort n’a point de prise. C’est à quoi tendait, sans doute, ce qu’il duit au commencement de son règne: qu’il était établi de Dieu pour être le Dieu de Pharaon. Elie, à son exemple, Romulus Zamolxis et tous ceux qui ont eu la sotte vanité d’éterniser leurs noms, ont caché le temps de leur mort pour qu’on les crût immortels.
XI — Mais, pour revenir aux législateurs, il n’y en a point eu qui n’aient fait émaner leurs lois de quelques Divinités, et qui n’aient tâché de persuader qu’ils étaient eux-mêmes quelque chose de plus que de simples mortels. Numa Pompilius ayant goûté les douceurs de la solitude, eut peine à la quitter, quoique ce fut pour remplir le trône de Romulus, mais s’y voyant forcé par les acclamations publiques, il profita de la dévotion des Romains et leur insinua qu’il conversait avec les Dieux, qu’ainsi, s’ils le voulaient absolument pour leur Roi, ils devaient se résoudre à lui obéir aveuglément et observer religieusement les lois et les instructions divines qui lui avaient été dictées par la Nymphe Egérie.
Alexandre-le-Grand n’eut pas moins de vanité: non content de se voir le maître du monde, il voulut qu’on le crût fils de Jupiter. Persée prétendait aussi tenir sa naissance du même Dieu et de la Vierge Danaé. Platon regardait apollon comme son père, qui l’avait eu d’une vierge. Il y eut encore d’autres personnages qui eurent la même folie; sans doute que tous ces grands hommes croyaient ces rêveries fondées sur l’opinion des Egyptiens qui soutenaient que l’esprit de Dieu pouvait avoir commerce avec une femme et la rendre féconde.
De Jésus-Christ, XII ⮵
Jésus-Christ, qui n’ignorait ni les maximes ni la science des Egyptiens, donna cours à cette opinion; il la crut propre à son dessein. Considérant combien Moïse s’était rendu célèbre, quoiqu’il n’eût commandé qu’un peuple d’ignorants, il entreprit de bâtir sur ce fondement et se fit suivre par quelques imbéciles auxquels il persuada que le Saint-Esprit était son père, et sa mère une Vierge. Ces bonnes gens, accoutumés à se payer de songes et de rêveries, adoptèrent ces notions et crurent tout ce qu’il voulut, d’autant plus qu’une pareille naissance n’était pas véritablement quelque chose de trop merveilleux pour eux.
Être donc né d’une Vierge par l’opération du Saint-Esprit, n’est pas plus extraordinaire ni plus miraculeux que ce que content les tartares de leur Gengiskan, dont une Vierge fut aussi la mère; les Chinois disent que le Dieu Foé devait le jour à une Vierge rendu féconde par les rayons du Soleil.
Ce prodige arriva dans un temps où les Juifs, lassés de leur Dieu, comme ils l’avaient été de leurs Juges en voulaient avoir un visible comme les autres nations. Comme le nombre des sots est infini, Jésus-Christ trouva des sujets partout, mais comme son extrême pauvreté était un obstacle invincible à son élévation, les Pharisiens, tantôt ses admirateurs, tantôt jaloux de son audace, le déprimaient ou l’élevaient selon l’humeur inconstante de la populace. Le bruit courut de sa Divinité, mais, dénué de forces comme il était, il était impossible que son dessein réussît. Quelques malades qu’il guérit, quelques prétendus morts qu’il ressuscita, lui donnèrent de la vogue; mais n’ayant ni argent, ni armée, il ne pouvait manquer de périr. S’il eût eu ces deux moyens, il n’eût pas moins réussi que Moïse et Mahomet, ou que tous ceux qui ont eu l’ambition de s’élever au-dessus des autres. S’il a été plus malheureux, il n’a pas été moins adroit et quelques endroits de son histoire prouvent que le plus grand défaut de sa politique a été de n’avoir pas assez pourvu à sa sûreté. Du reste, je ne trouve pas qu’il ait plus mal pris ses mesures que les deux autres; sa loi est au moins devenue la règle de la croyance des Peuples qui se flattent d’être les plus sages du monde.
XIII — De la politique de Jésus-Christ. Est-il rien, par exemple, de plus subtil que la réponse de Jésus au sujet de la femme surprise en adultère? Les juifs lui ayant demandé s’ils lapideraient cette femme, au lieu de répondre positivement à la question, ce qui l’aurait fait tomber dans le piège que ses ennemis lui tendaient, la négative étant directement contre la loi et l’affirmative le convaincant de rigueur et de cruauté, ce qui lui eut aliéné les esprits: au lieu, dis-je de répartir comme eût fait un homme ordinaire, que celui, dit-il, d’entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Réponse adroite et qui montre bien la présence de son esprit. Une autre fois, interrogé s’il était permis de payer le tribut de César et voyant l’image du Prince sur la pièce qu’on lui montrait, il éluda la difficulté en répondant qu’on eût à rendre à César ce qui appartenait à César. La difficulté consistait en ce qu’il se rendait criminel de lèse-majesté, s’il niait que cela fût permis, et qu’en disant qu’il le fallait payer, il renversait la loi de Moïse, ce qu’il protesta ne vouloir jamais faire, lorsqu’il se crut sans doute trop faible pour le faire impunément, car, quand il se fut rendu plus célèbre, il la renversa presque totalement. Il fit comme ces Princes qui promettent toujours de confirmer les privilèges de leurs sujets, pendant que la puissance n’est pas encore établie, mais qui, dans la suite, ne s’embarrassent point de tenir leurs promesses.
Quand les Pharisiens lui demandèrent de quelle autorité il se mêlait de prêcher et d’enseigner le peuple, Jésus-Christ, pénétrant leur dessein, qui ne tendait qu’à le convaincre de mensonge, soit qu’il répondit que c’était par une autorité humaine, parce qu’il n’était point du Corps Sacerdotal, qui seul était chargé de l’instruction du peuple; soit qu’il se vantât de prêcher par l’ordre exprès de Dieu, sa doctrine étant opposée à la Loi de Moïse; ils e tira d’affaire en les embarrassant eux-mêmes et en leur demandant au nom de qui Jean avait été baptisé?
Les Pharisiens, qui s’opposaient par politique au baptême de Jean, se fussent condamnés eux-mêmes en avouant que c’était au nom de Dieu. S’ils ne l’avouaient pas, ils s’exposaient à la rage de la populace, qui croyait le contraire. Pour sortir de ce mauvais pas, ils répondirent qu’ils n’en savaient rien, à quoi Jésus-Christ répondit qu’il n’était pas obligé de leur dire pourquoi et au nom de qui il prêchait.
XIV — Telles étaient les défaites du destructeur de l’ancienne Loi et du père de la nouvelle religion, qui fut bâtie sur les ruines de l’ancienne, où un esprit désintéressé ne voit rien de plus divin que dans les religions qui l’ont précédé. Son fondateur, qui n’était pas tout à fait ignorant, voyant l’extrême corruption de la république des Juifs, la jugea proche de sa fin et crut qu’une autre devait renaître de ses cendres.
La crainte d’être prévenu par des hommes plus adroits que lui, le fit hâter de s’établir par des moyens opposés à ceux de Moïse. Celui-ci commença par se rendre terrible et formidable aux autres nations; Jésus-Christ, au contraire, les attira à lui par l’espérance des avantages d’une autre vie que l’on obtiendrait, disait-il, en croyant en lui; tandis que Moïse ne promettait que des biens temporels aux observateurs de sa Loi, Jésus-Christ en fit espérer qui ne finiraient jamais. Les lois de l’un ne regardaient que l’extérieur, celles de l’autre vont jusqu’à l’intérieur, influent sur les pensées et prennent en tout le contre-pied de la loi de Moïse. D’ù il s’ensuit que Jésus-Christ crut, avec Aristote, qu’il en est de la Religion et des Etats comme de tous les individus qui s’engendrent et qui se corrompent. Et comme il ne se fait rien que de ce qui s’est corrompu, nulle Loi ne cède à l’autre qui ne lui soit toute opposée. Or, comme on a de peine à se résoudre de passer d’une loi à une autre et comme la plupart des esprits sont difficiles à ébranler en matière de religion, Jésus-Christ, à l’imitation des autres novateurs, eut recours aux miracles qui ont toujours été l’écueil des ignorants et l’asile des ambitieux adroits.
XV — Par ce moyen, le Christianisme étant fondé, Jésus-Christ songea habilement à profiter des erreurs de la politique de Moïse et à rendre la Nouvelle Loi éternelle; entreprise qui lui réussit au-delà, peut-être, de ses espérances. Les prophètes Hébreux pensaient faire honneur à Moïse en prédisant un successeur qui lui ressemblerait; c’est-à-dire un Messie grand en vertus, puissant en biens et terrible à ses ennemis. Cependant, leurs Prophéties ont produit un effet tout contraire, quantité d’ambitieux ayant pris de là occasion de se faire passer pour le Messie annoncé, ce qui causa des révoltes qui ont duré jusqu’à l’entière destruction de l’ancienne République des Hébreux. Jésus-Christ, plus habile que les prophètes Mosaïques, pour discrédit et d’avance ceux qui s’élèveraient contre lui, a prédit qu’un tel homme serait le grand ennemi de Dieu, le favori des Démons, l’assemblage de tous les vices et la désolation du monde.
Après de si beaux éloges, il paraît que personne ne doit être tenté de se dire l’Antéchrist, et je ne crois pas qu’on puisse trouver de meilleur secret pour éterniser une loi, quoiqu’il n’y ait rien de plus fabuleux de tout ce qu’on a débité de cet Antéchrist prétendu. Saint Paul disait, de son vivant, qu’il était déjà né, par conséquent, qu’on était à la veille de l’avènement de Jésus-Christ; cependant, il y a plus de 1660 ans d’écoulés depuis la prédiction de la naissance de ce formidable personnage, sans que personne en ait ouï parler. J’avoue que quelques-uns ont appliqué ces paroles à Ebiron et à Cérinthus, deux grands ennemis de Jésus-Christ, dont ils combattirent la prétendue Divinité; mais on peut dire aussi que si cette interprétation est conforme au sens de l’Apôtre, ce qui n’est nullement croyable, ces paroles désignent dans tous les siècles une infinité d’Antéchrists, n’y ayant point de vrais savants qui croient blesser la vérité en disant que l’histoire de Jésus-Christ est une fable méprisable et que sa loi n’est qu’un tissue de rêveries que l’ignorance a mis en vogue, que l’intérêt entretient, et que la tyrannie protège.
XVI — On prétend néanmoins qu’une religion établie sur des fondements si faibles, est divine et surnaturelle, comme si on ne savait pas qu’il n’y a point de gens plus propres à donner cours aux plus absurdes opinions que les femmes et les sots; Il n’est donc pas merveilleux que Jésus-Christ n’eût pas de savant à sa suite, il savait bien que sa Loi ne pouvait s’accorder avec le bon sens; voilà, sans doute, pourquoi il déclamait si souvent contre les sages, qu’il exclut de son Royaume, où il n’admet que les pauvres d’esprit, les simples et les imbéciles: les esprits raisonnables doivent se consoler de n’avoir rien à démêler avec les insensés.
XVII — Quant à la morale de Jésus-Christ, on n’y voit rien de divin qui la doive faire préférer aux écrits des anciens, ou plutôt tout ce qu’on y voit en est tiré ou imité. Saint Augustin avoue qu’il a trouvé dans quelques-uns de leurs récits tout le commencement de l’Evangile selon saint Jean: ajoutez à cela que l’on remarque que cet Apôtre était tellement accoutumé à piller les autres qu’il n’a point fait difficulté de dérober aux Prophètes leurs énigmes et leurs visions, pour en composer son Apocalypse. D’où vient, par exemple, la conformité qui se trouve entre la doctrine du Vieux ou du Nouveau Testament, et les écrits de Platon, sinon de ce que les rabbins, et ceux qui ont composé les écritures, ont pillé ce grand homme? La naissance du monde a plus de vraisemblable dans son Timée, que dans le livre de la Genèse; cependant on ne peut pas dire que cela vienne de ce que Platon aura lu dans son voyage d’Egypte des livres Judaïques, puisqu’au rapport de saint Augustin, le Roi Ptolémée ne les avait pas encore fait traduire quand ce Philosophe y voyagea.
La description du pays que Socrate fait à Simias dans le Phedon, a infiniment plus de grâce que le Paradis terrestre; et la fable des Androgynes est sans comparaison mieux trouvée que tout ce que nous apprenons de la Genèse au sujet de l’extraction de l’une des côtes d’Adam pour en former la femme, etc. Y a-t-il encore rien qui ait plus de rapport aux deux embrasements de Sodome et de Gomorrhe que celui que causa Phaëton? Y a-t-il rien de plus conforme que la chute de Lucifer et celle de Vulcain, ou celles des Géants abîmés par la foudre de Jupiter? Quelles choses se ressemblent mieux que Samson et hercule, Elie et Phaëton, Joseph et Hypolite, Nabuchodonosor et Lycaon, Tantale et le mauvais riche, la Manne des Israëlites et l’Ambroisie des Dieux? Saint Augustin, saint Cyrille et Théophilacte comparent Jonas à Hercule, surnommé Trinoctius, parce qu’il fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la Baleine.
Le fleuve de Daniel, représenté au Chapitre VII de ses Prophéties, est une imitation visible du Pyriphlégéton, dont il est parlé au dialogue de l’immortalité de l’âme. On a tiré le péché originel de la boîte de Pandore, le Sacrifice d’Isaac et de Jephté de celui d’Iphigénie, en la place de laquelle une biche fut substituée. Ce qu’on rapporte de Loth et de sa femme est tout à fait conforme à ce que la fable nos apprend de Baucis et de Philémon; l’histoire de Bellérophon est le fondement de cette de saint Michel et du démon qu’il vainquit; enfin il est constant que les auteurs de l’Ecriture ont transcrit presque mot à mot les œuvres d’Hésiode et d’Homère.
XVIII — Quant à Jésus-Christ, Celse montrait, au rapport d’Origène qu’il avait tiré de Platon ses plus belles sentences. Telle est celle qui porte qu’un chameau passerait plutôt par le trou d’une aiguille, qu’il n’est aisé à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. C’est à la secte des Pharisiens, dont il était, que ceux qui croient en lui doivent la croyance qu’ils ont de l’immortalité de l’âme, de la résurrection, de l’enfer, et la plus grande partie de sa morale, où je ne vois rien qui ne soit dans celle d’Epictète, d’Epicure et de quantité d’autres; ce dernier était cité par saint Jérôme comme un homme dont la vertu faisait honte aux meilleurs chrétiens et dont la vie était si tempérante, que ses meilleurs repas n’étaient qu’un peu de fromage, du pain et de l’eau. Avec une vie si frugale, ce philosophe, tout païen qu’il était, disait qu’il valait mieux être infortuné et raisonnable que d’être riche et opulent sans avoir de raison; ajoutant qu’il est rare que la fortune et la sagesse se trouvent réunies sous un même sujet et qu’on ne saurait être heureux ni vivre satisfait qu’autant que notre félicité est accompagnée de prudence, de justice et d’honnêteté, qui sont les qualités d’où résulte la vraie et la solide volupté.
Pour Epictète, je ne crois pas que jamais aucun homme, sans excepter Jésus-Christ, ait été plus ferme, plus austère, plus égal et ait eu une morale pratique plus sublime que la sienne. Je ne dis rien qu’il ne me fut aisé de prouver si s’en était ici le lieu, mais de peur de passer les bornes que je me suis prescrites, je ne rapporterai, des belles actions de sa vie, qu’un seul exemple. Etant esclave d’un affranchi, nommé Epaphrodite, Capitaine des Gardes de Néron, il prit fantaisie à ce brutal de lui tordre la jambe. Epictète, s’apercevant qu’il y prenait plaisir, lui dit en souriant qu’il voyait bien qu’il ne finirait pas qu’il ne lui eût casé la jambe; ce qui arriva comme il l’avait prédit. Eh bien ! continua-t-il d’un visage égal et riant, ne vous avais-je pas bien dit que vous me casseriez la jambe? Y eût-il jamais de constance pareille à celle-là? Et peut-on dire que Jésus-Christ ait été jusque-là, lui qui pleurait et suait de peur à la moindre alarme qu’on lui donnait et qui témoigna, près de mourir, une pusillanimité tout à fait méprisable et que l’on ne vit point chez les martyrs.
Si l’injure des temps ne nous eut pas ravi le livre qu’Arrien avait fait de la vie et de la mort de notre philosophe, je suis persuadé que nous verrions bien d’autres exemples de sa patience. Je ne doute pas qu’on ne dise de cette action ce que les prêtres disent des vertus des Philosophes, que c’est une vertu dont la vanité est la base et qui n’est point en effet ce qu’elle paraît. Mais je sais bien que disent en chaire tout ce qui leur vient à la bouche et croient avoir bien gagné l’argent qu’on leur donne pour instruire le peuple, quand ils ont déclamé contre les seuls hommes qui sachent ce que c’est que la droite raison et la véritable vertu; tant il est vrai que rien au monde n’approche si peu des mœurs des vrais sages que les actions de ces hommes superstitieux qui les décrient; ceux-ci semblent n’avoir étudié que pour parvenir à un poste qui leur donne du pain, ils sont vains et s’applaudissent quand ils l’ont obtenu, comme s’ils étaient parvenus à un état de perfection, bien qu’il ne soit pour ceux qui obtiennent qu’un état d’oisiveté, d’orgueil, de licence et de volupté, où la plupart ne suivent rien moins que les maximes de la Religion qu’ils professent. Mais laissons-là des gens qui n’ont aucune idée de la vertu réelle, pour examiner la Divinité de leur Maître.
XIX — Après avoir examiné la politique et la morale du Christ, où l’on ne trouve rien d’aussi utile et d’aussi sublime que dans les écrits des anciens Philosophes, voyons si la réputation qu’il s’est acquise après sa mort est une preuve de sa Divinité: le peuple est si accoutumé à la déraison, que je m’étonne qu’on prétende tirer aucune conséquence de sa conduite; l’expérience nous prouve qu’il court toujours après des fantômes et qu’il ne fait et ne dit rien qui marque du bon sens. Cependant, c’est sur de pareilles chimères, qui ont été de tout temps en vogue, malgré les efforts des savants qui s’y sont toujours opposés, que l’on fonde sa croyance. Quelques soins qu’ils aient pris pour déraciner les folies régnantes, le Peuple ne les a quittées qu’après en avoir été rassasié.
Moïse eut beau se vanter d’être l’interprète de Dieu et prouver sa mission et ses droits par des signes extraordinaires, pour peu qu’il s’absentât (ce qu’il faisait de temps à autre pour conférer, disait-il, avec Dieu et ce qui firent pareillement Numa Pompilius et plusieurs autres législateurs) pour peu, dis-je, qu’il s’absentât, il ne trouvait à son retour que les traces du culte des Dieux que les Hébreux avaient vus en Egypte. Il eut beau les tenir 40 ans dans un désert pour leur faire perdre l’idée des Dieux qu’ils avaient quittés; ils ne les avaient de visibles qui marchassent devant eux, ils les adoraient opiniâtrement, quelque cruauté qu’on leur fit éprouver.
La seule haine qu’on leur inspira pour les autres nations, par un orgueil dont les plus idiots sont capables, leur fit perdre insensiblement le souvenir des Dieux d’Egypte, pour s’attacher à celui de Moïse; on l’adora quelque temps avec toutes les circonstances marquées dans la Loi, mais on le quitta par la suite pour suivre celle de Jésus-Christ, par cette inconstance qui fait courir après la nouveauté.
XX — Les plus ignorants des Hébreux avaient adopté la loi de Moïse; ce furent aussi de pareilles gens qui coururent après Jésus et comme le nombre en est infini et qu’ils s’aiment les uns les autres, on ne doit pas s’étonner si ces nouvelles erreurs se répandirent aisément. Ce n’est pas que les nouveautés ne soient dangereuses pour ceux qui les embrassent, mais l’enthousiasme qu’elles excitent anéantit la crainte. Ainsi les disciples de Jésus-Christ, tout misérables qu’ils étaient à sa suite, et tous mourant de faim (comme on le voit par la nécessité où ils furent un jour, avec leur conducteur, d’arracher des Epis dans les Champs pour se nourrir) les disciples de Jésus-Christ, dis-je, ne commencèrent à se décourager que lorsqu’ils virent leur maître entre les mains des bourreaux et hors d’état de leur donner les biens la puissance et la grandeur qu’il leur avait fait espérer.
Après sa mort, ses disciples, au désespoir de se voir frustrés de leurs espérances, firent de nécessité vertu. Bannis de tous les lieux et poursuivis par les Juifs qui les voulaient traiter comme leur maître, ils se répandirent dans les contrées voisines, où, sur le rapport de quelques femmes, ils débitèrent sa résurrection, sa filiation divine et le reste des fables dont les Evangiles sont si remplis.
La peine qu’ils avaient à réussir parmi les Juifs les fit résoudre à chercher fortune parmi des étrangers, mais comme il fallait plus de science qu’ils n’en avaient, les Gentils étant philosophes, et par conséquent trop amis de la raison pour se rendre à des bagatelles, les sectateurs de jésus gagnèrent un jeune homme d’un esprit bouillant et actif; un peu mieux instruit que les pêcheurs sans lettres, ou plus capable de faire écouter son babil. Celui-ci, s’associant avec eux par un coup du Ciel (car il fallait du merveilleux) attira quelques partisans à la secte naissante par la crainte des prétendues peines d’un Enfer, imité des fables des anciens Poètes, et par l’espérance des joies du Paradis, où il eut l’impudence de faire dire qu’il avait été enlevé.
Ces disciples, à force de prestiges et de mensonges, procurèrent à leur maître l’honneur de passer pour un Dieu, honneur auquel Jésus, de son vivant, n’avait pu parvenir. Son sort ne fut pas meilleur que celui d’Homère, ni même si honorable, puisque six des villes qui avaient chassé et méprisé ce dernier pendant sa vie, se firent la guerre pour savoir à qui resterait l’honneur de lui avoir donné le jour.
XXI — On peut juger par tout ce que nous avons dit que le christianisme n’est, comme toutes les autres religions, qu’une imposture grossièrement tissue, dont le succès et les progrès étonneraient même ses inventeurs s’ils revenaient au monde; mais, sans nous engager plus avant dans un labyrinthe d’erreurs et de contradictions visibles dont nous avons assez parlé, disons quelque chose de Mahomet, lequel a fondé une loi sur des maximes toutes opposées à celles de Jésus-Christ.
De Mahomet, XXII ⮵
A peine les disciples du Christ avaient éteint la Loi Mosaïque, pour introduire la Loi Chrétienne, que les hommes, entraînés par leur inconstance ordinaire, suivirent un nouveau législateur, qui s’éleva par les mêmes voies que Moïse. Il prit comme lui le titre de Prophète et de l’Envoyé de Dieu; comme lui, il fit des miracles et sut mettre à profit les passions du peuple. D’abord, il se vit escorté d’une populace ignorante, à laquelle il exprimait les nouveaux oracles du Ciel. Ces misérables, séduits par les promesses et les fables de ce nouvel imposteur, répandirent sa renommée et l’exaltèrent au point d’éclipser celle de ses prédécesseurs.
Mahomet n’était pas un homme qui parut propre à fonder un Empire, il n’excellait ni en politique, ni en philosophie; il ne savait ni lire ni écrire. Il avait même si peu de fermeté qu’il eût été forcé à soutenir la gageure par l’adresse d’un de ses spectateurs. Dès qu’il commença à s’élever et à devenir célèbre; Corais, puissant Arabe, jaloux qu’un homme de néant eut l’audace d’abuser le peuple, se déclara son ennemi et traversa son entreprise, mais le peuple, persuadé que Mahomet avait des conférences continuelles avec Dieu et ses anges, fit qu’il l’emporta sur son ennemi. La famille de Corais eut le dessous et Mahomet, se voyant suivi d’une foule imbécile qui le croyait un homme divin, crut n’avoir plus besoin de son compagnon; mais de peur que celui-ci ne découvrit ses impostures, il voulut le prévenir, et pour le faire plus sûrement, il l’accabla de promesses et lui jura qu’il ne voulait devenir grand que pour partager avec lui son pouvoir, auquel il avait tant contribué. « Nous touchons, dit-il au temps de notre élévation, nous sommes sûr d’un grand peuple que nous avons gagné, il s’agit de nous assurer de lui par l’artifice que vous avez si heureusement imaginé ». En même temps, il lui persuada de se cacher dans la fosse des Oracles.
C’était un puits d’où il parlait pour faire croire au Peuple que la voix de Dieu se déclarait pour Mahomet, qui était au milieu de ses prosélytes. Trompé par les caresse de ce perfide, son associé alla dans la fosse contrefaite l’Oracle à son ordinaire; Mahomet, passant alors à la tête d’une multitude infatuée, on entendit une voix qui disait: « Moi, je suis votre dieu, je déclare que j’ai établi Mahomet pour être le Prophète de toutes les nations; ce sera de lui que vous apprendrez ma véritable loi, que les Juifs et les Chrétiens ont altérée ». Il y avait longtemps que cet homme jouait ce rôle, mais enfin il fut payé par la plus grande et la plus noire ingratitude. En effet, Mahomet, entendant la voix qui le proclamait un homme divin, se tournant vers le peuple, lui commanda, au nom de ce Dieu qui le reconnaissait pour son Prophète, de combler de pierres cette fosse, d’où était sorti en sa faveur un témoignage si authentique, en mémoire de la pierre que Jacob éleva pour marquer le lieu où Dieu lui était apparu. Ainsi périt le misérable qui avait contribué à l’élévation de Mahomet; ce fut sur cet amas de pierre que le dernier des plus célèbres imposteurs a établi sa loi. Ce fondement est si solide et fixé de telle sorte qu’après plus de mille ans de règne, on ne voit pas encore d’apparence qu’il soit sur le point d’être ébranlé.
XXIII — Ainsi Mahomet s’éleva et fut plus heureux que Jésus, en ce qu’il vit avant sa mort le progrès de sa loi, ce que le fils de Marie ne put faire à cause de sa pauvreté. Il fut même plus heureux que Moïse, qui, par un excès d’ambition, se précipita lui-même pour finir ses jours. Mahomet mourut en paix et au comble de ses souhaits, il avait de plus quelque certitude que sa Doctrine subsisterait après sa mort, l’ayant accommodée au génie de ses sectateurs, nés et élevés dans l’ignorance; ce qu’un homme plus habile n’eût peut-être pu faire.
Voilà, Lecteur, ce qu’on peut dire de plus remarquable touchant les trois célèbres Législateurs dont les religions ont subjugué une grande partie de l’univers. Ils étaient tels que nous les avons dépeints; c’est à vous d’examiner s’ils méritent que vous les respectiez et si vous êtes excusables de vous laisser conduire par des guides que la seule ambition a élevés et dont l’ignorance éternise les rêveries. Pour vous guérir des erreurs dont ils vous ont aveuglés, lisez ce qui suit avec un esprit libre et désintéressé, ce sera le moyen de découvrir la vérité.
Chapitre IV. Vérités sensibles et évidentes ⮵
Idée de l’être universel. Les attributs qu’on lui donne dans toutes les religions sont, pour la plupart incompatibles avec son essence et ne conviennent qu’à l’homme. Opinion d’une vie à venir et de l’existence des esprits combattue et rejetée.
Moïse, Jésus et Mahomet étant tels que nous venons de les peindre, il est évident que ce n’est point dans leurs écrits qu’il faut chercher une véritable idée de la Divinité. Les apparitions et les conférences de Moïse et de Mahomet, de même que l’origine divine de jésus, sont les plus grandes impostures qu’on ait pu mettre au jour et que vous devez fuir si vous aimez la vérité.
II — Dieu n’étant, comme on a vu, que la nature, ou, si l’on veut, l’assemblage de tous les êtres, de toutes les propriétés et de toutes les énergies, est nécessairement la cause immanente et non distincte de ses effets; il ne peut être appelé ni bon, ni méchant, ni juste, ni miséricordieux, ni jaloux; ce sont des qualités qui ne conviennent qu’à l’homme; par conséquent, il ne saurait ni punir ni récompenser. Cette idée de punitions et de récompenses ne peut séduire que des ignorants, qui ne conçoivent l’Être simple, qu’on nomme Dieu, que sous des images qui ne lui conviennent nullement. Ceux qui se servent de leur jugement, sans confondre ses opérations avec celles de l’imagination, et qui ont la force de se défaire des préjugés de l’enfance, sont les seuls qui s’en fassent une idée claire et distincte. Ils l’envisagent comme la source de tous les Etes, qui les produit sans distinction, les uns n’étant pas préférables aux autres à son égard et l’homme ne lui coûtant pas plus à produire que le plus petit vermisseau ou la moindre plante.
III — Il ne faut donc pas croire que l’Être universel, qu’on nomme communément Dieu, fasse plus de cas d’un homme que d’une fourmi, d’un lion plus que d’une pierre. Il n’y a rien à son égard de beau ou de laid, de bon ou de mauvais, de parfait ou d’imparfait. Il ne s’embarrasse point d’être loué, prié, recherché, caressé; il n’est point ému de que les hommes font ou disent, il n’est susceptible ni d’amour ni de haine; en un mot, il ne s’occupe pas plus de l’homme que du reste des créatures, de quelque nature qu’elles soient. Toutes ces distinctions ne sont que des inventions d’un esprit borné; l’ignorance les imagina et l’intérêt les fomente.
IV — Ainsi, tout homme sensé ne peut croire ni Dieu, ni Enfer, ni Esprit, ni Diables, de la manière qu’on en parle communément. Tous ces grands mots n’ont été forgés que pour éblouir ou intimider le vulgaire. Que ceux donc qui veulent se convaincre encore mieux de cette vérité prêtent une sérieuse attention à ce qui suit et s’accoutument à ne porter des jugements qu’après de mûres réflexions.
V — Une infinité d’astres que nous voyons au-dessus de nous, on fait admettre autant de corps solides où ils se meuvent, parmi lesquels il y en a un destiné à la Cour céleste, où Dieu se tient comme un roi au milieu de ses courtisans. Ce lieu est le séjour des Bienheureux, où l’on suppose que les bonnes âmes vont se rendre en quittant le corps. Mais, sans nous arrêter à une opinion si frivole et que nul homme de bon sens ne peut admettre, il est certain que ce que l’on appelle Ciel, n’est autre chose que la continuation de l’air qui nous environne, fluide dans lequel les planètes se meuvent, sans être soutenues par aucune masse solide, de même que la terre que nous habitions.
VI — Comme l’on a imaginé un Ciel, dont on a fait le séjour de Dieu et des bienheureux, ou, suivant les Païens, des Dieux et des Déesses, on s’est depuis figuré un Enfer, ou lieu souterrain, où l’on assure que les âmes des méchants descendent pour y être tourmentées. Mais ce mot d’Enfer, dans sa signification naturelle, n’exprime autre chose qu’un lieu bas et creux, que les poètes ont inventé pour opposer à la demeure des habitants célestes, qu’ils ont supposée haute et élevée. Voilà ce que signifient exactement les mots infernus ou inferni des Latins, ou celui des Grecs, qui entendent un lieu profond et redoutable par son obscurité. Tout ce qu’on en dit n’est que l’effet de l’imagination des Poètes et de la fourberie des Prêtres; tous les discours des premiers sont figurés et propres à faire impression sur des esprits faibles, timides et mélancoliques; ils furent changés en article de foi par ceux qui ont le plus grand intérêt à soutenir cette opinion.
Chapitre V. De l’âme ⮵
Opinions différentes des philosophes de l’antiquité sur la nature de l’âme. Sentiment de Descartes réfuté. Exposition de celui de l’auteur.
L’âme est quelque chose de plus délicat à traiter que ne sont le Ciel et l’Enfer; il est donc à propos, pour satisfaire la curiosité du lecteur, d’en parler avec plus d’étendue. Mais avant que de la définir, il faut exposer ce qu’en ont pensé les plus célèbres philosophes; je ne ferai en plus de mots, afin qu’on le retienne avec plus de facilité.
II — Les uns ont prétendu que l’âme est un Esprit, ou une substance immatérielle; d’autres ont soutenu que c’est une portion de la Divinité; quelques-uns en font un air très subtil; d’autres disent que c’est une harmonie de toutes les parties du corps; enfin, d’autres, que c’est la plus subtile partie du sang, qui s’en sépare dans le cerveau et se distribue par les nerfs. Cela posé, la source de l’âme est le cœur où elle s’engendre et le lieu où elle exerce ses plus nobles fonctions est le cerveau, vu qu’elle y est plus épurée des parties grossières du sang. Voilà quelles sont les opinions diverses que l’on s’est faites sur l’âme. Cependant, pour les mieux développer, divisons-les en deux classes. Dans l’une, seront les philosophies qui l’ont cru corporelle; dans l’autre, ceux qui l’ont regardée comme incorporelle.
III — Pythagore et Platon ont avancé que l’âme était incorporelle, c’est-à-dire, un être capable de subsister sans l’aide du corps et qui peut se mouvoir de lui-même. Ils prétendent que toutes les âmes particulières des animaux sont des portions de l’âme universelle du monde, que ces portions sont incorporelles et immortelles, ou de la même nature qu’elle, comme l’on conçoit fort bien que cent petits feux sont de même nature qu’un grand feu d’où ils ont été pris.
IV — Ces philosophes ont cru que l’univers était animé par une substance immatérielle, immortelle et invisible, qui fait tout, qui agit toujours, et qui est la cause de tout mouvement, et la source de toutes les âmes, qui en sont des émanations. Or, comme ces âmes, sont très pures et d’une nature infiniment supérieure au corps, elles ne s’unissent pas, disent-ils, immédiatement, mais par le moyen d’un corps subtil comme la flamme, ou cet air subtil et étendu que le vulgaire prend pour le Ciel. Ensuite, elles prennent un corps encore subtil, puis un autre un peu moins grossier, et toujours ainsi par degrés, jusqu’à ce qu’elles puissent s’unir aux corps sensibles des animaux où elles descendent comme dans des cachots ou des sépulcres La mort du corps, selon eux, est la vie de l’âme, qui s’y trouvait comme ensevelie, et où elle n’exerçait que faiblement ses plus nobles fonctions; ainsi, par la mort du corps, l’âme sort de sa prison, se débarrasse de la matière, et se réunit à l’âme du monde dont elle était émanée.
Ainsi, suivant cette opinion, toutes les âmes des animaux sont de même nature, et la diversité de leurs fonctions ou facultés ne vient que de la différence des corps où elles entrent.
Aristote admet une intelligence universelle commune à tous les êtres et qui fait à l’égard des intelligences particulières ce que fait la lumière à l’égard des yeux; et comme la lumière rend les objets visibles, l’entendement universel rend ces objets intelligibles.
Ce Philosophe définit l’âme ce qui nous fait vivre, sentir, concevoir et mouvoir; mais il ne dit point quel est cet Être, qui est la source et le principe de ces nobles fonctions, et par conséquent ce n’est point chez lui qu’il faut chercher l’éclaircissement des doutes que l’on a sur la nature de l’âme.
V — Dicéarque, Asclépiade, et Galien à quelques égards, ont aussi cru que l’âme était incorporelle, mais d’une autre manière; car ils ont dit que l’âme n’est autre chose que l’harmonie de toutes les parties du corps, c’est-à-dire, ce qui résulte d’un mélange exact des éléments et de la disposition des parties, des humeurs et des esprits. Ainsi, disent-ils, comme la santé n’est point une partie de celui qui se porte bien, quoi qu’elle soit en lui, de même, quoique l’âme soit dans l’animal, ce n’est point une de ses parties, mais l’accord de toutes celles dont il est composé.
Sur quoi il est à remarquer que ces auteurs croient l’âme incorporelle, sur un principe tout opposé à leur intention; car, dire qu’elle n’est point un corps, mais seulement quelque chose d’inséparablement attaché au corps, c’est dire qu’elle est corporelle, puisqu’on appelle corporel non seulement ce qui est corps, mais tout ce qui est forme ou accident, ou ce qui ne peut être séparé de la matière.
Voilà les philosophes qui soutiennent que l’âme est incorporelle ou immatérielle; on voit qu’ils ne sont pas d’accord avec eux-mêmes, et par conséquent qu’ils ne méritent pas d’être crus. Passons à ceux qui ont avoué qu’elle est corporelle ou matérielle.
VI — Diogène a cru que l’âme est composée d’air, d’où il a dérivé la nécessité de respirer, et il la définit un air qui passe de la bouche par les poumons dans le cœur, où il s’échauffe, et d’où il se distribue ensuite dans tout le corps.
Leucippe et Démocrite ont dit qu’elle était de feu et que, comme le feu, elle était composée d’atomes, qui pénètrent aisément toutes les parties du corps et qui le font mouvoir.
Hippocrate a dit qu’elle était composée d’eau et de feu; Empédocle de quatre éléments. Epicure a cru, comme Démocrite, que l’âme est composée de feu, mais il ajoute que dans cette composition il entre de l’air, ne vapeur, et une autre substance qui n’a point de nom, et qui est le principe du sentiment; que, de ces quatre substances différentes, il se fait un esprit très subtil, qui se répand par tout le corps et qui doit s’appeler l’âme.
Descartes soutient aussi, mais pitoyablement, que l’âme n’est point matérielle; je dis pitoyablement, car jamais philosophe ne raisonna si mal sur ce sujet que ce grand homme; et voici de quelle façon il s’y prend. D’abord, il dit qu’il faut douter de l’existence de son corps; croire qu’il n’y en a point; puis raisonner de cette manière: Il n’y a point de corps; je suis pourtant, donc je ne suis pas un corps; par conséquent, je ne puis être qu’une substance qui pense. Quoique ce beau raisonnement se détruise assez de lui-même, je dirai néanmoins en deux mots quel est mon sentiment.
1° Ce doute que M. Descartes propose est totalement impossible, car quoi qu’on pense quelque fois ne point penser qu’il y ait des corps, il est vrai néanmoins qu’il y en a quand on y pense.
2° Quiconque croit qu’il n’y a point de corps doit être assuré qu’il n’en est pas un, nul ne pouvant douter de soi-même, ou, s’il en est assuré, son doute est donc inutile.
3° Lorsqu’il dit que l’âme est une substance qui pense, il ne nous apprend rien de nouveau. Chacun en convient, mais la difficulté est de déterminer ce que c’est que cette substance qui pense, et c’est ce qu’il ne fait pas plus que les autres.
VII — Pour ne point biaiser comme il a fait et pour avoir la plus saine idée qu’on puisse se former de l’âme de tous les animaux, sans en excepter l’homme qui est de la même nature et qui n’exerce des fonctions différentes que par la diversité seule des organes et des humeurs, il faut faire attention à ce qui suit.
Il est certain qu’il y a dans l’univers un fluide très subtil ou une matière très déliée et toujours en mouvement, dont la source est dans le soleil; le reste est répandu dans les autres corps, plus ou moins, selon leur nature ou leur consistance. Voilà ce que c’est que l’âme du monde; voilà ce qui le gouverne et le vivifie et dont quelque portion est distribuée à toutes les parties qui le composent.
Cette âme est le feu le plus pur qui soit dans l’univers. Il ne brûle pas de soi-même, mais par différents mouvements qu’il donne aux particules des autres corps où il entre, il brûle et fait ressentir sa chaleur. Le feu visible contient plus de cette matière que l’air, celui-ci que l’eau, et la terre en a beaucoup moins; les plantes en ont plus que les minéraux, et les animaux encore davantage. Enfin, ce feu renfermé dans le corps le rend capable des sentiments et c’est ce qu’on appelle l’âme, ou ce qu’on nomme les esprits animaux, qui se répandent dans toutes les parties du corps. Or, il est certain que cette âme, étant de même nature dans tous les animaux, se dissipe à la mort de l’homme, ainsi qu’à celle des bêtes. D’où il suit que ce que les Poètes et les Théologiens nous disent de l’autre monde est une chimère qu’ils ont enfantée et débitée pour des raisons qu’il est aisé de deviner.
Chapitre VI. Des esprits qu’on nomme Démons ⮵
Origine et fausseté de l’opinion qu’on a de leur existence.
Nous avons dit ailleurs comment la notion des Esprits s’est introduite parmi les hommes et nous avons fait voir que ces Esprits n’étaient que des fantômes qui n’existaient que dans leur propre imagination.
Les premiers docteurs du genre humain n’étaient pas assez éclairés pour expliquer au peuple ce que c’était que ces fantômes, mais ils ne laissaient pas de lui dire ce qu’ils en pensaient. Les uns, voyant que les Fantômes se dissipaient et n’avaient nulle consistance, les appelaient immatériels, incorporels, des formes sans matière, des couleurs et des figures, sans être néanmoins des corps ni colorés, ni figurés, ajoutant qu’ils pouvaient se revêtir d’air comme d’un habit lorsqu’ils voulaient se rendre visibles aux yeux des hommes. Les autres disaient que c’étaient des corps animés, mais qu’ils étaient faits d’air ou d’une autre matière plus subtile, qu’ils épaississaient à leur gré, lorsqu’ils voulaient paraître.
II — Si ces deux sortes de Philosophes étaient opposés dans l’opinion qu’ils avaient des Fantômes, ils s’accordaient dans les noms qu’ils leur donnaient, car tous les appelaient Démons; en quoi ils étaient aussi insensés que ceux qui croient voir en dormant les âmes des personnes mortes et que c’est leur propre âme qu’ils voient quand ils se regardent dans un miroir, ou enfin qui croient que les étoiles qu’on voit dans l’eau sont les âmes des étoiles. D’après une opinion ridicule, ils tombèrent dans une erreur qui n’est pas moins absurde, lorsqu’ils crurent que ces Fantômes avaient un pouvoir illimité, notion destituée de raison; mais ordinaire aux ignorants, qui s’imaginent que les Êtres qu’ils ne connaissent pas ont une puissance merveilleuse.
III — Cette ridicule opinion ne fut pas plutôt divulgués que les législateurs s’en servirent pour appuyer leur autorité. Ils établirent la croyance des Esprits qu’ils appelèrent Religion, espérant que la crainte que le peuple aurait de ces puissances invisibles le retiendrait dans son devoir; et pour donner plus de poids à ce dogme, ils distinguèrent les Esprits ou Démons en bons et mauvais; les uns furent destinés à exciter les hommes à observer leurs lois, les autres à les retenir et à les empêcher de les enfreindre.
Pour savoir ce que c’est que les Démons, il ne faut que lire les Poètes grecs et leurs histoires, et surtout ce qu’en dit Hésiode dans sa Théogonie, où il traite amplement de la génération et de l’origine des Dieux.
IV — Les Grecs sont les premiers qui les ont inventés; de chez eux ils ont passé, par le moyen de leurs colonies, dans l’Asie, dans l’Egypte et l’Italie. C’est là où les Juifs, qui étaient dispersés à l’Alexandrie et ailleurs, en ont eu connaissance. Ils s’en sont heureusement servis comme les autres peuples, mais avec cette différence qu’ils n’ont pas nommé Démons, comme les Grecs, les bons et les mauvais esprits indifféremment, mais seulement les mauvais, réservant au seul bon Démon le nom d’Esprit, de Dieu, et appelant Prophètes ceux qui étaient inspirés par le bon esprit; de plus, ils regardaient comme les effets de l’Esprit Divin tout ce qu’ils regardaient comme un grand bien, et comme effets du Caco-Démon, ou Esprit malin, tout ce qu’ils estimaient un grand mal.
V — Cette distinction du bien et du mal fit appeler Démoniaques ceux que nous nommons Lunatiques, Insensés, Furieux, Epileptiques; comme aussi ceux qui parlaient un langage inconnu. Un homme mal fait et malpropre était, à leur avis, possédé d’un Esprit immonde; un muet l’était d’un Esprit muet. Enfin, les mots Esprit et de Démon leur devinrent si familiers qu’ils en parlaient en toute rencontre; d’où il est clair que les Juifs croyaient, comme les Grecs, que les Esprits ou Fantômes n’étaient pas de pures chimères, ni des visions, mais des êtres réels, indépendants de l’imagination.
VI — De là vient que la Bible est toute remplie de contes sur les Esprits, les Démons et les Démoniaques; mais il n’y est dit nulle part comment et quand ils furent créés, ce qui n’est guère pardonnable à Moïse, qui s’est, dit-on mêlé de parler de la Création du Ciel et de la Terre. Jésus, qui parle assez souvent d’Anges et d’Esprits bons et mauvais, ne nous dit pas non plus s’ils sont matériels ou immatériels. Cela fait voir que tous les deux ne savaient que ce que les Grecs en avaient appris à leurs ancêtres. Sans cela, Jésus-Christ ne serait pas moins blâmable de son silence que de sa malice à refuser à tous les hommes la grâce, la foi et la piété qu’il assure leur pouvoir donner.
Mais, pour revenir aux Esprits, il est certain que ces morts Démons, Satan, Diable, ne sont point des noms propres qui désignent quelque individu, et qu’il n’y eût jamais que les ignorants qui y crurent, tant parmi les Grecs, qui les inventèrent, que parmi les juifs, qui les adoptèrent: Depuis que ces derniers furent infectés de ces idées, ils approprièrent ces noms, qui signifie ennemi, accusateur et exterminateur, tantôt aux Puissances invisibles, c’est-à-dire aux Gentils, qu’ils disaient habiter le Royaume de Satan, n’y ayant qu’eux, dans leur opinion, qui habitassent celui de Dieu.
VII — Comme Jésus-Christ était Juif, par conséquent fort imbu de ces opinions, il ne faut pas s’étonner si l’on rencontre souvent dans ses Evangiles et dans les écrits de ses disciples, ces mots de Diable, de Satan, d’Enfer, comme si c’était quelque chose de réel ou d’effectif. Cependant, il est très évident, comme nous l’avons déjà fait observer, qu’il n’y a rien de plus chimérique et quand ce que nous avons dit ne suffirait pas pour le prouver, il ne faut que deux mots pour convaincre les opiniâtres.
Tous les Chrétiens demeurent d’accord que Dieu est la source de toutes choses, qu’il les a créées, qu’il les conserve, et que, sans son secours, elles tomberaient dans le néant; suivant ce principe, il est certain qu’il a créé ce qu’on appelle le Diable ou Satan. Or, soit qu’il l’ait créé bon ou mauvais (ce dont il ne s’agit pas ici), il est incontestablement l’ouvrage du premier principe. S’il subsiste, tout méchant qu’il est, comme on le dit, ce ne peut être que par la volonté de Dieu. Or, comment est-il possible de concevoir que Dieu conserve une créature, qui non seulement le haït mortellement et le maudit sans cesse, mais qui s’efforce encore de lui débaucher ses amis pour avoir le plaisir de le mortifier? Comment, dis-je, est-il possible que Dieu laisse subsister ce Diable, pour lui faire lui-même tout le chagrin, qu’il peut, pour le détrôner s’il était en son pouvoir, et pour détourner de son service ses Favoris et ses Elus?
Quel est ici le but de Dieu, ou plutôt que nous veut-on dire en nous parlant du Diable et de l’Enfer? Si Dieu peut tout et qu’on ne puisse rien sans lui, d’où vient que le Diable le haït, le maudit, et lui enlève ses amis? Ou Dieu y consent, ou il n’y consent pas. S’il y consent, le diable en le maudissant ne fait que ce qu’il doit, puisqu’il ne peut que ce que Dieu veut; par conséquent ce n’est pas le Diable, mais Dieu même qui se maudit; chose absurde, s’il en fût jamais ! S’il n’y consent pas, il n’est pas vrai qu’il soit Tout-Puissant, et par conséquent il y a deux principes, l’un du bien et l’autre du mal; l’un qui vent une chose, l’autre qui veut le contraire. Où nous conduira ce raisonnement? A faire avouer sans réplique que ni Dieu ni le Diable, ni le Paradis, ni l’Enfer, ni l’âme ne sont point ce que la religion les dépeint, et que les Théologiens, c’est-à-dire ceux qui débitent des fables pour des vérités, sont des gens de mauvaise foi, qui abusent de leur crédulité des peuples pour leur insinuer ce qui leur plaît, comme si le vulgaire était absolument indigne de la vérité, ou ne dût être nourri que de chimères, dans lesquelles un homme raisonnable ne voit que du vide, du néant et de la folie.
Il y a longtemps que le monde est infecté de ces absurdes opinions. cependant, de tout temps, il s’est trouvé des esprits solides et des hommes sincères, qui, malgré la persécution, se sont récriés contre les absurdités de leur siècle, comme on vient de le faire dans ce petit Traité. ceux qui aiment la vérité y trouveront, sans doute, quelque consolation; c’est à ceux-là que je veux plaire, sans me soucier du jugement de ceux à qui les préjugés tiennent lieu d’oracle infaillible.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas,
Atque letus omnes et inexorabile fatum
Subjecit pedibus, strepitumque Acheronis avari.
— Virg. Georg. Liv. 2.
Voltaire: Epître à l’auteur du livre des Trois imposteurs
Insipide écrivain, qui crois à tes lecteurs [1]
Crayonner les portraits de tes Trois Imposteurs,
D’où vient que, sans esprit, tu fais le quatrième ?
Pourquoi, pauvre ennemi de l’essence suprême,
Confonds-tu Mahomet avec le Créateur,
Et les oeuvres de l’homme avec Dieu, son auteur ?...
Corrige le valet, mais respecte le maître.
Dieu ne doit point pâtir des sottises du prêtre :
Reconnaissons ce Dieu, quoique très-mal servi.
De lézards et de rats mon logis est rempli ;
Mais l’ architecte existe, et quiconque le nie
Sous le manteau du sage est atteint de manie.
Consulte Zoroastre, et Minos, et Solon,
Et le martyr Socrate, et le grand Cicéron :
Ils ont adoré tous un maître, un juge, un père.
Ce système sublime à l’homme est nécessaire.
C’est le sacré lien de la société,
Le premier fondement de la sainte équité,
Le frein du scélérat, l’espérance du juste.
Si les cieux, dépouillés de son empreinte auguste,
Pouvaient cesser jamais de le manifester,
Si Dieu n’existait pas, il faudrait l’inventer.
Que le sage l’annonce, et que les rois le craignent.
Rois, si vous m’opprimez, si vos grandeurs dédaignent
Les pleurs de l’innocent que vous faites couler,
Mon vengeur est au ciel : apprenez à trembler.
Tel est au moins le fruit d’une utile croyance.
Mais toi, raisonneur faux, dont la triste imprudence
Dans le chemin du crime ose les rassurer,
De tes beaux arguments quel fruit peux-tu tirer ?
Tes enfants à ta voix seront-ils plus dociles ?
Tes amis, au besoin, plus sûrs et plus utiles ?
Ta femme plus honnête ? et ton nouveau fermier,
Pour ne pas croire en Dieu, va-t-il mieux te payer ? ...
Ah! laissons aux humains la crainte et l’espérance.
Tu m’objectes en vain l’hypocrite insolence
De ces fiers charlatans aux honneurs élevés,
Nourris de nos travaux, de nos pleurs abreuvés ;
Des Césars avilis la grandeur usurpée ;
Un prêtre au Capitole où triompha Pompée ;
Des faquins en sandale, excrément des humains,
Trempant dans notre sang leurs détestables mains ;
Cent villes à leur voix couvertes de ruines,
Et de Paris sanglant les horribles matines :
Je connais mieux que toi ces affreux monuments ;
Je les ai sous ma plume exposés cinquante ans.
Mais, de ce fanatisme ennemi formidable,
J’ai fait adorer Dieu quand j’ai vaincu le diable.
Je distinguai toujours de la religion
Les malheurs qu’apporta la superstition.
L’Europe m’en sut gré ; vingt têtes couronnées
Daignèrent applaudir mes veilles fortunées,
Tandis que Patouillet m’injuriait en vain.
J’ai fait plus en mon temps que Luther et Calvin.
On les vit opposer, par une erreur fatale,
Les abus aux abus, le scandale au scandale.
Parmi les factions ardents à se jeter,
Ils condamnaient le pape, et voulaient l’imiter.
L’Europe par eux tous fut longtemps désolée ;
Ils ont troublé la terre, et je l’ai consolée.
J’ai dit aux disputants l’un sur l’autre acharnés :
« Cessez, impertinents; cessez, infortunés ;
Très-sots enfants de Dieu, chérissez-vous en frères,
Et ne vous mordez plus pour d’absurdes chimères. »
Les gens de bien m’ont cru : les fripons écrasés
En ont poussé des cris du sage méprisés ;
Et dans l’Europe enfin l’heureux tolérantisme
De tout esprit bien fait devient le catéchisme.
Je vois venir de loin ces temps, ces jours sereins,
Où la philosophie, éclairant les humains,
Doit les conduire en paix aux pieds du commun maître ;
Le fanatisme affreux tremblera d’y paraître :
On aura moins de dogme avec plus de vertu.
Si quelqu’un d’un emploi veut être revêtu,
Il n’ amènera plus deux témoins sa suite [2]
Jurer quelle est sa foi, mais quelle est sa conduite.
A l’attrayante soeur d’un gros bénéficier
Un amant huguenot pourra se marier ;
Des trésors de Lorette, amassés pour Marie,
On verra l’indigence habillée et nourrie ;
Les enfants de Sara, que nous traitons de chiens,
Mangeront du jambon fumé par des chrétiens.
Le Turc, sans s’informer si l’iman lui pardonne,
Chez l’abbé Tamponet ira boire en Sorbonne. [3]
Mes neveux souperont sans rancune et gaîment
Avec les héritiers des frères Pompignan ;
Ils pourront pardonner à ce dur La Blétrie [4]
D’ avoir coupé trop tôt la trame de ma vie.
Entre les beaux esprits on verra l’union :
Mais qui pourra jamais souper avec Fréron ?
[1] Ce livre des Trois Imposteurs est un très-mauvais ouvrage, plein d’un athéisme grossier, sans esprit, et sans philosophie.
[2] En France, pour être reçu procureur, notaire, greffier, il faut deux témoins qui déposent de la catholicité du récipiendaire.
[3] Tamponet était en effet docteur de Sorbonne.
[4] La Bletterie, à ce qu’on m’a rapporté, a imprimé que j’ avais oublié de me faire enterrer.
— 1768. Œuvres complètes de Voltaire. Paris: Garnier, 1877-1885. X, pp. 402-405.
Voltaire: Examen important de Milord Bolingbroke
Chapitre I. Des livres de Moïse.
Chapitre II. De la personne de Moïse.
Chapitre III. De la divinité attribuée aux livres juifs.
Chapitre IV. Qui est l’auteur du pentateuque ?
Chapitre V. Que les juifs ont tout pris des autres nations.
Chapitre VII. Des mœurs des juifs.
Chapitre X. De la personne de Jésus.
Chapitre XI. Quelle idée il faut se former de jésus et de ses disciples.
Chapitre XII. De l’établissement de la secte chrétienne, et particulièrement de Paul.
Chapitre XVI. Des fausses citations et des fausses prédictions dans les évangiles.
Chapitre XVII. De la fin du monde, et de la Jérusalem nouvelle.
Chapitre XVIII. Des allégories.
Chapitre XIX. Des falsifications, et des livres supposés.
Chapitre XX. Des principales impostures des premiers chrétiens.
Chapitre XXI. Des dogmes et de la métaphysique des chrétiens des premiers siècles. — De Justin.
Chapitre XXIII. De Clément d’Alexandrie.
Chapitre XXV. D’Origène, et de la trinité.
Chapitre XXVIII. Des chrétiens depuis Dioclétien jusqu’à Constantin.
Chapitre XXX. Des querelles chrétiennes avant Constantin et sous son règne.
Chapitre XXXI. Arianisme et athanasianisme.
Chapitre XXXIII. Considérations sur Julien.
Chapitre XXXIV. Des chrétiens jusqu’à Théodose.
Chapitre XXXV. Des sectes et des malheurs des chrétiens jusqu’à l’établissement du mahométisme.
Chapitre XXXVI. Discours sommaire des usurpations papales.
Chapitre XXXVII. De l’excès épouvantable des persécutions chrétiennes.
Avant-propos.
L’ambition de dominer sur les esprits est une des plus fortes passions. Un théologien, un missionnaire, un homme de parti veut conquérir comme un prince ; et il y a beaucoup plus de sectes dans le monde qu’il n’y a de souverainetés. À qui soumettrai-je mon âme ? Serai-je chrétien, parce que je serai de Londres ou de Madrid ? Serai-je musulman, parce que je serai né en Turquie ? Je ne dois penser que par moi-même et pour moi-même ; le choix d’une religion est mon plus grand intérêt. Tu adores un Dieu par Mahomet ; et toi, par le grand lama ; et toi, par le pape. Eh, malheureux ! adore un Dieu par ta propre raison.
La stupide indolence dans laquelle la plupart des hommes croupissent sur l’objet le plus important semblerait prouver qu’ils sont de misérables machines animales, dont l’instinct ne s’occupe que du moment présent. Nous traitons notre intelligence comme notre corps ; nous les abandonnons souvent l’un et l’autre pour quelque argent à des charlatans. La populace meurt, en Espagne, entre les mains d’un vil moine et d’un empirique ; et la nôtre, à peu près de même[1]. Un vicaire, un dissenter, assiégent leurs derniers moments.
Un très-petit nombre d’hommes examine ; mais l’esprit de parti, l’envie de se faire valoir les préoccupe. Un grand homme, parmi nous, n’a été chrétien que parce qu’il était ennemi de Collins ; notre Whiston n’était chrétien que parce qu’il était arien. Grotius ne voulait que confondre les gomaristes. Bossuet soutint le papisme contre Claude, qui combattait pour la secte calviniste. Dans les premiers siècles, les ariens combattaient contre les athanasiens. L’empereur Julien et son parti combattaient contre ces deux sectes ; et le reste de la terre contre les chrétiens, qui disputaient avec les juifs. À qui croire ? il faut donc examiner : c’est un devoir que personne ne révoque en doute. Un homme qui reçoit sa religion sans examen ne diffère pas d’un bœuf qu’on attelle.
Cette multitude prodigieuse de sectes dans le christianisme forme déjà une grande présomption que toutes sont des systèmes d’erreur. L’homme sage se dit à lui-même : Si Dieu avait voulu me faire connaître son culte, c’est que ce culte serait nécessaire à notre espèce. S’il était nécessaire, il nous l’aurait donné à tous lui-même, comme il a donné à tous deux yeux et une bouche. Il serait partout uniforme, puisque les choses nécessaires à tous les hommes sont uniformes. Les principes de la raison universelle sont communs à toutes les nations policées, toutes reconnaissent un Dieu : elles peuvent donc se flatter que cette connaissance est une vérité. Mais chacune d’elles a une religion différente ; elles peuvent donc conclure qu’ayant raison d’adorer un Dieu, elles ont tort dans tout ce qu’elles ont imaginé au delà.
Si le principe dans lequel l’univers s’accorde paraît vraisemblable, les conséquences diamétralement opposées qu’on en tire paraissent bien fausses ; il est naturel de s’en défier. La défiance augmente quand on voit que le but de tous ceux qui sont à la tête des sectes est de dominer et de s’enrichir autant qu’ils le peuvent, et que, depuis les daïris du Japon jusqu’aux évêques de Rome, on ne s’est occupé que d’élever à un pontife un trône fondé sur la misère des peuples, et souvent cimenté de leur sang.
Que les Japonais examinent comment les daïris les ont longtemps subjugués ; que les Tartares se servent de leur raison pour juger si le grand lama est immortel ; que les Turcs jugent leur Alcoran ; mais, nous autres chrétiens, examinons notre Évangile. Dès là que je veux sincèrement examiner, j’ai droit d’affirmer que je ne tromperai pas : ceux qui n’ont écrit que pour prouver leur sentiment me sont suspects.
Pascal commence par révolter ses lecteurs, dans ses pensées informes qu’on a recueillies : « Que ceux qui combattent la religion chrétienne, dit-il, apprennent à la connaître, etc. » Je vois à ces mots un homme de parti qui veut subjuguer.
On m’apprend qu’un curé, en France, nommé Jean Meslier, mort depuis peu, a demandé pardon à Dieu, en mourant, d’avoir enseigné le christianisme[2]. Cette disposition d’un prêtre à l’article de la mort fait sur moi plus d’effet que l’enthousiasme de Pascal. J’ai vu en Dorsetshire, diocèse de Bristol, un curé renoncer à une cure de deux cents livres sterling, et avouer à ses paroissiens que sa conscience ne lui permettait pas de leur prêcher les absurdes horreurs de la secte chrétienne. Mais ni le testament de Jean Meslier, ni la déclaration de ce digne curé, ne sont pour moi des preuves décisives. Le juif Uriel Acosta renonça publiquement à l’Ancien Testament dans Amsterdam ; mais je ne croirai pas plus le juif Acosta que le curé Meslier. Je dois lire les pièces du procès avec une attention sévère, ne me laisser séduire par aucun des avocats, peser devant Dieu les raisons des deux partis, et décider suivant ma conscience. C’est à moi de discuter les arguments de Wollaston et de Clarke, mais je ne puis en croire que ma raison.
J’avertis d’abord que je ne veux pas toucher à notre Église anglicane, en tant qu’elle est établie par actes de parlement. Je la regarde d’ailleurs comme la plus savante et la plus régulière de l’Europe. Je ne suis point de l’avis du Whig indépendant, qui semble vouloir abolir tout sacerdoce, et le remettre aux mains des pères de famille, comme du temps des patriarches. Notre société, telle qu’elle est, ne permet pas un pareil changement. Je pense qu’il est nécessaire d’entretenir des prêtres, pour être les maîtres des mœurs et pour offrir à Dieu nos prières. Nous verrons s’ils doivent être des joueurs de gobelets, des trompettes de discorde, et des persécuteurs sanguinaires. Commençons d’abord par m’instruire moi-même.
Chapitre I. Des livres de Moïse.
Le christianisme est fondé sur le judaïsme[1] : voyons donc si le judaïsme est l’ouvrage de Dieu. On me donne à lire les livres de Moïse, je dois m’informer d’abord si ces livres sont de lui.
1° Est-il vraisemblable que Moïse ait fait graver le Pentateuque, ou du moins les livres de la loi, sur la pierre, et qu’il ait eu des graveurs et des polisseurs de pierre dans un désert affreux, où il est dit que son peuple n’avait ni tailleurs, ni faiseurs de sandales, ni d’étoffes pour se vêtir, ni de pain pour manger, et où Dieu fut obligé de faire un miracle continuel pendant quarante années pour conserver les vêtements de ce peuple, et pour le nourrir ?
2° Il est dit dans le livre de Josué que l’on écrivit le Deutéronome sur un autel de pierres brutes enduites de mortier. Comment écrivit-on tout un livre sur du mortier ? comment ces lettres ne furent-elles pas effacées par le sang qui coulait continuellement sur cet autel ? et comment cet autel, ce monument du Deutéronome, subsista-t-il dans le pays où les Juifs furent si longtemps réduits à un esclavage que leurs brigandages avaient tant mérité ?
3° Les fautes innombrables de géographie, de chronologie, et les contradictions qui se trouvent dans le Pentateuque, ont forcé plusieurs Juifs et plusieurs chrétiens à soutenir que le Pentateuque ne pouvait être de Moïse. Le savant Leclerc, une foule de théologiens, et même notre grand Newton, ont embrassé cette opinion ; elle est donc au moins très-vraisemblable.
4° Ne suffit-il pas du simple sens commun pour juger qu’un livre qui commence par ces mots : « Voici les paroles que prononça Moïse au delà du Jourdain, » ne peut être que d’un faussaire maladroit, puisque le même livre assure que Moïse ne passa jamais le Jourdain ? La réponse d’Abbadie, qu’on peut entendre en deçà par au delà, n’est-elle pas ridicule ? et doit-on croire à un prédicant mort fou en Irlande, plutôt qu’à Newton, le plus grand homme qui ait jamais été ?
De plus, je demande à tout homme raisonnable s’il y a quelque vraisemblance que Moïse eût donné dans le désert des préceptes aux rois juifs, qui ne vinrent que tant de siècles après lui, et s’il est possible que, dans ce même désert, il eût assigné quarante-huit villes avec leurs faubourgs pour la seule tribu des lévites, indépendamment des décimes que les autres tribus devaient leur payer ? Il est sans doute très-naturel que des prêtres aient tâché d’engloutir tout ; mais il ne l’est pas qu’on leur ait donné quarante-huit villes dans un petit canton où il y avait à peine alors deux villages : il eût fallu au moins autant de villes pour chacune des autres hordes juives ; le total aurait monté à quatre cent quatre-vingts villes avec leurs faubourgs. Les Juifs n’ont pas écrit autrement leur histoire. Chaque trait est une hyperbole ridicule, un mensonge grossier, une fable absurde.
Chapitre II. De la personne de Moïse.
 a-t-il eu un Moïse ? Tout est si prodigieux en lui depuis sa naissance jusqu’à sa mort qu’il paraît un personnage fantastique, comme notre enchanteur Merlin. S’il avait existé, s’il avait opéré les miracles épouvantables qu’il est supposé avoir faits en Égypte, serait-il possible qu’aucun auteur égyptien n’eût parlé de ces miracles, que les Grecs, ces amateurs du merveilleux, n’en eussent pas dit un seul mot ? Flavius Josèphe, qui, pour faire valoir sa nation méprisée, recherche tous les témoignages des auteurs égyptiens qui ont parlé des Juifs, n’a pas le front d’en citer un seul qui fasse mention des prodiges de Moïse. Ce silence universel n’est-il pas une présomption que Moïse est un personnage fabuleux ?
a-t-il eu un Moïse ? Tout est si prodigieux en lui depuis sa naissance jusqu’à sa mort qu’il paraît un personnage fantastique, comme notre enchanteur Merlin. S’il avait existé, s’il avait opéré les miracles épouvantables qu’il est supposé avoir faits en Égypte, serait-il possible qu’aucun auteur égyptien n’eût parlé de ces miracles, que les Grecs, ces amateurs du merveilleux, n’en eussent pas dit un seul mot ? Flavius Josèphe, qui, pour faire valoir sa nation méprisée, recherche tous les témoignages des auteurs égyptiens qui ont parlé des Juifs, n’a pas le front d’en citer un seul qui fasse mention des prodiges de Moïse. Ce silence universel n’est-il pas une présomption que Moïse est un personnage fabuleux ?
Pour peu qu’on ait étudié l’antiquité, on sait que les anciens Arabes furent les inventeurs de plusieurs fables qui, avec le temps, ont eu cours chez les autres peuples. Ils avaient imaginé l’histoire de l’ancien Bacchus, qu’on supposait très-antérieur au temps où les Juifs disent que parut leur Moïse. Ce Bacchus ou Back, né dans l’Arabie, avait écrit ses lois sur deux tables de pierre ; on l’appela Misem, nom qui ressemble fort à celui de Moïse ; il avait été sauvé des eaux dans un coffre, et ce nom signifiait sauvé des eaux ; il avait une baguette avec laquelle il opérait des miracles ; cette verge se changeait en serpent quand il voulait. Ce même Misem passa la mer Rouge à pied sec, à la tête de son armée ; il divisa les eaux de l’Oronte et de l’Hydaspe, et les suspendit à droite et à gauche ; une colonne de feu éclairait son armée pendant la nuit. Les anciens vers orphiques qu’on chantait dans les orgies de Bacchus célébraient une partie de ces extravagances. Cette fable était si ancienne que les Pères de l’Église ont cru que ce Misem, ce Bacchus, était leur Noé[1].
N’est-il pas de la plus grande vraisemblance que les Juifs adoptèrent cette fable, et qu’ensuite ils récrivirent quand ils commencèrent à avoir quelque connaissance des lettres sous leurs rois ? Il leur fallait du merveilleux comme aux autres peuples ; mais ils n’étaient pas inventeurs : jamais plus petite nation ne fut plus grossière ; tous leurs mensonges étaient des plagiats, comme toutes leurs cérémonies étaient visiblement une imitation des Phéniciens, des Syriens, et des Égyptiens.
Ce qu’ils ont ajouté d’eux-mêmes paraît d’une grossièreté et d’une absurdité si révoltante qu’elle excite l’indignation et la pitié. Dans quel ridicule roman souffrirait-on un homme qui change toutes les eaux en sang, d’un coup de baguette, au nom d’un dieu inconnu, et des magiciens qui en font autant au nom des dieux du pays. La seule supériorité qu’ait Moïse sur les sorciers du roi, c’est qu’il fit naître des poux, ce que les sorciers ne purent faire : sur quoi un grand prince a dit que les Juifs, en fait de poux, en savaient plus que tous les magiciens du monde.
Comment un ange du Seigneur vient-il tuer tous les animaux d’Égypte ? Et comment, après cela, le roi d’Égypte a-t-il une armée de cavalerie ? Et comment cette cavalerie entre-t-elle dans le fond de la mer Rouge ?
Comment le même ange du Seigneur vient-il couper le cou pendant la nuit à tous les aînés des familles égyptiennes ? C’était bien alors que le prétendu Moïse devait s’emparer de ce beau pays, au lieu de s’enfuir en lâche et en coquin avec deux ou trois millions d’hommes parmi lesquels il avait, dit-on, six cent trente mille combattants. C’est avec cette prodigieuse multitude qu’il fuit devant les cadets de ceux que l’ange avait tués. Il s’en va errer dans les déserts, où l’on ne trouve pas seulement de l’eau à boire, et, pour lui faciliter cette belle expédition, son dieu divise les eaux de la mer, en fait deux montagnes à droite et à gauche, afin que son peuple favori aille mourir de faim et de soif.
Tout le reste de l’histoire de Moïse est également absurde et barbare. Ses cailles, sa manne, ses entretiens avec Dieu ; vingt-trois mille hommes de son peuple égorgés à son ordre par des prêtres ; vingt-quatre mille massacrés une autre fois ; six cent trente mille combattants dans un désert où il n’y a jamais eu deux mille hommes : tout cela paraît assurément le comble de l’extravagance ; et quelqu’un a dit que l’Orlando furioso et Don Quichotte sont des livres de géométrie en comparaison des livres hébreux. S’il y avait seulement quelques actions honnêtes et naturelles dans la fable de Moïse, on pourrait croire à toute force que ce personnage a existé.
On a le front de nous dire que la fête de Pâques chez les Juifs est une preuve du passage de la mer Rouge. On remerciait le Dieu des Juifs, à cette fête, de la bonté avec laquelle il avait égorgé tous les premiers nés d’Égypte : donc, dit-on, rien n’était plus vrai que cette sainte et divine boucherie.
Conçoit-on bien, dit le déclamateur et le mauvais raisonneur Abbadie, que « Moïse ait pu instituer des mémoriaux sensibles d’un événement reconnu pour faux par plus de six cent mille témoins » ? Pauvre homme ! tu devais dire par plus de deux millions de témoins, car six cent trente mille combattants, fugitifs ou non, supposent assurément plus de deux millions de personnes. Tu dis donc que Moïse lut son Pentateuque à ces deux ou trois millions de Juifs ! Tu crois donc que ces deux ou trois millions d’hommes auraient écrit contre Moïse, s’ils avaient découvert quelque erreur dans son Pentateuque, et qu’ils eussent fait insérer leurs remarques dans les journaux du pays ! Il ne te manque plus que de dire que ces trois millions d’hommes ont signé comme témoins, et que tu as vu leur signature.
Tu crois donc que les temples et les rites institués en l’honneur de Bacchus, d’Hercule, et de Persée, prouvent évidemment que Persée, Hercule, et Bacchus, étaient fils de Jupiter, et que, chez les Romains, le temple de Castor et de Pollux était une démonstration que Castor et Pollux avaient combattu pour les Romains ! C’est ainsi qu’on suppose toujours ce qui est en question ; et les trafiquants en controverse débitent sur la cause la plus importante au genre humain des arguments que lady Blackacre n’oserait pas hasarder dans la salle de common plays. C’est là ce que des fous ont écrit, ce que des imbéciles commentent, ce que des fripons enseignent, ce qu’on fait apprendre par cœur aux petits enfants ; et on appelle blasphémateur le sage qui s’indigne et qui s’irrite des plus abominables inepties qui aient jamais déshonoré la nature humaine !
Chapitre III. De la divinité attribuée aux livres juifs.
Comment a-t-on osé supposer que Dieu choisit une horde d’Arabes voleurs pour être son peuple chéri, et pour armer cette horde contre toutes les autres nations ? Et comment, en combattant à sa tête, a-t-il souffert que son peuple fût si souvent vaincu et esclave ?
Comment, en donnant des lois à ces brigands, a-t-il oublié de contenir ce petit peuple de voleurs par la croyance de l’immortalité de l’âme et des peines après la mort[1] tandis que toutes les grandes nations voisines, Chaldéens, Égyptiens, Syriens, Phéniciens, avaient embrassé depuis si longtemps cette croyance utile ?
Est-il possible que Dieu eût pu prescrire aux Juifs la manière d’aller à la selle dans le désert et leur cacher le dogme d’une vie future ? Hérodote nous apprend que le fameux temple de Tyr était bâti deux mille trois cents ans avant lui. On dit que Moïse conduisait sa troupe dans le désert environ seize cents ans avant notre ère. Hérodote écrivait cinq cents ans avant cette ère vulgaire : donc le temple des Phéniciens subsistait douze cents ans avant Moïse ; donc la religion phénicienne était établie depuis plus longtemps encore. Cette religion annonçait l’immortalité de l’âme, ainsi que les Chaldéens et les Égyptiens. La horde juive n’eut jamais ce dogme pour fondement de sa secte. C’était, dit-on, un peuple grossier auquel Dieu se proportionnait. Dieu se proportionner ! Et à qui ? à des voleurs juifs ! Dieu être plus grossier qu’eux ! n’est-ce pas un blasphème ?
Chapitre IV. Qui est l’auteur du pentateuque ?
On me demande qui est l’auteur du Pentateuque : j’aimerais autant qu’on me demandât qui a écrit les quatre Fils Aymon, Robert le Diable, et l’histoire de l’enchanteur Merlin.
Newton, qui s’est avili jusqu’à examiner sérieusement cette question, prétend que ce fut Samuel qui écrivit ces rêveries, apparemment pour rendre les rois odieux à la horde juive, que ce détestable prêtre voulait gouverner. Pour moi, je pense que les Juifs ne surent lire et écrire que pendant leur captivité chez les Chaldéens, attendu que leurs lettres furent d’abord chaldaïques, et ensuite syriaques ; nous n’avons jamais connu d’alphabet purement hébreu.
Je conjecture qu’Esdras forgea tous ces contes du Tonneau au retour de la captivité. Il les écrivit en lettres chaldéennes, dans le jargon du pays, comme des paysans du nord d’Irlande écriraient aujourd’hui en caractères anglais.
Les Cuthéens, qui habitaient le pays de Samarie, écrivirent ce même Pentateuque en lettres phéniciennes, qui étaient le caractère courant de leur nation, et nous avons encore aujourd’hui ce Pentateuque.
Je crois que Jérémie put contribuer beaucoup à la composition de ce roman. Jérémie était fort attaché, comme on sait, aux rois de Babylone ; il est évident, par ses rapsodies, qu’il était payé par les Babyloniens, et qu’il trahissait son pays ; il veut toujours qu’on se rende au roi de Babylone. Les Égyptiens étaient alors les ennemis des Babyloniens. C’est pour faire sa cour au grand roi maître d’Hershalaïm Kedusha, nommé par nous Jérusalem[1], que Jérémie, et ensuite Esdras, inspirent tant d’horreur aux Juifs pour les Égyptiens. Ils se gardent bien de rien dire contre les peuples de l’Euphrate. Ce sont des esclaves qui ménagent leurs maîtres. Ils avouent bien que la horde juive a presque toujours été asservie ; mais ils respectent ceux qu’ils servaient alors.
Que d’autres Juifs aient écrit les faits et gestes de leurs roitelets, c’est ce qui m’importe aussi peu que l’histoire des chevaliers de la Table ronde et des douze pairs de Charlemagne ; et je regarde comme la plus futile de toutes les recherches celle de savoir le nom de l’auteur d’un livre ridicule.
Qui a écrit le premier l’histoire de Jupiter, de Neptune, et de Pluton ? Je n’en sais rien, et je ne me soucie pas de le savoir.
Il y a une très-ancienne Vie de Moïse écrite en hébreu, mais qui n’a point été insérée dans le canon judaïque. On en ignore l’auteur, ainsi qu’on ignore les auteurs des autres livres juifs ; elle est écrite dans ce style des Mille et une Nuits, qui est celui de toute l’antiquité asiatique. En voici quelques échantillons.
L’an 130 après la transmigration des Juifs en Égypte, soixante ans après la mort de Joseph, le pharaon, pendant son sommeil, vit en songe un vieillard qui tenait en ses mains une balance. Dans l’un des bassins étaient tous les Égyptiens avec leurs enfants et leurs femmes ; dans l’autre, un seul enfant à la mamelle, qui pesait plus que toute l’Égypte entière. Le roi fit aussitôt appeler tous ses magiciens, qui furent tous saisis d’étonnement et de crainte. Un des conseillers du roi devina qu’il y aurait un enfant hébreu qui serait la ruine de l’Égypte. Il conseilla au roi de faire tuer tous les petits garçons de la nation juive.
L’aventure de Moïse sauvé des eaux est à peu près la même que dans l’Exode. On appela d’abord Moïse Schabar, et sa mère Jéchotiel. À l’âge de trois ans. Moïse, jouant avec Pharaon, prit sa couronne et s’en couvrit la tête. Le roi voulut le faire tuer, mais l’ange Gabriel descendit du ciel, et pria le roi de n’en rien faire. « C’est un enfant, lui dit-il, qui n’y a pas entendu malice. Pour vous prouver combien il est simple, montrez-lui une escarboucle et un charbon ardent, vous verrez qu’il choisira le charbon. » Le roi en fit l’expérience ; le petit Moïse ne manqua pas de choisir l’escarboucle ; mais l’ange Gabriel l’escamota, et mit le charbon ardent à la place ; le petit Moïse se brûla la main jusqu’aux os. Le roi lui pardonna, le croyant un sot. Ainsi Moïse, ayant été sauvé par l’eau, fut encore une fois sauvé par le feu.
Tout le reste de l’histoire est sur le même ton. Il est difficile de décider lequel est le plus admirable de cette fable de Moïse, ou de la fable du Pentateuque. Je laisse cette question à ceux qui ont plus de temps à perdre que moi. Mais j’admire surtout les pédants, comme Grotius, Abbadie, et même cet abbé Houteville, longtemps entremetteur d’un fermier général à Paris, ensuite secrétaire de ce fameux cardinal Dubois, à qui j’ai entendu dire qu’il défiait tous les cardinaux d’être plus athées que lui. Tous ces gens-là se distillent le cerveau pour faire accroire (ce qu’ils ne croient point) que le Pentateuque est de Moïse. Eh ! mes amis, que prouveriez-vous là ? que Moïse était un fou. Il est bien sûr que je ferais enfermer à Bedlam un homme qui écrirait aujourd’hui de pareilles extravagances.
Chapitre V. Que les juifs ont tout pris des autres nations.
On l’a déjà dit souvent, c’est le petit peuple asservi qui tâche d’imiter ses maîtres ; c’est la nation faible et grossière qui se conforme grossièrement aux usages de la grande nation. C’est Cornouailles qui est le singe de Londres, et non pas Londres qui est le singe de Cornouailles. Est-il rien de plus naturel que les Juifs aient pris ce qu’ils ont pu du culte, des lois, des coutumes de leurs voisins ?
Nous sommes déjà certains que leur dieu prononcé par nous Jéhovah, et par eux Jaho, était le nom ineffable du dieu des Phéniciens et des Égyptiens ; c’était une chose connue dans l’antiquité. Clément d’Alexandrie, au premier livre de ses Stromates, rapporte que ceux qui entraient dans les temples d’Égypte étaient obligés de porter sur eux une espèce de talisman composé de ce mot Jaho ; et quand on savait prononcer ce mot d’une certaine façon, celui qui l’entendait tombait roide mort, ou du moins évanoui. C’était du moins ce que les charlatans des temples tâchaient de persuader aux superstitieux.
On sait assez que la figure du serpent, les chérubins, la cérémonie de la vache rousse, les ablutions nommées depuis baptême, les robes de lin réservées aux prêtres, les jeûnes, l’abstinence du porc et d’autres viandes, la circoncision, le bouc émissaire, tout enfin fut imité de l’Égypte.
Les Juifs avouent qu’ils n’ont eu un temple que fort tard, et plus de cinq cents ans après leur Moïse, selon leur chronologie toujours erronée. Ils envahirent enfin une petite ville dans laquelle ils bâtirent un temple à l’imitation des grands peuples. Qu’avaient-ils auparavant ? un coffre. C’était l’usage des nomades et des peuples chananéens de l’intérieur des terres, qui étaient pauvres. Il y avait une ancienne tradition chez la horde juive, que lorsqu’elle fut nomade, c’est-à-dire lorsqu’elle fut errante dans les déserts de l’Arabie Pétrée, elle portait un coffre où était le simulacre grossier d’un dieu nommé Remphan, où une espèce d’étoile taillée en bois[1]. Vous verrez des traces de ce culte dans quelques prophètes, et surtout dans les prétendus discours que les Actes des apôtres mettent dans la bouche d’Étienne.
Selon les Juifs mêmes, les Phéniciens (qu’ils appellent Philistins) avaient le temple de Dagon avant que la troupe judaïque eût une maison. Si la chose est ainsi, si tout leur culte dans le désert consista dans un coffre à l’honneur du dieu Remphan, qui n’était qu’une étoile révérée par les Arabes, il est clair que les Juifs n’étaient autre chose, dans leur origine, qu’une bande d’Arabes vagabonds qui s’établirent par le brigandage dans la Palestine, et qui enfin se firent une religion à leur mode, et se composèrent une histoire toute pleine de fables. Ils prirent une partie de la fable de l’ancien Back ou Bacchus, dont ils firent leur Moïse. Mais, que ces fables soient révérées par nous ; que nous en ayons fait la base de notre religion, et que ces fables mêmes aient encore un certain crédit dans le siècle de la philosophie, c’est là surtout ce qui indigne les sages. L’Église chrétienne chante les prières juives, et fait brûler quiconque judaïse. Quelle pitié ! quelle contradiction ! et quelle horreur !
Chapitre VI. De la Genèse.
Tous les peuples dont les Juifs étaient entourés avaient une Genèse, une Théogonie, une Cosmogonie, longtemps avant que ces Juifs existassent. Ne voit-on pas évidemment que la Genèse des Juifs était prise des anciennes fables de leurs voisins ?
Jaho, l’ancien dieu des Phéniciens, débrouilla le chaos, le Khaütereb ; il arrangea Muth, la matière ; il forma l’homme de son souffle, Calpi ; il lui fit habiter un jardin, Aden ou Éden ; il le défendit contre le grand serpent Ophionée, comme le dit l’ancien fragment de Phérécide. Que de conformité avec la Genèse juive ! N’est-il pas naturel que le petit peuple grossier ait, dans la suite des temps, emprunté les fables du grand peuple inventeur des arts ?
C’était encore une opinion reçue dans l’Asie que Dieu avait formé le monde en six temps, appelés chez les Chaldéens, si antérieurs aux Juifs, les six gahamhârs.
C’était aussi une opinion des anciens Indiens. Les Juifs, qui écrivirent la Genèse, ne sont donc que des imitateurs ; ils mêlèrent leurs propres absurdités à ces fables, et il faut avouer qu’on ne peut s’empêcher de rire quand on voit un serpent parlant familièrement à Ève, Dieu parlant au serpent. Dieu se promenant chaque jour à midi dans le jardin d’Éden, Dieu faisant une culotte pour Adam et un pagne à sa femme Ève. Tout le reste paraît aussi insensé ; plusieurs Juifs eux-mêmes en rougirent ; ils traitèrent dans la suite ces imaginations de fables allégoriques. Comment pourrions-nous prendre au pied de la lettre ce que les Juifs ont regardé comme des contes ?
Ni l’histoire des Juges, ni celle des Rois, ni aucun prophète, ne cite un seul passage de la Genèse. Nul n’a parlé ni de la côte d’Adam, tirée de sa poitrine pour en pétrir une femme, ni de l’arbre de la science du bien et du mal, ni du serpent qui séduisit Ève, ni du péché originel, ni enfin d’aucune de ces imaginations. Encore une fois, est-ce à nous de les croire ?
Leurs rapsodies démontrent qu’ils ont pillé toutes leurs idées chez les Phéniciens, les Chaldéens, les Égyptiens, comme ils ont pillé leurs biens quand ils l’ont pu. Le nom même d’Israël, ils l’ont pris chez les Chaldéens, comme Philon l’avoue dans la première page du récit de sa députation auprès de Caligula[1] ; et nous serions assez imbéciles dans notre Occident pour penser que tout ce que ces barbares d’Orient avaient volé leur appartenait en propre !
Chapitre VII. Des mœurs des juifs.
Si nous passons des fables des Juifs aux mœurs de ce peuple, ne sont-elles pas aussi abominables que leurs contes sont absurdes ? C’est, de leur aveu, un peuple de brigands qui emportent dans un désert tout ce qu’ils ont volé aux Égyptiens. Leur chef Josué passe le Jourdain par un miracle semblable au miracle de la mer Rouge ; pourquoi ? pour aller mettre à feu et à sang une ville qu’il ne connaissait pas, une ville dont son Dieu fait tomber les murs au son du cornet.
Les fables des Grecs étaient plus humaines. Amphion bâtissait des villes au son de la flûte, Josué les détruit ; il livre au fer et aux flammes vieillards, femmes, enfants et bestiaux : y a-t-il une horreur plus insensée ? Il ne pardonne qu’à une prostituée qui avait trahi sa patrie ; quel besoin avait-il de la perfidie de cette malheureuse, puisque son cornet faisait tomber les murs, comme celui d’Astolphe faisait fuir tout le monde ? Et remarquons en passant que cette femme, nommée Rahab la paillarde, est une des aïeules de ce Juif dont nous avons fait depuis un dieu, lequel dieu compte encore parmi celles dont il est né l’incestueuse Thamar, l’impudente Ruth, et l’adultère Bethsabée.
On nous conte ensuite que ce même Josué fit pendre trente et un rois du pays, c’est-à-dire trente et un capitaines de village qui avaient combattu pour leurs foyers contre cette troupe d’assassins. Si l’auteur de cette histoire avait formé le dessein de rendre les Juifs exécrables aux autres nations, s’y serait-il pris autrement ? L’auteur, pour ajouter le blasphème au brigandage et à la barbarie, ose dire que toutes ces abominations se commettaient au nom de Dieu, par ordre exprès de Dieu, et étaient autant de sacrifices de sang humain offerts à Dieu.
C’est là le peuple saint ! Certes, les Hurons, les Canadiens, les Iroquois, ont été des philosophes pleins d’humanité, comparés aux enfants d’Israël ; et c’est en faveur de ces monstres qu’on fait arrêter le soleil et la lune en plein midi ! et pourquoi ? pour leur donner le temps de poursuivre et d’égorger de pauvres Amorrhéens déjà écrasés par une pluie de grosses pierres que Dieu avait lancées sur eux du haut des airs pendant cinq grandes lieues de chemin. Est-ce l’histoire de Gargantua ? est-ce celle du peuple de Dieu ? Et qu’y a-t-il ici de plus insupportable, ou l’excès de l’horreur, ou l’excès du ridicule ? Ne serait-ce pas même un autre ridicule que de s’amuser à combattre ce détestable amas de fables qui outragent également le bon sens, la vertu, la nature, et la Divinité ? Si malheureusement une seule des aventures de ce peuple était vraie, toutes les nations se seraient réunies pour l’exterminer ; si elles sont fausses, on ne peut mentir plus sottement.
Que dirons-nous d’un Jephté qui immole sa propre fille à son Dieu sanguinaire, et de l’ambidextre Aod qui assassine Églon son roi au nom du Seigneur, et de la divine Jahel, qui assassine le général Sizara avec un clou qu’elle lui enfonce dans la tête ; et du débauché Samson, que Dieu favorise de tant de miracles, grossière imitation de la fable d’Hercule ?
Parlerons-nous d’un lévite qui vient sur son âne avec sa concubine, et de la paille et du foin, dans Gabaa, de la tribu de Benjamin ? et voilà les Benjamites qui veulent commettre le péché de sodomie avec ce vilain prêtre, comme les Sodomites avaient voulu le commettre avec des anges[1]. Le lévite compose avec eux, et leur abandonne sa maîtresse ou sa femme, dont ils jouissent toute la nuit, et qui en meurt le lendemain matin. Le lévite coupe sa concubine en douze morceaux avec son couteau, ce qui n’est pourtant pas une chose si aisée, et de là s’ensuit une guerre civile.
Les onze tribus arment quatre cent mille soldats contre la tribu de Benjamin. Quatre cent mille soldats, grand Dieu ! dans un territoire qui n’était pas alors de quinze lieues de longueur sur cinq ou six de largeur. Le Grand Turc n’a jamais eu la moitié d’une telle armée. Ces Israélites exterminent la tribu de Benjamin, vieillards, jeunes gens, femmes, filles, selon leur louable coutume. Il échappe six cents garçons. Il ne faut pas qu’une des tribus périsse : il faut donner six cents filles au moins à ces six cents garçons. Que font les Israélites ? Il y avait dans le voisinage une petite ville nommée Jabès ; ils la surprennent, tuent tout, massacrent tout, jusqu’aux animaux, réservent quatre cents filles pour quatre cents Benjamites. Deux cents garçons restent à pourvoir ; on convient avec eux qu’ils raviront deux cents filles de Silo, quand elles iront danser aux portes de Silo. Allons, Abbadie, Sherlockh, Houteville et consorts, faites des phrases pour justifier ces fables de cannibales ; prouvez que tout cela est un type, une figure qui nous annonce Jésus-Christ.
Chapitre VIII. Des mœurs des juifs sous leurs melchim ou roitelets, et sous leurs pontifes, jusqu’à la destruction de Jérusalem par les Romains.
Les Juifs ont un roi malgré le prêtre Samuel, qui fait ce qu’il peut pour conserver son autorité usurpée ; et il a la hardiesse de dire que c’est renoncer à Dieu que d’avoir un roi. Enfin, un pâtre qui cherchait des ânesses est élu roi par le sort. Les Juifs étaient alors sous le joug des Chananéens ; ils n’avaient jamais eu de temple ; leur sanctuaire, comme nous l’avons vu, était un coffre qu’on mettait dans une charrette : les Chananéens leur avaient pris leur coffre ; Dieu, qui en fut très-irrité, l’avait pourtant laissé prendre ; mais, pour se venger, il avait donné des hémorroïdes aux vainqueurs et envoyé des rats dans leurs champs. Les vainqueurs l’apaisèrent en lui renvoyant son coffre accompagné de cinq rats d’or et de cinq trous du cul aussi d’or. Il n’y a point de vengeance ni d’offrande plus digne du Dieu des Juifs. Il pardonne aux Chananéens, mais il fait mourir cinquante mille et soixante et dix hommes des siens pour avoir regardé son coffre.
C’est dans ces belles circonstances que Saül est élu roi des Juifs. Il n’y avait dans leur petit pays ni épée ni lance ; les Chananéens ou Philistins ne permettaient pas aux Juifs, leurs esclaves, d’aiguiser seulement les socs de leurs charrues et leurs cognées ; ils étaient obligés d’aller aux ouvriers philistins pour ces faibles secours : et cependant on nous conte que le roi Saül eut d’abord une armée de trois cent mille hommes, avec lesquels il gagna une grande bataille. Notre Gulliver a de pareilles fables, mais non de telles contradictions.
Ce Saül, dans une autre bataille, reçoit le prétendu roi Agag à composition. Le prophète Samuel arrive de la part du Seigneur, et lui dit : Pourquoi n’avez-vous pas tout tué ? Et il prend un saint couperet, et il hache en morceaux le roi Agag. Si une telle action est véritable, quel peuple était le peuple juif, et quels prêtres étaient ses prêtres !
Saül, réprouvé du Seigneur pour n’avoir pas lui-même haché en pièces le roi Agag son prisonnier, va enfin combattre contre les Philistins après la mort du doux prophète Samuel. Il consulte sur le succès de la bataille une femme qui a un esprit de Python : on sait que les femmes qui ont un esprit de Python font apparaître des ombres, La pythonisse montre à Saül l’ombre de Samuel, qui sortait de la terre. Mais ceci ne regarde que la belle philosophie du peuple juif : venons à sa morale.
Un joueur de harpe, pour qui l’Éternel avait pris une tendre affection, s’est fait sacrer roi pendant que Samuel vivait encore ; il se révolte contre son souverain ; il ramasse quatre cents malheureux, et, comme dit la sainte Écriture, « tous ceux qui avaient de mauvaises affaires, qui étaient perdus de dettes, et d’un esprit méchant, s’assemblèrent avec lui ».
C’était un homme selon le cœur de Dieu ; aussi la première chose qu’il veut faire est d’assassiner un tenancier nommé Nabal, qui lui refuse des contributions : il épouse sa veuve ; il épouse dix-huit femmes, sans compter les concubines ; il s’enfuit chez le roi Achis, ennemi de son pays ; il y est bien reçu, et pour récompense il va saccager les villages des alliés d’Achis : il égorge tout, sans épargner les enfants à la mamelle, comme l’ordonne toujours le rite juif, et il fait accroire au roi Achis qu’il a saccagé les villages hébreux. Il faut avouer que nos voleurs de grand chemin ont été moins coupables aux yeux des hommes ; mais les voies du Dieu des Juifs ne sont pas les nôtres.
Le bon roi David ravit le trône à Isboseth, fils de Saül. Il fait assassiner Miphiboseth, fils de son protecteur Jonathas. Il livre aux Gabaonites deux enfants de Saül et cinq de ses petits-enfants, pour les faire tous pendre. Il assassine Urie pour couvrir son adultère avec Bethsabée ; et c’est encore cette abominable Bethsabée, mère de Salomon, qui est une aïeule de Jésus-Christ.
La suite de l’Histoire juive n’est qu’un tissu de forfaits consacrés. Salomon commence par égorger son frère Adonias. Si Dieu accorda à ce Salomon le don de la sagesse, il paraît qu’il lui refusa ceux de l’humanité, de la justice, de la continence, et de la foi. Il a sept cents femmes et trois cents concubines. Le cantique qu’on lui impute est dans le goût de ces livres érotiques qui font rougir la pudeur. Il n’y est parlé que de tétons, de baisers sur la bouche, de ventre qui est semblable à un monceau de froment, d’attitudes voluptueuses, de doigts mis dans l’ouverture, de tressaillement ; et enfin il finit par dire : « Que ferons-nous de notre petite sœur ? Elle n’a point encore de tétons ; si c’est un mur, bâtissons dessus ; si c’est une porte, fermons-la. » Telles sont les mœurs du plus sage des Juifs, ou du moins les mœurs que lui imputent avec respect de misérables rabbins et des théologiens chrétiens encore plus absurdes.
Enfin, pour joindre l’excès du ridicule à cet excès d’impureté, la secte des papistes a décidé que le ventre de la Sulamite et son ouverture, ses tétons et ses baisers sur la bouche, sont l’emblème, le type du mariage de Jésus-Christ avec son Église[1].
De tous les rois de Juda et de Samarie, il y en a très-peu qui ne soient assassins ou assassinés, jusqu’à ce qu’enfin ce ramas de brigands qui se massacraient les uns les autres dans les places publiques et dans le temple, pendant que Titus les assiégeait, tombe sous le fer, et dans les chaînes des Romains avec le reste de ce petit peuple de Dieu, dont dix douzièmes avaient été dispersés depuis si longtemps en Asie, et soit vendu dans les marchés des villes romaines, chaque tête juive étant évaluée au prix d’un porc, animal moins impur que cette nation même, si elle fut telle que ses historiens et ses prophètes le racontent.
Personne ne peut nier que les Juifs n’aient écrit ces abominations. Quand on les rassemble ainsi sous les yeux, le cœur se soulève. Ce sont donc là les hérauts de la Providence, les précurseurs du règne de Jésus ! Toute l’histoire juive, dites-vous, ô Abbadie ! est la prédiction de l’Église ; tous les prophètes ont prédit Jésus ; examinons donc les prophètes.
Chapitre IX. Des prophètes.
Prophète, nabi, roëh, parlant, voyant, devin, c’est la même chose. Tous les anciens auteurs conviennent que les Égyptiens, les Chaldéens, toutes les nations asiatiques, avaient leurs prophètes, leurs devins. Ces nations étaient bien antérieures au petit peuple juif, qui, lorsqu’il eut composé une horde dans un coin de terre, n’eut d’autre langage que celui de ses voisins, et qui, comme on l’a dit ailleurs, emprunta des Phéniciens jusqu’au nom de Dieu Éloha, Jehova, Adonaï, Sadaï ; qui enfin prit tous les rites, tous les usages des peuples dont il était environné, en déclamant toujours contre ces mêmes peuples.
Quelqu’un a dit que le premier devin, le premier prophète fut le premier fripon qui rencontra un imbécile ; ainsi la prophétie est de l’antiquité la plus haute. Mais à la fraude ajoutons encore le fanatisme ; ces deux monstres habitent aisément ensemble dans les cervelles humaines. Nous avons vu arriver à Londres par troupes, du fond du Languedoc et du Vivarais, des prophètes, tout semblables à ceux des Juifs, joindre le plus horrible enthousiasme aux plus dégoûtants mensonges. Nous avons vu Jurieu prophétiser en Hollande. Il y eut de tout temps de tels imposteurs, et non-seulement des misérables qui faisaient des prédictions, mais d’autres misérables qui supposaient des prophéties faites par d’anciens personnages.
Le monde a été plein de sibylles et de Nostradamus. L’Alcoran compte deux cent vingt-quatre mille prophètes. L’évêque Épiphane, dans ses notes sur le canon prétendu des apôtres, compte soixante et treize prophètes juifs et dix prophétesses. Le métier de prophète chez les Juifs n’était ni une dignité, ni un grade, ni une profession dans l’État ; on n’était point reçu prophète comme on est reçu docteur à Oxford ou à Cambridge : prophétisait qui voulait ; il suffisait d’avoir, ou de croire avoir, ou de feindre d’avoir la vocation et l’esprit de Dieu. On annonçait l’avenir en dansant et en jouant du psaltérion. Saül, tout réprouvé qu’il était, s’avisa d’être prophète. Chaque parti dans les guerres civiles avait ses prophètes, comme nous avons nos écrivains de Grub-street. Les deux partis se traitaient réciproquement de fous, de visionnaires, de menteurs, de fripons, et en cela seul ils disaient la vérité. Scitote Israel stultum prophetam, insanum virum spiritualem, dit Osée, selon la Vulgate.
Les prophètes de Jérusalem sont des extravagants, des hommes sans foi, dit Sophoniah, prophète de Jérusalem. Ils sont tous comme notre apothicaire Moore, qui met dans nos gazettes : Prenez de mes pilules, gardez-vous des contrefaites.
Le prophète Michée prédisant des malheurs aux rois de Samarie et de Juda, le prophète Sédékias lui applique un énorme soufflet, en lui disant : Comment l’esprit de Dieu est-il passé par moi pour aller à toi.
Jérémie, qui prophétisait en faveur de Nabuchodonosor, tyran des Juifs, s’était mis des cordes au cou et un bât ou un joug sur le dos, car c’était un type ; et il devait envoyer ce type aux petits roitelets voisins, pour les inviter à se soumettre à Nabuchodonosor. Le prophète Hananias, qui regardait Jérémie comme un traître, lui arrache ses cordes, les rompt, et jette son bât à terre.
Ici, c’est Osée à qui Dieu ordonne de prendre une p….. et d’avoir des fils de p….. : Vade, sume tibi uxorem fornicationem, et fac tibi filios fornicationum, dit la Vulgate. Osée obéit ponctuellement ; il prend Gomer, fille d’Ébalaïm ; il en a trois enfants : ainsi cette prophétie et ce putanisme durèrent au moins trois années. Cela ne suffit pas au Dieu des Juifs ; il veut qu’Osée couche avec une femme qui ait fait déjà son mari cocu. Il n’en coûte au prophète que quinze drachmes et un boisseau et demi d’orge : c’est assez bon marché pour un adultère[1]. Il en avait coûté encore moins au patriarche Juda pour son inceste avec sa bru Thamar.
Là, c’est Ézéchiel qui, après avoir reçu de Dieu l’ordre de dormir trois cent nonante jours sur le côté gauche, et quarante sur le côté droit, d’avaler un livre de parchemin, de manger un sir reverend[2] sur son pain, introduit Dieu lui-même, le créateur du monde, parlant ainsi à la jeune Oolla : « Tu es devenue grande, tes tétons ont paru, ton petit poil a commencé à croître ; je t’ai couverte, mais tu t’es bâti un mauvais lieu ; tu as ouvert tes cuisses à tous les passants….. Ta sœur Ooliba s’est prostituée avec plus d’emportement ; elle a recherché ceux qui ont le membre d’un âne, et qui déchargent comme des chevaux. »
Notre ami le général Withers, à qui on lisait un jour ces prophéties, demanda dans quel b…. on avait fait l’Écriture sainte.
On lit rarement les prophéties ; il est difficile de soutenir la lecture de ces longs et énormes galimatias. Les gens du monde, qui ont lu Gulliver et l’Atlantis, ne connaissent ni Osée ni Ézéchiel.
Quand on fait voir à des personnes sensées ces passages exécrables, noyés dans le fatras des prophéties, elles ne reviennent point de leur étonnement. Elles ne peuvent concevoir qu’un Isaïe marche tout nu au milieu de Jérusalem, qu’un Ézéchiel coupe sa barbe en trois portions, qu’un Jonas soit trois jours dans le ventre d’une baleine, etc. Si elles lisaient ces extravagances et ces impuretés dans un des livres qu’on appelle profanes, elles jetteraient le livre avec horreur. C’est la Bible : elles demeurent confondues ; elles hésitent, elles condamnent ces abominations, et n’osent d’abord condamner le livre qui les contient. Ce n’est qu’avec le temps qu’elles osent faire usage de leur sens commun ; elles finissent enfin par détester ce que des fripons et des imbéciles leur ont fait adorer.
Quand ces livres sans raison et sans pudeur ont-ils été écrits ? Personne n’en sait rien. L’opinion la plus vraisemblable est que la plupart des livres attribués à Salomon, à Daniel, et à d’autres, ont été faits dans Alexandrie ; mais qu’importe, encore une fois, le temps et le lieu ? Ne suffit-il pas de voir avec évidence que ce sont des monuments de la folie la plus outrée et de la plus infâme débauche ?
Comment donc les Juifs ont-ils pu les vénérer ? C’est qu’ils étaient des Juifs. Il faut encore considérer que tous ces monuments d’extravagance ne se conservaient guère que chez les prêtres et les scribes. On sait combien les livres étaient rares dans tous les pays où l’imprimerie, inventée par les Chinois, ne parvint que si tard. Nous serons encore plus étonnés quand nous verrons les Pères de l’Église adopter ces rêveries dégoûtantes, ou les alléguer en preuve de leur secte.
Venons enfin de l’Ancien Testament au Nouveau. Venons à Jésus, et à l’établissement du christianisme ; et, pour y arriver, passons par-dessus les assassinats de tant de rois, et par-dessus les enfants jetés au milieu des flammes dans la vallée de Tophet, ou écrasés dans des torrents sous des pierres. Glissons sur cette suite affreuse et non interrompue d’horreurs sacriléges. Misérables Juifs ! c’est donc chez vous que naquit un homme de la lie du peuple qui portait le nom très-commun de Jésus ! Voyons quel était ce Jésus.
Chapitre X. De la personne de Jésus.
Jésus naquit dans un temps où le fanatisme dominait encore, mais où il y avait un peu plus de décence. Le long commerce des Juifs avec les Grecs et les Romains avait donné aux principaux de la nation des mœurs un peu moins déraisonnables et moins grossières. Mais la populace, toujours incorrigible, conservait son esprit de démence. Quelques Juifs, opprimés sous les rois de Syrie et sous les Romains, avaient imaginé alors que leur Dieu leur enverrait quelque jour un libérateur, un messie. Cette attente devait naturellement être remplie par Hérode. Il était leur roi, il était l’allié des Romains, il avait rebâti leur temple, dont l’architecture surpassait de beaucoup celle du temple de Salomon, puisqu’il avait comblé un précipice sur lequel cet édifice était établi. Le peuple ne gémissait plus sous une domination étrangère ; il ne payait d’impôts qu’à son monarque ; le culte juif florissait, les lois antiques étaient respectées ; Jérusalem, il faut l’avouer, était au temps de sa plus grande splendeur.
L’oisiveté et la superstition firent naître plusieurs factions ou sociétés religieuses, saducéens, pharisiens, esséniens, judaïtes, thérapeutes, joannistes ou disciples de Jean ; à peu près comme les papistes ont des molinistes, des jansénistes, des jacobins, et des cordeliers. Mais personne alors ne parlait de l’attente du messie. Ni Flavius Josèphe, ni Philon, qui sont entrés dans de si grands détails sur l’histoire juive, ne disent qu’on se flattait alors qu’il viendrait un christ, un oint, un libérateur, un rédempteur, dont ils avaient moins besoin que jamais ; et s’il y en avait un, c’était Hérode. En effet, il y eut un parti, une secte, qu’on appela les hérodiens, et qui reconnut Hérode pour l’envoyé de Dieu.
De tout temps ce peuple avait donné le nom d’oint, de messie, de christ, à quiconque leur avait fait un peu de bien : tantôt à leurs pontifes, tantôt aux princes étrangers. Le Juif qui compila les rêveries d’Isaïe lui fait dire, par une lâche flatterie bien digne d’un Juif esclave : « Ainsi a dit l’Éternel à Cyrus, son oint, son messie, duquel j’ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui. » Le quatrième livre des Rois appelle le scélérat Jehu oint, messie. Un prophète annonce à Hazaël, roi de Damas, qu’il est messie et oint du Très-Haut. Ézéchiel dit au roi de Tyr : « Tu es un chérubin, un oint, un messie, le sceau de la ressemblance de Dieu. » Si ce roi de Tyr avait su qu’on lui donnait ces titres en Judée, il ne tenait qu’à lui de se faire une espèce de dieu ; il y avait un droit assez apparent, supposé qu’Ézéchiel eût été inspiré. Les évangélistes n’en ont pas tant dit de Jésus.
Quoi qu’il en soit, il est certain que nul Juif n’espérait, ne désirait, n’annonçait un oint, un messie, du temps d’Hérode le Grand, sous lequel on dit que naquit Jésus, Lorsqu’après la mort d’Hérode le Grand la Judée fut gouvernée en province romaine, et qu’un autre Hérode fut établi par les Romains tétrarque du petit canton barbare de Galilée, plusieurs fanatiques s’ingérèrent de prêcher le bas peuple, surtout dans cette Galilée, où les Juifs étaient plus grossiers qu’ailleurs. C’est ainsi que Fox, un misérable paysan, établit de nos jours la secte des quakers parmi les paysans d’une de nos provinces. Le premier qui fonda en France une église calviniste fut un cardeur de laine nommé Jean Leclerc. C’est ainsi que Muncer, Jean de Leyde, et d’autres, fondèrent l’anabaptisme dans le bas peuple de quelques cantons d’Allemagne.
J’ai vu en France les convulsionnaires instituer une petite secte parmi la canaille d’un faubourg de Paris. Tous les sectaires commencent ainsi dans toute la terre. Ce sont pour la plupart des gueux qui crient contre le gouvernement, et qui finissent ou par être chefs de parti, ou par être pendus. Jésus fut pendu à Jérusalem sans avoir été oint. Jean le baptiseur y avait déjà été condamné au supplice. Tous deux laissèrent quelques disciples dans la lie du peuple. Ceux de Jean s’établirent vers l’Arabie, où ils sont encore. Ceux de Jésus furent d’abord très-obscurs ; mais quand ils se furent associés à quelques Grecs, ils commencèrent à être connus.
Les Juifs ayant, sous Tibère, poussé plus loin que jamais leurs friponneries ordinaires, ayant surtout séduit et volé Fulvia, femme de Saturninus, furent chassés de Rome, et ils n’y furent rétablis qu’en donnant beaucoup d’argent. On les punit encore sévèrement sous Caligula et sous Claude.
Leurs désastres enhardirent le peu de Galiléens qui composaient la secte nouvelle à se séparer de la communion juive. Ils trouvèrent enfin quelques gens un peu lettrés qui se mirent à leur tête, et qui écrivirent en leur faveur contre les Juifs. Ce fut ce qui produisit cette énorme quantité d’Évangiles, mot grec qui signifie bonne nouvelle. Chacun donnait une Vie de Jésus ; aucunes n’étaient d’accord, mais toutes se ressemblaient par la quantité de prodiges incroyables qu’ils attribuaient à l’envi à leur fondateur.
La synagogue, de son côté, voyant qu’une secte nouvelle, née dans son sein, débitait une Vie de Jésus très-injurieuse au sanhédrin et à la nation, rechercha quel était cet homme auquel elle n’avait point fait d’attention jusqu’alors. Il nous reste encore un mauvais ouvrage de ce temps-là, intitulé Sepher Toldos Jeschut. Il paraît qu’il est fait plusieurs années après le supplice de Jésus, dans le temps que l’on compilait les Évangiles. Ce petit livre est rempli de prodiges, comme tous les livres juifs et chrétiens ; mais, tout extravagant qu’il est, on est forcé de convenir qu’il y a des choses beaucoup plus vraisemblables que dans nos Évangiles.
Il est dit, dans le Toldos Jeschut, que Jésus était le fils d’une nommée Mirja, mariée dans Bethléem à un pauvre homme nommé Jocanam. Il y avait dans le voisinage un soldat dont le nom était Joseph Panther, homme d’une riche taille, et d’une assez grande beauté ; il devient amoureux de Mirja ou Maria (car les Hébreux, n’exprimant point les voyelles, prenaient souvent un A pour un I).
Mirja devint grosse de la façon de Panther ; Jocanam, confus et désespéré, quitta Bethléem, et alla se cacher dans la Babylonie, où il y avait encore beaucoup de Juifs. La conduite de Mirja la déshonora ; son fils Jésu ou Jeschut fut déclaré bâtard par les juges de la ville. Quand il fut parvenu à l’âge d’aller à l’école publique, il se plaça parmi les enfants légitimes ; on le fit sortir de ce rang : de là son animosité contre les prêtres, qu’il manifesta quand il eut atteint l’âge mûr ; il leur prodigua les injures les plus atroces, les appelant races de vipères, sépulcres blanchis. Enfin, ayant pris querelle avec le Juif Judas sur quelque matière d’intérêt, comme sur des points de religion, Judas le dénonça au sanhédrin ; il fut arrêté, se mit à pleurer, demanda pardon, mais en vain : on le fouetta, on le lapida, et ensuite on le pendit.
Telle est la substance de cette histoire. On y ajouta depuis des fables insipides, des miracles impertinents, qui firent grand tort au fond ; mais le livre était connu dans le second siècle ; Celse le cita, Origène le réfuta ; il nous est parvenu fort défiguré.
Ce fond que je viens de citer est certainement plus croyable, plus naturel, plus conforme à ce qui se passe tous les jours dans le monde qu’aucun des cinquante Évangiles des christicoles. Il est plus vraisemblable que Joseph Panther avait fait un enfant à Mirja qu’il ne l’est qu’un ange soit venu par les airs faire un compliment de la part de Dieu à la femme d’un charpentier, comme Jupiter envoya Mercure auprès d’Alcmène.
Tout ce qu’on nous conte de ce Jésus est digne de l’Ancien Testament et de Bedlam. On fait venir je ne sais quel agion pneuma, un saint souffle, un Saint-Esprit dont on n’avait jamais entendu parler, et dont on a fait depuis la tierce partie de Dieu, Dieu lui-même. Dieu le créateur du monde ; il engrosse Marie, ce qui a donné lieu au jésuite Sanchez d’examiner, dans sa Somme théologique, si Dieu eut beaucoup de plaisir avec Maria, s’il répandit de la semence, et si Maria répandit aussi de sa semence.
Jésus devient donc un fils de Dieu et d’une Juive, non encore Dieu lui-même, mais une créature supérieure. Il fait des miracles. Le premier qu’il opère, c’est de se faire emporter par le diable sur le haut d’une montagne de Judée, d’où l’on découvre tous les royaumes de la terre. Ses vêtements paraissent tout blancs ; quel miracle ! il change l’eau en vin dans un repas où tous les convives étaient déjà ivres[1]. Il fait sécher un figuier qui ne lui a pas donné de figues à son déjeuner à la fin de février ; et l’auteur de ce conte a l’honnêteté du moins de remarquer que ce n’était pas le temps des figues.
Il va souper chez des filles, et puis chez les douaniers ; et cependant, on prétend, dans son histoire, qu’il regarde ces douaniers, ces publicains, comme des gens abominables. Il entre dans le temple, c’est-à-dire dans cette grande enceinte où demeuraient les prêtres, dans cette cour où de petits marchands étaient autorisés par la loi à vendre des poules, des pigeons, des agneaux, à ceux qui venaient sacrifier. Il prend un grand fouet, en donne sur les épaules de tous les marchands, les chasse à coups de lanières, eux, leurs poules, leurs pigeons, leurs moutons, et leurs bœufs même, jette tout leur argent par terre, et on le laisse faire ! Et si l’on en croit le livre attribué à Jean, on se contente de lui demander un miracle pour prouver qu’il a droit de faire un pareil tapage dans un lieu si respectable.
C’était déjà un fort grand miracle que trente ou quarante marchands se laissassent fesser par un seul homme, et perdissent leur argent sans rien dire. Il n’y a rien dans Don Quichotte qui approche de cette extravagance. Mais au lieu de faire le miracle qu’on lui demande, il se contente de dire : Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en trois jours. Les Juifs repartent, selon Jean : On a mis quarante-six ans à bâtir ce temple, comment en trois jours le rebâtiras-tu ?
Il était bien faux qu’Hérode eût employé quarante-six ans à bâtir le temple de Jérusalem. Les Juifs ne pouvaient pas répondre une pareille fausseté. Et, pour le dire en passant, cela fait bien voir que les Évangiles ont été écrits par des gens qui n’étaient au fait de rien.
Tous ces miracles semblent faits par nos charlatans de Smithfields. Notre Toland et notre Woolston les ont traités comme ils le méritent. Le plus beau de tous, à mon gré, est celui par lequel Jésus envoie le diable dans le corps de deux mille cochons, dans un pays où il n’y avait point de cochons.
Après cette belle équipée on fait prêcher Jésus dans les villages. Quels discours lui fait-on tenir ? Il compare le royaume des cieux à un grain de moutarde, à un morceau de levain mêlé dans trois mesures de farine, à un filet avec lequel on pêche de bon et de mauvais poisson, à un roi qui a tué ses volailles pour les noces de son fils, et qui envoie ses domestiques prier les voisins à la noce. Les voisins tuent les gens qui viennent les prier à dîner ; le roi tue ceux qui ont tué ses gens, et brûle leurs villes ; il envoie prendre les gueux qu’on rencontre sur le grand chemin pour venir dîner avec lui. Il aperçoit un pauvre convive qui n’avait point de robe, et au lieu de lui en donner une, il le fait jeter dans un cachot. Voilà ce que c’est que le royaume des cieux selon Matthieu.
Dans les autres sermons, le royaume des cieux est toujours comparé à un usurier qui veut absolument avoir cent pour cent de bénéfice. On m’avouera que notre archevêque Tillotson prêche dans un autre goût.
Par où finit l’histoire de Jésus ? par l’aventure qui est arrivée chez nous et dans le reste du monde à bien des gens qui ont voulu ameuter la populace, sans être assez habiles, ou pour armer cette populace, ou pour se faire de puissants protecteurs ; ils finissent la plupart par être pendus. Jésus le fut en effet pour avoir appelé ses supérieurs races de vipères et sépulcres blanchis. Il fut exécuté publiquement, mais il ressuscita en secret. Ensuite il monta au ciel en présence de quatre-vingts de ses disciples[2], sans qu’aucune autre personne de la Judée le vît monter dans les nuées : ce qui était pourtant fort aisé à voir, et qui aurait fait dans le monde une assez grande nouvelle.
Notre symbole, que les papistes appellent le Credo, symbole attribué aux apôtres, et évidemment fabriqué plus de quatre cents ans après ces apôtres, nous apprend que Jésus, avant de monter au ciel, était allé faire un tour aux enfers. Vous remarquerez qu’il n’en est pas dit un seul mot dans les Évangiles, et cependant c’est un des principaux articles de la foi des christicoles ; on n’est point chrétien si on ne croit pas que Jésus est allé aux enfers.
Qui donc a imaginé le premier ce voyage ? Ce fut Athanase, environ trois cent cinquante ans après ; c’est dans son traité contre Apollinaire, sur l’incarnation du Seigneur, qu’il dit que l’âme de Jésus descendit en enfer, tandis que son corps était dans le sépulcre. Ces paroles sont dignes d’attention, et font voir avec quelle sagacité et quelle sagesse Athanase raisonnait. Voici ses propres paroles :
« Il fallait qu’après sa mort ses parties essentiellement diverses eussent diverses fonctions ; que son corps reposât dans le sépulcre pour détruire la corruption, et que son âme allât aux enfers pour vaincre la mort. »
L’Africain Augustin est du sentiment d’Athanase dans une lettre qu’il écrivit à Évodé : Quis ergo nisi infidelis negaverit fuisse apud inferos Christum ? Jérôme, son contemporain, fut à peu près du même avis, et ce fut du temps d’Augustin et de Jérôme que l’on composa ce symbole, ce Credo, qui passe chez les ignorants pour le symbole des apôtres[3].
Ainsi s’établissent les opinions, les croyances, les sectes. Mais comment ces détestables fadaises ont-elles pu s’accréditer ? comment ont-elles renversé les autres fadaises des Grecs et des Romains, et enfin l’empire même ? comment ont-elles causé tant de maux, tant de guerres civiles, allumé tant de bûchers, et fait couler tant de sang ? C’est de quoi nous rendrons un compte exact.
Chapitre XI. Quelle idée il faut se former de jésus et de ses disciples.
Jésus est évidemment un paysan grossier de la Judée, plus éveillé, sans doute, que la plupart des habitants de son canton. Il voulut, sans savoir, à ce qu’il paraît, ni lire ni écrire, former une petite secte pour l’opposer à celles des récabites, des judaïtes, des thérapeutes, des esséniens, des pharisiens, des saducéens, des hérodiens : car tout était secte chez les malheureux Juifs, depuis leur établissement dans Alexandrie. Je l’ai déjà comparé à notre Fox, qui était comme lui un ignorant de la lie du peuple, prêchant quelquefois comme lui une bonne morale, et prêchant surtout l’égalité, qui flatte tant la canaille. Fox établit comme lui une société qui s’écarta peu de temps après de ses principes, supposé qu’il en eût. La même chose était arrivée à la secte de Jésus. Tous deux parlèrent ouvertement contre les prêtres de leur temps ; mais les lois étant plus humaines en Angleterre qu’en Judée, tout ce que les prêtres purent obtenir des juges, c’est qu’on mît Fox au pilori ; mais les prêtres juifs forcèrent le président Pilate à faire fouetter Jésus, et à le faire pendre à une potence en forme de croix, comme un coquin d’esclave. Cela est barbare ; chaque nation a ses mœurs. De savoir si on lui cloua les pieds et les mains, c’est ce dont il faut peu s’embarrasser. Il est, ce me semble, assez difficile de trouver sur-le-champ un clou assez long pour percer deux pieds l’un sur l’autre, comme on le prétend ; mais les Juifs étaient bien capables de cette abominable atrocité.
Les disciples demeurèrent, aussi attachés à leur patriarche pendu que les quakers l’ont été à leur patriarche pilorié. Les voilà qui s’avisent, au bout de quelque temps, de répandre le bruit que leur maître est ressuscité en secret. Cette imagination fut d’autant mieux reçue chez les confrères que c’était précisément le temps de la grande querelle élevée entre les sectes juives pour savoir si la résurrection était possible ou non. Le platonisme, qui était fort en vogue dans Alexandrie, et que plusieurs Juifs étudièrent, secourut bientôt la secte naissante ; et de là tous les mystères, tous les dogmes absurdes dont elle fut farcie. C’est ce que nous allons développer.
Chapitre XII. De l’établissement de la secte chrétienne, et particulièrement de Paul.
Quand les premiers Galiléens se répandirent parmi la populace des Grecs et des Romains, ils trouvèrent cette populace infectée de toutes les traditions absurdes qui peuvent entrer dans des cervelles ignorantes qui aiment les fables ; des dieux déguisés en taureaux, en chevaux, en cygnes, en serpents, pour séduire des femmes et des filles. Les magistrats, les principaux citoyens, n’admettaient pas ces extravagances ; mais la populace s’en nourrissait, et c’était la canaille juive qui parlait à la canaille païenne. Il me semble voir chez nous les disciples de Fox disputer contre les disciples de Brown. Il n’était pas difficile à des énergumènes juifs de faire croire leurs rêveries à des imbéciles qui croyaient des rêveries non moins impertinentes. L’attrait de la nouveauté attirait des esprits faibles, lassés de leurs anciennes sottises, et qui couraient à de nouvelles erreurs, comme la populace de la foire de Barthélémy, dégoûtée d’une ancienne farce qu’elle a trop souvent entendue, demande une farce nouvelle.
Si l’on en croit les propres livres des christicoles, Pierre, fils de Jone, demeurait à Joppé, chez Simon le corroyeur, dans un galetas où il ressuscita la couturière Dorcas.
Voyez le chapitre de Lucien, intitulé Philopatris, dans lequel il parle de ce Galiléen[1] au front chauve et au grand nez, qui fut enlevé au troisième ciel. Voyez comme il traite une assemblée de chrétiens où il se trouva. Nos presbytériens d’Écosse, et les gueux de Saint-Médard de Paris, sont précisément la même chose. Des hommes déguenillés, presque nus, au regard farouche, à la démarche d’énergumènes, poussant des soupirs, faisant des contorsions, jurant par le Fils qui est sorti du Père, prédisaient mille malheurs à l’empire, blasphémaient contre l’empereur. Tels étaient ces premiers chrétiens.
Celui qui avait donné le plus de vogue à la secte était ce Paul au grand nez et au front chauve, dont Lucien se moque. Il suffit, ce me semble, des écrits de ce Paul, pour voir combien Lucien avait raison. Quel galimatias quand il écrit à la société des chrétiens qui se formait à Rome dans la fange juive ! « La circoncision vous est profitable si vous observez la loi ; mais si vous êtes prévaricateurs de la loi, votre circoncision devient prépuce, etc… Détruisons-nous donc la loi par la foi ? à Dieu ne plaise ! mais nous établissons la foi… Si Abraham a été justifié par ses œuvres, il a de quoi se glorifier, mais non devant Dieu. » Ce Paul, en s’exprimant ainsi, parlait évidemment en juif, et non en chrétien ; mais il parlait encore plus en énergumène insensé qui ne peut pas mettre deux idées cohérentes à côté l’une de l’autre.
Quel discours aux Corinthiens ! Nos pères ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Le cardinal Bembo n’avait-il pas raison d’appeler ces épîtres epistolaccie, et de conseiller de ne les point lire ?
Que penser d’un homme qui dit aux Thessaloniciens : Je ne permets point aux femmes de parler dans l’église ; et qui dans la même épître annonce qu’elles doivent parler et prophétiser avec un voile ?
Sa querelle avec les autres apôtres est-elle d’un homme sage et modéré ? Tout ne décèle-t-il pas en lui un homme de parti ? Il s’est fait chrétien, il enseigne le christianisme, et il va sacrifier sept jours de suite dans le temple de Jérusalem par le conseil de Jacques, afin de ne point passer pour chrétien. Il écrit aux Galates : « Je vous dis, moi Paul, que si vous vous faites circoncire, Jésus-Christ ne vous servira de rien. » Et ensuite il circoncit son disciple Timothée, que les Juifs prétendent être fils d’un Grec et d’une prostituée. Il est intrus parmi les apôtres, et il se vante aux Corinthiens, Ire épître, chap. ix d’être aussi apôtre que les autres : « Ne suis-je pas apôtre ? n’ai-je pas vu notre Seigneur Jésus-Christ ? n’êtes-vous pas mon ouvrage ? Quand je ne serais pas apôtre à l’égard des autres, je le suis au moins à votre égard. N’avons-nous pas le droit d’être nourris à vos dépens ? n’avons-nous pas le pouvoir de mener avec nous une femme qui soit notre sœur (ou si l’on veut, une sœur qui soit notre femme), comme font les autres apôtres et les frères de notre Seigneur ? Qui est-ce qui va jamais à la guerre à ses dépens ? etc. »
Que de choses dans ce passage ! le droit de vivre aux dépens de ceux qu’il a subjugués, le droit de leur faire payer les dépenses de sa femme ou de sa sœur, enfin la preuve que Jésus avait des frères, et la présomption que Marie ou Mirja était accouchée plus d’une fois.
Je voudrais bien savoir de qui il parle encore dans la seconde lettre aux Corinthiens, chap. XI : « Ce sont de faux apôtres… mais ce qu’ils osent, je l’ose aussi. Sont-ils Hébreux ? je le suis aussi. Sont-ils de la race d’Abraham ? j’en suis aussi. Sont-ils ministres de Jésus-Christ ? quand ils devraient m’accuser d’impudence, je le suis encore plus qu’eux. J’ai plus travaillé qu’eux ; j’ai été plus repris de justice, plus souvent enfermé dans les cachots qu’eux. J’ai reçu trente-neuf coups de fouet cinq fois ; des coups de bâton trois fois ; j’ai été lapidé une fois ; j’ai été un jour et une nuit au fond de la mer. »
Voilà donc ce Paul qui a été vingt-quatre heures au fond de la mer sans être noyé : c’est le tiers de l’aventure de Jonas. Mais n’est-il pas clair qu’il manifeste ici sa basse jalousie contre Pierre et les autres apôtres, et qu’il veut l’emporter sur eux pour avoir été plus repris de justice et plus fouetté qu’eux ?
La fureur de la domination ne paraît-elle pas dans toute son insolence quand il dit aux mêmes Corinthiens : « Je viens à vous pour la troisième fois ; je jugerai tout par deux ou trois témoins ; je ne pardonnerai à aucun de ceux qui ont péché, ni aux autres ? » (IIe épître, chap. XIII.)
À quels imbéciles et quels cœurs abrutis de la vile populace écrivait-il ainsi en maître tyrannique ? à ceux auxquels il osait dire qu’il avait été ravi au troisième ciel. Lâche et impudent imposteur ! où est ce troisième ciel dans lequel tu as voyagé ? est-ce dans Vénus ou dans Mars ? Nous rions de Mahomet quand ses commentateurs prétendent qu’il alla visiter sept cieux tout de suite dans une nuit. Mais Mahomet au moins ne parle pas dans son Alcoran d’une telle extravagance qu’on lui impute ; et Paul ose dire qu’il a fait près de la moitié de ce voyage !
Quel était donc ce Paul qui fait encore tant de bruit, et qui est cité tous les jours à tort et à travers ? Il dit qu’il était citoyen romain ; j’ose affirmer qu’il ment impudemment. Aucun Juif ne fut citoyen romain que sous les Décius et les Philippe. S’il était de Tarsis, Tarsis ne fut colonie romaine, cité romaine, que plus de cent ans après Paul. S’il était de Giscale, comme le dit Jérôme, ce village était en Galilée ; et jamais les Galiléens n’eurent assurément l’honneur d’être citoyens romains.
Il fut élevé aux pieds de Gamaliel, c’est-à-dire qu’il fut domestique de Gamaliel. En effet, on remarque qu’il gardait les manteaux de ceux qui lapidèrent Étienne, ce qui est l’emploi d’un valet, et d’un valet de bourreau. Les Juifs prétendirent qu’il voulait épouser la fille de Gamaliel. On voit quelque trace de cette aventure dans l’ancien livre qui contient l’histoire de Thècle. Il n’est pas étonnant que la fille de Gamaliel n’ait pas voulu d’un petit valet chauve, dont les sourcils se joignaient sur un nez difforme, et qui avait les jambes crochues : c’est ainsi que les Actes de Thècle le dépeignent. Dédaigné par Gamaliel et par sa fille, comme il méritait de l’être, il se joignit à la secte naissante de Céphas, de Jacques, de Matthieu, de Barnabé, pour mettre le trouble chez les Juifs.
Pour peu qu’on ait une étincelle de raison, on jugera que cette cause de l’apostasie de ce malheureux Juif est plus naturelle que celle qu’on lui attribue. Comment se persuadera-t-on qu’une lumière céleste l’ait fait tomber de cheval en plein midi, qu’une voix céleste se soit fait entendre à lui, que Dieu lui ait dit : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Ne rougit-on pas d’une telle sottise ?
Si Dieu avait voulu empêcher que les disciples de Jésus ne fussent persécutés, n’aurait-il point parlé aux princes de la nation plutôt qu’à un valet de Gamaliel ? En ont-ils moins été châtiés depuis que Saul tomba de cheval ? Saul Paul ne fut-il pas châtié lui-même ? à quoi bon ce ridicule miracle ? Je prends le ciel et la terre à témoin (s’il est permis de se servir de ces mots impropres, le ciel et la terre) qu’il n’y a jamais eu de légende plus folle, plus fanatique, plus dégoûtante, plus digne d’horreur et de mépris[2].
Chapitre XIII. Des évangiles.
Dès que les sociétés de demi-juifs demi-chrétiens se furent insensiblement établies dans le bas peuple à Jérusalem, à Antioche, à Éphèse, à Corinthe, dans Alexandrie, quelque temps après Vespasien, chacun de ces petits troupeaux voulut faire son Évangile. On en compta cinquante-quatre, et il y en eut beaucoup davantage. Tous se contredisent, comme on le sait, et cela ne pouvait être autrement, puisque tous étaient forgés dans des lieux différents. Tous conviennent seulement que leur Jésus était fils de Maria ou Mirja, et qu’il fut pendu : et tous lui attribuent d’ailleurs autant de prodiges qu’il y en a dans les Métamorphoses d’Ovide.
Luc lui dresse une généalogie absolument différente de celle que Matthieu lui forge ; et aucun d’eux ne songe à faire la généalogie de Marie, de laquelle seule on le fait naître. L’enthousiaste Pascal s’écrie : « Cela ne s’est pas fait de concert. » Non, sans doute, chacun a écrit des extravagances à sa fantaisie pour sa petite société. De là vient qu’un évangéliste prétend que le petit Jésus fut élevé en Égypte ; un autre dit qu’il fut toujours élevé à Bethléem ; celui-ci le fait aller une seule fois à Jérusalem, celui-là trois fois. L’un fait arriver trois mages que nous nommons les trois rois, conduits par une étoile nouvelle, et fait égorger tous les petits enfants du pays par le premier Hérode, qui était alors près de sa fin[1]. L’autre passe sous silence et l’étoile, et les mages, et le massacre des innocents.
On a été obligé enfin, pour expliquer cette foule de contradictions, de faire une concordance ; et cette concordance est encore moins concordante que ce qu’on a voulu concorder. Presque tous ces Évangiles, que les chrétiens ne communiquaient qu’à leurs petits troupeaux, ont été visiblement forgés après la prise de Jérusalem : on en a une preuve bien sensible dans celui qui est attribué à Matthieu. Ce livre met dans la bouche de Jésus ces paroles aux Juifs : « Vous rendrez compte de tout le sang répandu depuis le juste Abel jusqu’à Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué entre le temple et l’autel, »
Un faussaire se découvre toujours par quelque endroit. Il y eut, pendant le siége de Jérusalem, un Zacharie, fils d’un Barachie, assassiné entre le temple et l’autel par la faction des zélés. Par là l’imposture est facilement découverte ; mais pour la découvrir alors, il eût fallu lire toute la Bible. Les Grecs et les Romains ne la lisaient guère : ces fadaises et les Évangiles leur étaient entièrement inconnus ; on pouvait mentir impunément.
Une preuve évidente que l’Évangile attribué à Matthieu n’a été écrit que très-longtemps après lui, par quelque malheureux demi-juif demi-chrétien helléniste, c’est ce passage fameux : « S’il n’écoute pas l’Église, qu’il soit à vos yeux comme un païen et un publicain. » Il n’y avait point d’Église du temps de Jésus et de Matthieu. Ce mot église est grec. L’assemblée du peuple d’Athènes s’appelait ecclesia. Cette expression ne fut adoptée par les chrétiens que dans la suite des temps, quand il y eut quelque forme de gouvernement. Il est donc clair qu’un faussaire prit le nom de Matthieu pour écrire cet Évangile en très-mauvais grec. J’avoue qu’il serait assez comique que Matthieu, qui avait été publicain, comparât les païens aux publicains. Mais quelque soit l’auteur de cette comparaison ridicule, ce ne peut être qu’un écervelé de la boue du peuple qui regarde un chevalier romain, chargé de recouvrer les impôts établis par le gouvernement, comme un homme abominable. Cette idée seule est destructive de toute administration, et non-seulement indigne d’un homme inspiré de Dieu, mais indigne du laquais d’un honnête citoyen.
Il y a deux Évangiles de l’enfance : le premier nous raconte qu’un jeune gueux donna une tape sur le derrière au petit Jésus son camarade, et que le petit Jésus le fit mourir sur-le-champ, ϰαὶ παραχρῆμα πεσὼν ἀπέθανεν (kai parachrêma pesôn apethanen). Une autre fois il faisait des petits oiseaux de terre glaise, et ils s’envolaient. La manière dont il apprenait son alphabet était encore tout à fait divine. Ces contes ne sont pas plus ridicules que ceux de l’enlèvement de Jésus par le diable, de la transfiguration sur le Thabor, de l’eau changée en vin, des diables envoyés dans un troupeau de cochons. Aussi cet Évangile de l’enfance fut longtemps en vénération.
Le second livre de l’enfance n’est pas moins curieux. Marie, emmenant son fils en Égypte, rencontre des filles désolées de ce que leur frère avait été changé en mulet : Marie et le petit ne manquèrent pas de rendre à ce mulet sa forme d’homme, et l’on ne sait si ce malheureux gagna au marché. Chemin faisant, la famille errante rencontre deux voleurs, l’un nommé Dumachus, et l’autre Titus. Dumachus voulait absolument voler la sainte Vierge, et lui faire pis. Titus prit le parti de Marie, et donna quarante drachmes à Dumachus pour l’engager à laisser passer la famille sans lui faire de mal. Jésus déclara à la sainte Vierge que Dumachus serait le mauvais larron, et Titus le bon larron ; qu’ils seraient un jour pendus avec lui, que Titus irait en paradis, et Dumachus à tous les diables.
L’Évangile selon saint Jacques, frère aîné de Jésus, ou, selon Pierre Barjone, Évangile reconnu et vanté par Tertullien et par Origène, fut encore en plus grande recommandation. On l’appelait protevangelion, premier Évangile. C’est peut-être le premier qui ait parlé de la nouvelle étoile, de l’arrivée des mages, et des petits enfants que le premier Hérode fit égorger.
Il y a encore une espèce d’Évangile, ou d’Actes de Jean, dans lequel on fait danser Jésus avec ses apôtres la veille de sa mort ; et la chose est d’autant plus vraisemblable que les thérapeutes étaient en effet dans l’usage de danser en rond, ce qui doit plaire beaucoup au Père céleste.
Pourquoi le chrétien le plus scrupuleux rit-il aujourd’hui sans remords de tous ces Évangiles, de tous ces Actes, qui ne sont plus dans le canon, et n’ose-t-il rire de ceux qui sont adoptés par l’Église ? Ce sont à peu près les mêmes contes ; mais le fanatique adore sous un nom ce qui lui paraît le comble du ridicule sous un autre.
Enfin on choisit quatre Évangiles ; et la grande raison, au rapport de saint Irénée, c’est qu’il n’y a que quatre vents cardinaux ; c’est que Dieu est assis sur les chérubins, et que les chérubins ont quatre formes. Saint Jérôme ou Hiéronyme, dans sa préface sur l’Évangile de Marc, ajoute aux quatre vents et aux quatre animaux les quatre anneaux qui servaient aux bâtons sur lesquels on portait le coffre appelé l’arche.
Théophile d’Antioche prouve que le Lazare ayant été mort pendant quatre jours, on ne pouvait conséquemment admettre que quatre Évangiles. Saint Cyprien prouve la même chose par les quatre fleuves qui arrosaient le paradis terrestre. Il faudrait être bien impie pour ne pas se rendre à de telles raisons.
Mais avant qu’on eût donné quelque préférence à ces quatre Évangiles, les Pères des deux premiers siècles ne citaient presque jamais que les Évangiles nommés aujourd’hui apocryphes. C’est une preuve incontestable que nos quatre Évangiles ne sont pas de ceux à qui on les attribue.
Je veux qu’ils en soient ; je veux, par exemple, que Luc ait écrit celui qui est sous son nom. Je dirais à Luc : Comment oses-tu avancer que Jésus naquit sous le gouvernement de Cyrinus ou Quirinus, tandis qu’il est avéré que Quirinus ne fut gouverneur de Syrie que plus de dix ans après ? Comment as-tu le front de dire qu’Auguste avait ordonné le dénombrement de toute la terre, et que Marie alla à Bethléem pour se faire dénombrer ? Le dénombrement de toute la terre ! Quelle expression ! Tu as ouï dire qu’Auguste avait un livre de raison qui contenait le détail des forces de l’empire et de ses .finances ; mais un dénombrement de tous les sujets de l’empire ! c’est à. quoi il ne pensa jamais ; encore moins un dénombrement de la terre entière ; aucun écrivain romain, ou grec, ou barbare, n’a jamais dit cette extravagance. Te voilà donc convaincu par toi-même du plus énorme mensonge ; et il faudra qu’on adore ton livre !
Mais qui a fabriqué ces quatre Évangiles ? n’est-il pas très-probable que ce sont des chrétiens hellénistes, puisque l’Ancien Testament n’y est presque jamais cité que suivant la version des Septante, version inconnue en Judée ? Les apôtres ne savaient pas plus le grec que Jésus ne l’avait su. Comment auraient-ils cité les Septante ? Il n’y a que le miracle de la Pentecôte qui ait pu enseigner le grec à des Juifs ignorants.
Quelle foule de contrariétés et d’impostures est restée dans ces quatre Évangiles ! N’y en eût-il qu’une seule, elle suffirait pour démontrer que c’est un ouvrage de ténèbres. N’y eût-il que le conte qu’on trouve dans Luc, que Jésus naquit sous le gouvernement de Cyrinus, lorsque Auguste fit faire le dénombrement de tout l’empire, cette seule fausseté ne suffirait-elle pas pour faire jeter le livre avec mépris ? 1° Il n’y eut jamais de tel dénombrement, et aucun auteur n’en parle. 2° Cyrinus ne fut gouverneur de Syrie que dix ans après l’époque de la naissance de ce Jésus. Autant de mots, autant d’erreurs dans les Évangiles. Et c’est ainsi qu’on réussit avec le peuple.
Chapitre XIV. Comment les premiers chretiens se conduisirent avec les romains, et comment ils forgèrent des vers attribués aux Sibylles, etc.
Des gens de bon sens demandent comment ce tissu de fables qui outragent si platement la raison, et de blasphèmes qui imputent tant d’horreurs à la Divinité, put trouver quelque créance. Ils devraient en effet être bien étonnés si les premiers sectaires chrétiens avaient persuadé la cour des empereurs et le sénat de Rome ; mais une canaille abjecte s’adressait à une populace non moins méprisable. Cela est si vrai que l’empereur Julien dit dans son discours aux christicoles : « C’était d’abord assez pour vous de séduire quelques servantes, quelques gueux comme Corneille et Serge. Qu’on me regarde comme le plus effronté des imposteurs si, parmi ceux qui embrassèrent votre secte sous Tibère et sous Claude, il y a eu un seul homme de naissance ou de mérite[1]. »
Les premiers raisonneurs chrétiens disaient donc dans les carrefours et dans les auberges, aux païens qui se mêlaient de raisonner : Ne soyez point effarouchés de nos mystères ; vous recourez aux expiations pour vous purger de vos crimes : nous avons une expiation bien plus salutaire. Vos oracles ne valent pas les nôtres ; et pour vous convaincre que notre secte est la seule bonne, c’est que vos propres oracles ont prédit tout ce que nous vous enseignons, et tout ce qu’a fait notre Seigneur Jésus-Christ. N’avez-vous pas entendu parler des sibylles ? — Oui, répondent les disputeurs païens aux disputeurs galiléens ; toutes les sibylles ont été inspirées par Jupiter même ; leurs prédictions sont toutes véritables. — Eh bien, repartent les galiléens, nous vous montrerons des vers de sibylles qui annoncent clairement Jésus-Christ, et alors il faudra bien vous rendre.
Aussitôt les voilà qui se mettent à forger les plus mauvais vers grecs qu’on ait jamais composés, des vers semblables à ceux de notre Grub-street, de Blackmore, et de Gibson. Ils les attribuent aux sibylles, et pendant plus de quatre cents ans ils ne cessent de fonder le christianisme sur cette preuve, qui était également à la portée des trompeurs et des trompés. Ce premier pas étant fait, on vit ces faussaires puérils mettre sur le compte des sibylles jusqu’à des vers acrostiches qui commençaient tous par les lettres qui composent le nom de Jésus-Christ.
Lactance nous a conservé une grande partie de ces rapsodies, comme des pièces authentiques. À ces fables ils ajoutaient des miracles, qu’ils faisaient même quelquefois en public. Il est vrai qu’ils ne ressuscitaient point de morts comme Élisée ; ils n’arrêtaient pas le soleil comme Josué ; ils ne passaient point la mer à pied sec comme Moïse ; ils ne se faisaient pas transporter par le diable comme Jésus sur le haut d’une petite montagne de Galilée, d’où l’on découvrait toute la terre ; mais ils guérissaient la fièvre quand elle était sur son déclin, et même la gale, lorsque le galeux avait été baigné, saigné, purgé, frotté. Ils chassaient surtout les démons : c’était le principal objet de la mission des apôtres. Il est dit, dans plus d’un Évangile, que Jésus les envoya exprès pour les chasser.
C’était une ancienne prérogative du peuple de Dieu. Il y avait, comme on sait, des exorcistes à Jérusalem qui guérissaient les possédés en leur mettant sous le nez un peu de la racine nommée barath, et en marmottant quelques paroles tirées de la Clavicule de Salomon. Jésus lui-même avoue que les Juifs avaient ce pouvoir. Rien n’était plus aisé au diable que d’entrer dans le corps d’un gueux, moyennant un ou deux schellings. Un Juif ou un Galiléen un peu à son aise pouvait chasser dix diables par jour pour une guinée. Les diables n’osaient jamais s’emparer d’un gouverneur de province, d’un sénateur, pas même d’un centurion : il n’y eut jamais que ceux qui ne possédaient rien du tout qui fussent possédés.
Si le diable dut se saisir de quelqu’un, c’était de Pilate ; cependant il n’osa jamais en approcher. On a longtemps exorcisé la canaille en Angleterre, et encore plus ailleurs ; mais quoique la secte chrétienne soit précisément établie pour cet usage, il est aboli presque partout, excepté dans les États de l’obédience du pape, et dans quelques pays grossiers d’Allemagne, malheureusement soumis à des évêques et à des moines.
Ce qu’ont enfin pu faire de mieux tous les gouvernements a été d’abolir tous les premiers usages du christianisme : baptême des filles adultes toutes nues, dans des cuves, par des hommes ; baptême abominable des morts ; exorcisme, possessions du diable, inspirations ; agapes qui produisaient tant d’impuretés : tout cela est détruit, et cependant la secte demeure.
Les chrétiens s’accréditèrent ainsi dans le petit peuple pendant tout un siècle. On les laissa faire ; on les regarda comme une secte de Juifs, et les Juifs étaient tolérés. On ne persécutait ni pharisiens, ni saducéens, ni thérapeutes, ni esséniens, ni judaïtes ; à plus forte raison laissait-on ramper dans l’obscurité ces chrétiens qu’on ignorait. Ils étaient si peu de chose que ni Flavius Josèphe, ni Philon, ni Plutarque, ne daignent en parler ; et si Tacite en veut bien dire un mot, c’est en les confondant avec les Juifs et en leur marquant le plus profond mépris. Ils eurent donc la plus grande facilité d’étendre leur secte. On les rechercha un peu sous Domitien ; quelques-uns furent punis sous Trajan, et ce fut alors qu’ils commencèrent à mêler mille faux actes de martyres à quelques-uns qui n’étaient que trop véritables.
Chapitre XV. Comment les chrétiens se conduisirent avec les juifs. leur explication ridicule des prophètes.
Les chrétiens ne purent jamais prévaloir auprès des Juifs comme auprès de la populace des Gentils. Tandis qu’ils continuèrent à vivre selon la loi mosaïque, comme avait fait Jésus toute sa vie, à s’abstenir des viandes prétendues impures, et qu’ils ne proscrivirent point la circoncision, ils ne furent regardés que comme une société particulière de Juifs, telle que celle des saducéens, des esséniens, des thérapeutes. Ils disaient qu’on avait eu tort de pendre Jésus, que c’était un saint homme envoyé de Dieu, et qu’il était ressuscité.
Ces discours, à la vérité, étaient punis dans Jérusalem : il en coûta même la vie à Étienne, à ce qu’ils disent ; mais ailleurs cette scission ne produisit que des altercations entre les Juifs rigides et les demi-chrétiens. On disputait ; les chrétiens crurent trouver dans les Écritures quelques passages qu’on pouvait tordre en faveur de leur cause. Ils prétendirent que les prophètes juifs avaient prédit Jésus-Christ ; ils citaient Isaïe, qui disait au roi Achaz :
« Une fille, ou une jeune femme (alma)[1] sera grosse, et accouchera d’un fils qui s’appellera Emmanuel ; il mangera du beurre et du miel, afin qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. La terre que vous détestez sera délivrée de ses deux rois, et le Seigneur sifflera aux mouches qui sont à l’extrémité des fleuves d’Égypte, et aux abeilles du pays d’Assur. Et il prendra un rasoir de louage, et il rasera la tête, le poil du pénil, et la barbe du roi d’Assur. »
« Et le Seigneur me dit : Prenez un grand livre, et écrivez en lettres lisibles : Maher-salal-has-bas, prenez vite les dépouilles. Et j’allai coucher avec la prophétesse, et elle fut grosse, et elle mit au monde un fils, et le Seigneur me dit : Appelez-le Maher-salal-has-bas, prenez vite les dépouilles. »
Vous voyez bien, disaient les chrétiens, que tout cela signifie évidemment l’avènement de Jésus-Christ. La fille qui fait un enfant, c’est la vierge Marie ; Emmanuel et prenez vite les dépouilles, c’est notre Seigneur Jésus. Pour le rasoir de louage avec lequel on rase le poil du pénil du roi d’Assur, c’est une autre affaire. Toutes ces explications ressemblent parfaitement à celle de milord Pierre dans le Conte du Tonneau de notre cher doyen Swift.
Les Juifs répondaient : Nous ne voyons pas si clairement que vous que prenez vite les dépouilles et Emmanuel signifient Jésus, que la jeune femme d’Isaïe soit une vierge, et qu’alma, qui exprime également fille ou jeune femme, signifie Maria ; et ils riaient au nez des chrétiens.
Quand les chrétiens disaient : Jésus est prédit par le patriarche Juda, car le patriarche Juda devait lier son ânon à la vigne, et laver son manteau dans le sang de la vigne ; et Jésus est entré dans Jérusalem sur un âne, donc Juda est la figure de Jésus : alors les Juifs riaient encore plus fort de Jésus et de son âne.
S’ils prétendaient que Jésus était le Silo qui devait venir quand le sceptre ne serait plus dans Juda, les Juifs les confondaient en disant que, depuis la captivité en Babylone, le sceptre ou la verge d’entre les jambes n’avait jamais été dans Juda, et que, du temps même de Saül, la verge n’était pas dans Juda. Ainsi les chrétiens, loin de convertir les Juifs, en furent méprisés, détestés, et le sont encore. Ils furent regardés comme des bâtards qui voulaient dépouiller le fils de la maison, en prétextant de faux titres. Ils renoncèrent donc à l’espérance d’attirer les Juifs à eux, et s’adressèrent uniquement aux Gentils.
Chapitre XVI. Des fausses citations et des fausses prédictions dans les évangiles.
Pour encourager les premiers catéchumènes, il était bon de citer d’anciennes prophéties et d’en faire de nouvelles. On cita donc dans les Évangiles les anciennes prophéties à tort et à travers. Matthieu, ou celui qui prit son nom, dit : « Joseph habita dans une ville qui s’appelle Nazareth, pour accomplir ce qui a été prédit par les prophètes : Il s’appellera Nazaréen. » Aucun prophète n’avait dit ces paroles ; Matthieu parlait donc au hasard. Luc ose dire, au chapitre XXI : « Il y aura des signes dans la lune et dans les étoiles ; des bruits de la mer et des flots ; les hommes séchant de crainte attendront ce qui doit arriver à l’univers entier. Les vertus des cieux seront ébranlées, et alors ils verront le Fils de l’homme venant dans une nuée avec grande puissance et grande majesté. En vérité, je vous dis que la génération présente ne passera point que tout cela ne s’accomplisse. »
La génération passa, et si rien de tout cela n’arriva, ce n’est pas ma faute. Paul en dit à peu près autant dans son épitre à ceux de Thessalonique : « Nous qui vivons et qui vous parlons, nous serons emportés dans les nuées pour aller au-devant du Seigneur au milieu de l’air. »
Que chacun s’interroge ici ; qu’il voie si l’on peut pousser plus loin l’imposture et la bêtise du fanatisme. Quand on vit qu’on avait mis en avant des mensonges si grossiers, les Pères de l’Église ne manquèrent pas de dire que Luc et Paul avaient entendu, par ces prédictions, la ruine de Jérusalem. Mais quel rapport, je vous prie, de la prise de Jérusalem avec Jésus venant dans les nuées avec grande puissance et grande majesté[1] ?
Il y a dans l’Évangile attribué à Jean un passage qui fait bien voir que ce livre ne fut pas composé par un Juif. Jésus dit : « Je vous fais un commandement nouveau, c’est que vous vous aimiez mutuellement. » Ce commandement, loin d’être nouveau, se trouve expressément, et d’une manière bien plus forte, dans le Lévitique : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Enfin, quiconque se donnera la peine de lire avec attention ne trouvera, dans tous les passages où l’on allègue l’Ancien Testament, qu’un manifeste abus de paroles, et le sceau du mensonge presque à chaque page.
Chapitre XVII. De la fin du monde, et de la Jérusalem nouvelle.
Non-seulement on a introduit Jésus sur la scène prédisant la fin du monde pour le temps même où il vivait ; mais ce fanatisme fut celui de tous ceux qu’on nomme apôtres et disciples. Pierre Barjone, dans la première épître qu’on lui attribue, dit que « l’Évangile a été prêché aux morts, et que la fin du monde approche ».
Dans la seconde épître : « Nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre. »
La première épître attribuée à Jean dit formellement : « Il y a dès à présent plusieurs antechrists : ce qui nous fait connaître que voici la dernière heure. »
L’épître qu’on met sur le compte de ce Thadée surnommé Jude annonce la même folie : « Voilà le Seigneur qui va venir avec des millions de saints pour juger les hommes. »
Cette ridicule idée subsista de siècle en siècle. Si le monde ne finit pas sous Constantin, il devait finir sous Théodose ; si la fin n’arrivait pas sous Théodose, elle devait arriver sous Attila. Et jusqu’au xiie siècle cette opinion enrichit tous les couvents ; car, pour raisonner conséquemment selon les moines, dès qu’il n’y aura plus ni hommes ni terres, il faut bien que toutes les terres appartiennent à ces moines.
Enfin, c’est sur cette démence qu’on fonda cette autre démence d’une nouvelle ville de Jérusalem qui devait descendre du ciel. L’Apocalypse annonça cette prochaine aventure : tous les christicoles la crurent. On fit de nouveaux vers sibyllins dans lesquels cette Jérusalem était prédite ; elle parut même cette ville nouvelle où les christicoles devaient loger pendant mille ans après l’embrasement du monde. Elle descendit du ciel pendant quarante nuits consécutives. Tertullien la vit de ses yeux. Un temps viendra où tous les honnêtes gens diront : Est-il possible qu’on ait perdu son temps à réfuter ce conte du Tonneau !
Voilà donc pour quelles opinions la moitié de la terre a été ravagée ! voilà ce qui a valu des principautés, des royaumes, à des prêtres imposteurs, et ce qui précipite encore tous les jours des imbéciles dans les cachots des cloîtres chez les papistes ! C’est avec ces toiles d’araignée qu’on a tissu les liens qui nous serrent ; on a trouvé le secret de les changer en chaînes de fer. Grand Dieu ! c’est pour ces sottises que l’Europe a nagé dans le sang, et que notre roi Charles Ier est mort sur un échafaud ! Ô destinée ! quand des demi-juifs écrivaient leurs plates impertinences dans leurs greniers, prévoyaient-ils qu’ils préparaient un trône pour l’abominable Alexandre VI, et pour ce brave scélérat de Cromwell ?
Chapitre XVIII. Des allégories.
Ceux qu’on appelle Pères de l’Église s’avisèrent d’un tour assez singulier pour confirmer leurs catéchumènes dans leur nouvelle créance. Il se trouva avec le temps des disciples qui raisonnèrent un peu : on prit le parti de leur dire que tout l’Ancien Testament n’est qu’une figure du Nouveau. Le petit morceau de drap rouge que mettait la paillarde Rahab à sa fenêtre pour avertir les espions de Josué signifie le sang de Jésus répandu pour nos péchés. Sara et sa servante Agar, Lia la chassieuse, et la belle Rachel, sont la synagogue et l’Église. Moïse levant les mains quand il donne la bataille aux Amalécites, c’est évidemment la croix, car on a la figure d’une croix quand on étend les bras à droite et à gauche. Joseph vendu par ses frères, c’est Jésus-Christ ; la manne, c’est l’eucharistie ; les quatre vents sont les quatre Évangiles ; les baisers que donne la Sulamite sur la bouche, etc., dans le Cantique des cantiques, sont visiblement le mariage de Jésus-Christ avec son Église. La mariée n’avait pas encore de dot, elle n’était pas encore bien établie.
On ne savait ce qu’on devait croire ; aucun dogme précis n’était encore constaté. Jésus n’avait jamais rien écrit. C’était un étrange législateur qu’un homme de la main duquel on n’avait pas une ligne. Il fallut donc écrire pour lui ; on s’abandonna donc à ces bonnes nouvelles, à ces Évangiles, à ces actes dont nous avons déjà parlé, et on tourna tout l’Ancien Testament en allégories du Nouveau. Il n’est pas étonnant que des catéchumènes fascinés par ceux qui voulaient former un parti se laissassent séduire par ces images qui plaisent toujours au peuple. Cette méthode contribua plus que toute autre chose à la propagation du christianisme, qui s’étendait secrètement d’un bout de l’empire à l’autre, sans qu’alors les magistrats daignassent presque y prendre garde.
Plaisante et folle imagination, de faire de toute l’histoire d’une troupe de gueux la figure et la prophétie de tout ce qui devait arriver au monde entier dans la suite des siècles !
Chapitre XIX. Des falsifications, et des livres supposés.
Pour mieux séduire les catéchumènes des premiers siècles, on ne manqua point de supposer que la secte avait été respectée par les Romains et par les empereurs eux-mêmes. Ce n’était pas assez de forger mille écrits qu’on attribuait à Jésus, on fit encore écrire Pilate. Justin, Tertullien, citent ces actes ; on les inséra dans l’Évangile de Nicodème. Voici quelques passages de la première lettre de Pilate à Tibère ; ils sont curieux.
« Il est arrivé depuis peu, et je l’ai vérifié, que les Juifs par leur envie se sont attiré une cruelle condamnation : leur Dieu leur ayant promis de leur envoyer son saint du haut du ciel, qui serait leur roi à bien juste titre, et ayant promis qu’il serait fils d’une vierge, le dieu des Hébreux l’a envoyé en effet, moi étant président en Judée. Les principaux des Juifs me l’ont dénoncé comme un magicien ; je l’ai cru ; je l’ai bien fait fouetter ; je le leur ai abandonné : ils l’ont crucifié ; ils ont mis des gardes auprès de sa fosse ; il est ressuscité le troisième jour. »
Cette lettre très-ancienne est fort importante, en ce qu’elle fait voir qu’en ces premiers temps les chrétiens n’osaient encore imaginer que Jésus fût Dieu ; ils l’appelaient seulement envoyé de Dieu. S’il avait été Dieu alors, Pilate, qu’ils font parler, n’eût pas manqué de le dire.
Dans la seconde lettre, il dit que, s’il n’avait pas craint une sédition, peut-être ce noble Juif vivrait encore ; fortasse vir ille nobilis viveret. On forgea encore une relation de Pilate plus circonstanciée.
Eusèbe de Césarée, au livre VII de son Histoire ecclésiastique, assure que l’hémorroïsse guérie par Jésus-Christ était citoyenne de Césarée : il a vu sa statue aux pieds de celle de Jésus-Christ. Il y a autour de la base des herbes qui guérissent toutes sortes de maladies. On a conservé une requête de cette hémorroïsse, dont le nom était, comme on sait, Véronique ; elle y rend compte à Hérode du miracle que Jésus-Christ a opéré sur elle. Elle demande à Hérode la permission d’ériger une statue à Jésus ; mais ce n’est pas dans Césarée, c’est dans la ville de Paniade, et cela est triste pour Eusèbe.
On fit courir un prétendu édit de Tibère pour mettre Jésus au rang des dieux. On supposa des lettres de Paul à Sénèque, et de Sénèque à Paul. Empereurs, philosophes, apôtres, tout fut mis à contribution ; c’est une suite non interrompue de fraudes : les unes sont seulement fanatiques, les autres sont politiques. Un mensonge fanatique, par exemple, est d’avoir écrit, sous le nom de Jean, l’Apocalypse, qui n’est qu’absurde ; un mensonge politique est le livre des constitutions attribué aux apôtres. On veut, au chapitre XXV du livre II, que les évêques recueillent les décimes et les prémices. On y appelle les évêques rois au chapitre XXVI : Qui episcopus est, hic vester rex et dynastes.
Il faut, chap. XXVIII, quand on fait le repas des agapes[1], envoyer les meilleurs plats à l’évêque, s’il n’est pas à table. Il faut donner double portion au prêtre et au diacre. Les portions des évêques ont bien augmenté, et surtout celle de l’évêque de Rome.
Au chap. XXXIV, on met les évêques bien au-dessus des empereurs et des rois, précepte dont l’Église s’est écartée le moins qu’elle a pu : Quanto animus præstat corpore, tantum sacerdotium regno. C’est là l’origine cachée de cette terrible puissance que les évêques de Rome ont usurpée pendant tant de siècles. Tous ces livres supposés, tous ces mensonges qu’on a osé nommer pieux, n’étaient qu’entre les mains des fidèles. C’était un péché énorme de les communiquer aux Romains, qui n’en eurent presque aucune connaissance pendant deux cents ans ; ainsi le troupeau grossissait tous les jours.
Chapitre XX. Des principales impostures des premiers chrétiens.
Une des plus anciennes impostures de ces novateurs énergumènes fut le Testament des douze patriarches, que nous avons encore tout entier en grec de la traduction de Jean surnommé saint Chrysostome. Cet ancien livre, qui est du premier siècle de notre ère, est visiblement d’un chrétien, puisqu’on y fait dire à Lévi, à l’article 8 de son Testament : « Le troisième aura un nom nouveau, parce qu’il sera un roi de Juda, et qu’il sera peut-être d’un nouveau sacerdoce pour toutes les nations, etc. ; » ce qui désigne leur Jésus-Christ, qui n’a jamais pu être désigné que par de telles impostures. On fait encore prédire clairement ce Jésus dans tout l’article 18, après avoir fait dire à Lévi, dans l’article 17, que les prêtres des Juifs font le péché de la chair avec des bêtes.
On supposa le testament de Moïse, d’Énoch, et de Joseph, leur ascension ou assomption dans le ciel, celle de Moïse, d’Abraham, d’Elda, de Moda, d’Élie, de Sophonie, de Zacharie, d’Habacuc.
On forgea, dans le même temps, le fameux livre d’Énoch, qui est le seul fondement de tout le mystère du christianisme, puisque c’est dans ce seul livre qu’on trouve l’histoire des anges révoltés qui ont péché en paradis, et qui sont devenus diables en enfer. Il est démontré que les écrits attribués aux apôtres ne furent composés qu’après cette fable d’Énoch, écrite en grec par quelque chrétien d’Alexandrie : Jude, dans son épître, cite cet Énoch plus d’une fois ; il rapporte ses propres paroles ; il est assez dépourvu de sens pour assurer qu’Énoch, septième homme après Adam, a écrit des prophéties.
Voilà donc ici deux impostures grossières avérées : celle du chrétien qui suppose des livres d’Énoch, et celle du chrétien qui suppose l’épître de Jude, dans laquelle les paroles d’Énoch sont rapportées ; il n’y eut jamais un mensonge plus grossier.
Il est très-inutile de rechercher quel fut le principal auteur de ces mensonges accrédités insensiblement ; mais il y a quelque apparence que ce fut un nommé Hégésippe, dont les fables eurent beaucoup de cours, et qui est cité par Tertullien, et ensuite copié par Eusèbe. C’est cet Hégésippe qui rapporte que Jude était de la race de David, que ses petits-fils vivaient sous l’empereur Domitien. Cet empereur, si on le croit, fut très-effrayé d’apprendre qu’il y avait des descendants de ce grand roi David, lesquels avaient un droit incontestable au trône de Jérusalem, et par conséquent au trône de l’univers entier. Il fit venir devant lui ces illustres princes ; mais, ayant vu ce qu’ils étaient, des gueux de l’ostière, il les renvoya sans leur faire de mal.
Pour Jude, leur grand-père, qu’on met au rang des apôtres, on l’appelle tantôt Thadée, et tantôt Lebbée, comme nos coupeurs de bourse, qui ont toujours deux ou trois noms de guerre.
La prétendue lettre de Jésus-Christ à un prétendu roitelet de la ville d’Édesse, qui n’avait point alors de roitelet, le voyage de ce même Thadée auprès de ce roitelet, furent quatre cents ans en vogue chez les premiers chrétiens.
Quiconque écrivait un Évangile, ou quiconque se mêlait d’enseigner son petit troupeau naissant imputait à Jésus des discours et des actions dont nos quatre Évangiles ne parlent pas. C’est ainsi que dans les Actes des apôtres, au chapitre XX (verset 35), Paul cite ces paroles de Jésus : « Μαϰάριον ἔστι διδόναι μᾶλλον ἢ λαμϐάνειν (Makarion esti didonai mallon ê lambanein) ; il vaut mieux donner que de recevoir. » Ces paroles ne se trouvent ni dans Matthieu, ni dans Marc, ni dans Luc, ni dans Jean.
Les Voyages de Pierre, l’Apocalypse de Pierre, les Actes de Pierre, les Actes de Paul, de Thècle, les Lettres de Paul à Sénèque et de Sénèque à Paul, les Actes de Pilate, les Lettres de Pilate, sont assez connus des savants ; et ce n’est pas la peine de fouiller dans ces archives du mensonge et de l’ineptie.
On a poussé le ridicule jusqu’à écrire l’histoire de Claudia Procula, femme de Pilate.
Un malheureux nommé Abdias, qui passa incontestablement pour avoir vécu avec Jésus-Christ, et pour avoir été un des plus fameux disciples des apôtres, est celui qui nous a fourni l’histoire du combat de Pierre avec Simon, le prétendu magicien, si célèbre chez les premiers chrétiens. C’est sur cette seule imposture que s’est établie la croyance que Pierre est venu à Rome ; c’est à cette fable que les papes doivent toute leur grandeur, si honteuse pour le genre humain ; et cela seul rendrait cette grandeur précaire bien ridicule, si une foule de crimes ne l’avait rendue odieuse.
Voici donc ce que raconte cet Abdias, qui se prétend témoin oculaire. Simon Pierre Barjone étant venu à Rome sous Néron, Simon le Magicien y vint aussi. Un jeune homme, proche parent de Néron, mourut ; il fallait bien ressusciter un parent de l’empereur ; les deux Simons s’offrirent pour cette affaire. Simon le Magicien y mit la condition qu’on ferait mourir celui des deux qui ne pourrait pas réussir. Simon Pierre l’accepta, et l’autre Simon commença ses opérations ; le mort branla la tête : tout le peuple jeta des cris de joie. Simon Pierre demanda qu’on fît silence, et dit : « Messieurs, si le défunt est en vie, qu’il ait la bonté de se lever, de marcher, et de causer avec nous ; » le mort s’en donna bien de garde ; alors Pierre lui dit de loin : « Mon fils, levez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ vous guérit. » Le jeune homme se leva, parla, et marcha ; et Simon Barjone le rendit à sa mère. Simon, son adversaire, alla se plaindre à Néron, et lui dit que Pierre n’était qu’un misérable charlatan et un ignorant. Pierre comparut devant l’empereur, et lui dit à l’oreille : « Croyez-moi, j’en sais plus que lui, et, pour vous le prouver, faites-moi donner secrètement deux pains d’orge ; vous verrez que je devinerai ses pensées, et qu’il ne devinera pas les miennes. » On apporte à Pierre ces deux pains, il les cache dans sa manche. Aussitôt Simon fit paraître deux gros chiens, qui étaient ses anges tutélaires : ils voulurent dévorer Pierre, mais le madré leur jeta ses deux pains ; les chiens les mangèrent, et ne firent nul mal à l’apôtre. « Eh bien, dit Pierre, vous voyez que je connaissais ses pensées, et qu’il ne connaissait pas les miennes. »
Le magicien demanda sa revanche ; il promit qu’il volerait dans les airs comme Dédale ; on lui assigna un jour : il vola en effet ; mais saint Pierre pria Dieu avec tant de larmes que Simon tomba et se cassa le cou. Néron, indigné d’avoir perdu un si bon machiniste par les prières de Simon Pierre, ne manqua pas de faire crucifier ce Juif la tête en bas.
Qui croirait que cette histoire est contée non-seulement par Abdias, mais par deux autres chrétiens contemporains, Hégésippe, dont nous avons déjà parlé, et Marcel ? Mais ce Marcel ajoute de belles particularités de sa façon. Il ressemble aux écrivains d’évangile, qui se contredisent les uns les autres. Ce Marcel met Paul de la partie ; il ajoute seulement que Simon le Magicien, pour convaincre l’empereur de son savoir-faire, dit à ce prince : « Faites-moi le plaisir de me couper la tête, je vous promets de ressusciter le troisième jour. » L’empereur essaya la chose ; on coupa la tête au magicien, qui reparut le troisième jour devant Néron avec la plus belle tête du monde sur ses épaules.
Que le lecteur maintenant fasse une réflexion avec moi : je suppose que les trois imbéciles Abdias, Hégésippe, et Marcel, qui racontent ces pauvretés, eussent été moins maladroits, qu’ils eussent inventé des contes plus vraisemblables sur les deux Simons, ne seraient-ils pas regardés aujourd’hui comme des Pères de l’Église irréfragables ? Tous nos docteurs ne les citeraient-ils pas tous les jours comme d’irréprochables témoins ? Ne prouverait-on pas à Oxford et en Sorbonne la vérité de leurs écrits par leur conformité avec les Actes des apôtres, et la vérité des Actes des apôtres par ces mêmes écrits d’Abdias, d’Hégésippe, et de Marcel ? Leurs histoires sont assurément aussi authentiques que les Actes des apôtres et les Évangiles ; elles sont parvenues jusqu’à nous de siècle en siècle par la même voie, et il n’y a pas plus de raison de rejeter les unes que les autres.
Je passe sous silence le reste de cette histoire, les beaux faits d’André, de Jacques le Majeur, de Jean, de Jacques le Mineur, de Matthieu, et de Thomas. Lira qui voudra ces inepties. Le même fanatisme, la même imbécillité, les ont toutes dictées ; mais un ridicule trop long est trop insipide[1].
Chapitre XXI. Des dogmes et de la métaphysique des chrétiens des premiers siècles. — De Justin.
Justin, qui vivait sous les Antonins, est un des premiers qui aient eu quelque teinture de ce qu’on appelait philosophie : il fut aussi un des premiers qui donnèrent du crédit aux oracles des sibylles, à la Jérusalem nouvelle, et au séjour que Jésus-Christ devait faire sur la terre pendant mille ans. Il prétendit que toute la science des Grecs venait des Juifs. Il certifie, dans sa seconde apologie pour les chrétiens, que les dieux n’étaient que des diables qui venaient, en forme d’incubes et de succubes, coucher avec les hommes et avec les femmes, et que Socrate ne fut condamné à la ciguë que pour avoir prêché aux Athéniens cette vérité.
On ne voit pas que personne avant lui ait parlé du mystère de la Trinité, comme on en parle aujourd’hui. Si l’on n’a pas falsifié son ouvrage, il dit nettement, dans son exposition de la foi, « qu’au commencement il n’y eut qu’un Dieu en trois personnes, qui sont le Père, le Fils, et le Saint-Esprit ; que le Père n’est pas engendré, et que le Saint-Esprit procède[1] ». Mais, pour expliquer cette Trinité d’une manière différente de Platon, il compare la Trinité à Adam. Adam, dit-il, ne fut point engendré ; Adam s’identifie avec ses descendants : ainsi le Père s’identifie avec le Fils et le Saint-Esprit. Ensuite ce Justin écrivit contre Aristote ; et on peut assurer que si Aristote ne s’entendait pas, Justin ne l’entendait pas davantage.
Il assure, dans l’article XLIII de ses réponses aux orthodoxes, que les hommes et les femmes ressusciteront avec les parties de la génération, attendu que ces parties les feront continuellement souvenir que sans elles ils n’auraient jamais connu Jésus-Christ, puisqu’ils ne seraient pas nés. Tous les Pères, sans exception, ont raisonné à peu près comme Justin ; et pour mener le vulgaire il ne faut pas de meilleurs raisonnements. Locke et Newton n’auraient point fait de religion.
Au reste ce Justin, et tous les Pères qui le suivirent, croyaient, comme Platon, à la préexistence des âmes ; et en admettant que l’âme est spirituelle, une espèce de vent, de souffle, d’air invisible, ils la faisaient en effet un composé de matière subtile. « L’âme est manifestement composée, dit Tatien dans son Discours aux Grecs ; car comment pourrait-elle se faire connaître sans corps ? » Arnobe parle encore bien plus positivement de la corporalité des âmes. « Qui ne voit, dit-il, que ce qui est immortel et simple ne peut souffrir aucune douleur ? L’âme n’est autre chose que le ferment de la vie, l’électuaire d’une chose dissoluble ; fermentum vitæ, rei dissociabilis glutinum. »
Chapitre XXII. De Tertullien.
L’Africain Tertullien parut après Justin. Le métaphysicien Malebranche, homme célèbre dans son pays, lui donne sans détour l’épithète de fou, et les écrits de cet Africain justifient Malebranche. Le seul ouvrage de Tertullien qu’on lise aujourd’hui est son Apologie pour la religion chrétienne. Abbadie, Houteville[1], la regardent comme un chef-d’œuvre, sans qu’ils en citent aucun passage. Ce chef-d’œuvre consiste à injurier les Romains au lieu de les adoucir ; à leur imputer des crimes, et à produire avec pétulance des assertions dont il n’apporte pas la plus légère preuve.
Il reproche aux Romains (chapitre IX) que les peuples de Carthage immolaient encore quelquefois en secret des enfants à Saturne, malgré les défenses expresses des empereurs sous peine de la vie[2]. C’était une occasion de louer la sagesse romaine, et non pas de l’insulter. Il leur reproche les combats des gladiateurs qu’on faisait combattre contre des animaux farouches, en avouant qu’on n’exposait ainsi que des criminels condamnés à la mort. C’était un moyen qu’on leur donnait de sauver leur vie par leur courage. Il fallait encore en louer les Romains : c’était les combats des gladiateurs volontaires qu’il eût dû condamner, et c’est de quoi il ne parle pas.
Il s’emporte (chapitre XXIII) jusqu’à dire : « Amenez-moi votre vierge céleste qui promet des pluies, et votre Esculape qui conserve la vie à ceux qui la doivent perdre quelque temps après : s’ils ne confessent pas qu’ils sont des diables (n’osant mentir devant un chrétien), versez le sang de ce chrétien téméraire ; qu’y a-t-il de plus manifeste ? qu’y a-t-il de plus prouvé ? »
À cela tout lecteur sage répond : Qu’y a-t-il de plus extravagant et de plus fanatique que ce discours ? Comment des statues auraient-elles avoué au premier chrétien venu qu’elles étaient des diables ? En quel temps, en quel lieu, a-t-on vu un pareil prodige ? Il fallait que Tertullien fût bien sûr que les Romains ne liraient pas sa ridicule apologie, et qu’on ne lui donnerait pas des statues d’Esculape à exorciser, pour qu’il osât avancer de telles absurdités.
Son chapitre XXXIIe qu’on n’a jamais remarqué, est très-remarquable. « Nous prions Dieu, dit-il, pour les empereurs et pour l’empire ; mais c’est que nous savons que la dissolution générale qui menace l’univers et la consommation des siècles en sera retardée. »
Misérable ! tu n’aurais donc pas prié pour tes maîtres, si tu avais su que le monde dût subsister encore.
Que Tertullien veut-il dire dans son latin barbare ? Entend-il le règne de mille ans ? entend-il la fin du monde annoncée par Luc et par Paul, et qui n’était point arrivée ? entend-il qu’un chrétien peut, par sa prière, empêcher Dieu de mettre fin à l’univers, quand Dieu a résolu de briser son ouvrage ? N’est-ce pas là l’idée d’un énergumène, quelque sens qu’on puisse lui donner ?
Une observation beaucoup plus importante, c’est qu’à la fin du second siècle il y avait déjà des chrétiens très-riches. Il n’est pas étonnant qu’en deux cents années leurs missionnaires ardents et infatigables eussent attiré enfin à leur parti des gens d’honnêtes familles. Exclus des dignités, parce qu’ils ne voulaient pas assister aux cérémonies instituées pour la prospérité de l’empire, ils exerçaient le négoce comme les presbytériens et autres non-conformistes ont fait en France et font chez nous ; ils s’enrichissaient. Leurs agapes étaient de grands festins ; on leur reprochait déjà le luxe et la bonne chère. Tertullien en convient (chapitre XXXIX) : « Oui, dit-il ; mais dans les mystères d’Athènes et d’Égypte, ne fait-on pas bonne chère aussi ? Quelque dépense que nous fassions, elle est utile et pieuse, puisque les pauvres en profitent. Quantiscumque sumptibus constet, lucrum est pietatis, siquidem inopes refrigerio isto juvamus. »
Enfin le fougueux Tertullien se plaint de ce qu’on ne persécute pas les philosophes, et de ce qu’on réprime les chrétiens (chapitre XLVI). « Y a-t-il quelqu’un, dit-il, qui force un philosophe à sacrifier, à jurer par vos dieux ? Quis enim philosophum sacrificare aut dejerare, etc. » Cette différence prouve évidemment que les philosophes n’étaient pas dangereux, et que les chrétiens l’étaient. Les philosophes se moquaient, avec tous les magistrats, des superstitions populaires ; mais ils ne faisaient pas un parti, une faction dans l’empire, et les chrétiens commençaient à composer une faction si dangereuse qu’à la fin elle contribua à la destruction de l’empire romain. On voit, par ce seul trait, qu’ils auraient été les plus cruels persécuteurs s’ils avaient été les maîtres : leur secte, insociable, intolérante, n’attendait que le moment d’être en pleine liberté pour ravir la liberté au reste du genre humain.
Déjà Rutilius, préfet de Rome[3], disait de cette faction demi-juive et demi-chrétienne :
Atque utinam nunquam Judœa subacta fuisset
Pompeii bellis, imperioque Titi !
Latius excisæ pestis contagia serpunt ;
Victoresque suos natio victa premit.
Plût aux dieux que Titus, plût aux dieux que Pompée,
N’eussent jamais dompté cette infâme Judée !
Ses poisons parmi nous en sont plus répandus :
Les vainqueurs opprimés vont céder aux vaincus.
On voit par ces vers que les chrétiens osaient étaler le dogme affreux de l’intolérance : ils criaient partout qu’il fallait détruire l’ancienne religion de l’empire, et on entrevoyait qu’il n’y avait plus de milieu entre la nécessité de les exterminer, ou d’être bientôt exterminé par eux. Cependant telle fut l’indulgence du sénat qu’il y eut très-peu de condamnations à mort, comme l’avoue Origène dans sa réponse à Celse, au livre III.
Nous ne ferons pas ici une analyse des autres écrits de Tertullien : nous n’examinerons point son livre qu’il intitule le Scorpion, parce que les gnostiques piquent, à ce qu’il prétend, comme des scorpions ; ni son livre sur les manteaux, dont Malebranche s’est assez moqué. Mais ne passons pas sous silence son ouvrage sur l’âme : non-seulement il cherche à prouver qu’elle est matérielle, comme l’ont pensé tous les Pères des trois premiers siècles ; non-seulement il s’appuie de l’autorité du grand poëte Lucrèce,
Tangere enim ac tangi, nisi corpus, nulla potest res ;
(Lib. I, v. 305.)
mais il assure que l’âme est figurée et colorée : voilà les champions de l’Église ; voilà ses Pères. Au reste, n’oublions pas qu’il était prêtre et marié : ces deux états n’étaient pas encore des sacrements, et les évêques de Rome ne défendirent le mariage aux prêtres que quand ils furent assez puissants et assez ambitieux pour avoir, dans une partie de l’Europe, une milice qui, étant sans famille et sans patrie, fût plus soumise à ses ordres.
Chapitre XXIII. De Clément d’Alexandrie.
Clément, prêtre d’Alexandrie, appelle toujours les chrétiens gnostiques. Était-il d’une de ces sectes qui divisèrent les chrétiens et qui les diviseront toujours ? ou bien les chrétiens prenaient-ils alors le titre de gnostiques ? Quoi qu’il en soit, la seule chose qui puisse instruire et plaire dans ses ouvrages, c’est cette profusion de vers d’Homère, et même d’Orphée, de Musée, d’Hésiode, de Sophocle, d’Euripide, et de Ménandre, qu’il cite à la vérité mal à propos, mais qu’on relit toujours avec plaisir. C’est le seul des Pères des trois premiers siècles qui ait écrit dans ce goût ; il étale, dans son Exhortation aux nations et dans ses Stromates, une grande connaissance des anciens livres grecs, et des rites asiatiques et égyptiens ; il ne raisonne guère, et c’est tant mieux pour le lecteur.
Son plus grand défaut est de prendre toujours des fables inventées par des poëtes et par des romanciers pour le fond de la religion des Gentils, défaut commun aux autres Pères, et à tous les écrivains polémistes. Plus on impute de sottises à ses adversaires, plus on croit en être exempt ; ou plutôt on fait compensation de ridicule. On dit : Si vous trouvez mauvais que notre Jésus soit fils de Dieu, vous avez votre Bacchus, votre Hercule, votre Persée, qui sont fils de Dieu ; si notre Jésus a été transporté par le diable sur une montagne, vos géants ont jeté des montagnes à la tête de Jupiter. Si vous ne voulez pas croire que notre Jésus ait changé l’eau en vin dans une noce de village, nous ne croirons pas que les filles d’Anius aient changé tout ce qu’elles touchaient en blé, en vin, et en huile.
Le parallèle est très-long et très-exact des deux côtés.
Le plus singulier miracle de toute l’antiquité païenne, que rapporte Clément d’Alexandrie dans son Exhortation, c’est celui de Bacchus aux enfers. Bacchus ne savait pas le chemin ; un nommé Prosymnus, que Pausanias et Hygin appellent autrement, s’offrit à le lui enseigner, à condition qu’à son retour Bacchus (qui était fort joli) le payerait en faveurs, et qu’il souffrirait de lui ce que Jupiter fit à Ganymède, et Apollon à Hyacinthe. Bacchus accepta le marché, il alla aux enfers ; mais à son retour il trouva Prosymnus mort ; il ne voulut pas manquer à sa promesse, et, rencontrant un figuier auprès du tombeau de Prosymnus, il tailla une branche bien proprement en priape, il se l’enfonça, au nom de son bienfaiteur, dans la partie destinée à remplir sa promesse, et n’eut rien à se reprocher.
De pareilles extravagances, communes à presque toutes les anciennes religions, prouvent invinciblement que quiconque s’est écarté de la vraie religion, de la vraie philosophie, qui est l’adoration d’un Dieu sans aucun mélange ; quiconque, en un mot, s’est pu livrer aux superstitions, n’a pu dire que des choses insensées.
Mais, en bonne foi, ces fables milésiennes étaient-elles la religion romaine ? Le sénat a-t-il jamais élevé un temple à Bacchus se sodomisant lui-même ? à Mercure voleur ? Ganymède a-t-il eu des temples ? Adrien, à la vérité, fit ériger un temple à son ami Antinoüs, comme Alexandre à Éphestion ; mais les honorait-on en qualité de gitons ? Y a-t-il une médaille, un monument, dont l’inscription fût à Antinoüs pédéraste ? Les Pères de l’Église s’égayaient aux dépens de ceux qu’ils appelaient Gentils ; mais que les Gentils avaient de représailles à faire ! et qu’un prétendu Joseph mis dans la grande confrérie par un ange ; et qu’un Dieu charpentier dont les aïeules étaient des adultères, des incestueuses, des prostituées ; et qu’un Paul voyageant au troisième ciel ; et qu’un mari et sa femme frappés de mort pour n’avoir pas donné tout leur bien à Simon Barjone, fournissaient aux Gentils de terribles armes ! Les anges de Sodome ne valent-ils pas bien Bacchus et Prosymnus, ou la fable d’Apollon et d’Hyacinthe ?
Le bon sens est le même dans ce Clément que dans tous ses confrères. Dieu, selon lui, a fait le monde en six jours, et s’est reposé le septième, parce qu’il y a sept étoiles errantes ; parce que la petite ourse est composée de sept étoiles, ainsi que les pléiades ; parce qu’il y a sept principaux anges ; parce que la lune change de face tous les sept jours ; parce que le septième jour est critique dans les maladies. C’est là ce qu’ils appellent la vraie philosophie, τήν ἀληθῆν φιλοσοφίαν γνωστιϰὴν (tên alêthên philosophian gnôstikên). Voilà, encore une fois, les gens qui se préfèrent à Platon et à Cicéron ; et il nous faudra révérer aujourd’hui tous ces obscurs pédants, que l’indulgence des Romains laissait débiter leurs rêveries fanatiques dans Alexandrie, où les dogmes du christianisme se formèrent principalement !
Chapitre XXIV. D’Irénée.
Irénée, à la vérité, n’a ni science, ni philosophie, ni éloquence : il se borne presque toujours à répéter ce que disaient Justin, Tertullien, et les autres ; il croit avec eux que l’âme est une figure légère et aérienne ; il est persuadé du règne de mille ans dans une nouvelle Jérusalem descendue du ciel en terre. On voit dans son cinquième livre, chapitre XXXIII, quelle énorme quantité de farine produira chaque grain de blé, et combien de futailles il faudra pour chaque grappe de raisin dans cette belle ville ; il attend l’antechrist au bout de ces mille années, et explique merveilleusement le chiffre 666, qui est la marque de la bête. Nous avouons qu’en tout cela il ne diffère point des autres Pères de l’Église.
Mais une chose assez importante, et qu’on n’a peut-être pas assez relevée, c’est qu’il assure que Jésus est mort à cinquante ans passés, et non pas à trente et un, ou à trente-trois, comme on peut l’inférer des Évangiles.
Irénée atteste les Évangiles pour garants de cette opinion ; il prend à témoin tous les vieillards qui ont vécu avec Jean, et avec les autres apôtres ; il déclare positivement qu’il n’y a que ceux qui sont venus trop tard pour connaître les apôtres qui puissent être d’une opinion contraire. Il ajoute même, contre sa coutume, à ces preuves de fait un raisonnement assez concluant.
L’Évangile de Jean fait dire à Jésus : « Votre père Abraham a été exalté pour voir mes jours : il les a vus, et il s’en est bien réjoui ; » et les Juifs lui répondirent : « Es-tu fou ? tu n’as pas encore cinquante ans, et tu te vantes d’avoir vu notre père Abraham ? »
Irénée conclut de là que Jésus était près de sa cinquantième quand les Juifs lui parlaient ainsi. En effet, si ce Jésus avait été alors âgé de trente années au plus, on ne lui aurait pas parlé de cinquante années. Enfin, puisque Irénée appelle en témoignage tous les Évangiles et tous les vieillards qui avaient ces écrits entre les mains, les Évangiles de ce temps-là n’étaient donc pas ceux que nous avons aujourd’hui. Ils ont été altérés comme tant d’autres livres. Mais, puisqu’on les changea, on devait donc les rendre un peu plus raisonnables.
Chapitre XXV. D’Origène, et de la trinité.
Clément d’Alexandrie avait été le premier savant parmi les chrétiens. Origène fut le premier raisonneur. Mais quelle philosophie que celle de son temps ! Il fut au rang des enfants célèbres, et enseigna de très-bonne heure dans cette grande ville d’Alexandrie, où les chrétiens tenaient une école publique : les chrétiens n’en avaient point à Rome. Et en effet, parmi ceux qui prenaient le titre d’évêques de Rome, on ne compte pas un seul homme illustre : ce qui est très-remarquable. Cette Église, qui devint ensuite si puissante et si fière, tint tout des Égyptiens et des Grecs.
Il y avait sans doute une grande dose de folie dans la philosophie d’Origène, puisqu’il s’avisa de se couper les testicules. Épiphane a écrit qu’un préfet d’Alexandrie lui avait donné l’alternative, de servir de Ganymède à un Éthiopien, ou de sacrifier aux dieux, et qu’il avait sacrifié pour n’être point sodomisé par un vilain Éthiopien.
Si c’est là ce qui le détermina à se faire eunuque, ou si ce fut une autre raison, c’est ce que je laisse à examiner aux savants qui entreprendront l’histoire des eunuques ; je me borne ici à l’histoire des sottises de l’esprit humain.
Il fut le premier qui donna de la vogue au nonsense, au galimatias de la Trinité, qu’on avait oublié depuis Justin. On commençait dès lors chez les chrétiens à oser regarder le fils de Marie comme Dieu, comme une émanation du Père, comme le premier Éon, comme identifié en quelque sorte avec le Père ; mais on n’avait pas fait encore un Dieu du Saint-Esprit. On ne s’était pas avisé de falsifier je ne sais quelle épître attribuée à Jean, dans laquelle on inséra ces paroles ridicules : « Il y en a trois qui donnent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe, et l’Esprit saint. » Serait-ce ainsi qu’on devrait parler de trois substances ou personnes divines, composant ensemble le Dieu créateur du monde ? dirait-on qu’ils donnent témoignage ? D’autres exemplaires portent ces paroles plus ridicules encore : « Il y en a trois qui rendent témoignage en terre, l’esprit, l’eau, et le sang, et ces trois ne sont qu’un[1]. « On ajouta encore dans d’autres copies : et ces trois sont un en Jésus. Aucun de ces passages, tous différents les uns des autres, ne se trouve dans les anciens manuscrits ; aucun des Pères des trois premiers siècles ne les cite ; et d’ailleurs quel fruit en pourraient recueillir ceux qui admettent ces falsifications ? comment pourront-ils entendre que l’esprit, l’eau, et le sang, font la Trinité, et ne sont qu’un ? est-ce parce qu’il est dit que Jésus sua sang et eau, et qu’il rendit l’esprit ? Quel rapport de ces trois choses à un Dieu en trois hypostases ?
La trinité de Platon était d’une autre espèce ; on ne la connaît guère : la voici telle qu’on peut la découvrir dans son Timée. Le Demiourgos éternel est la première cause de tout ce qui existe ; son idée archétype est la seconde ; l’âme universelle, qui est son ouvrage, est la troisième. Il y a quelque sens dans cette opinion de Platon. Dieu conçoit l’idée du monde. Dieu le fait. Dieu l’anime ; mais jamais Platon n’a été assez fou pour dire que cela composait trois personnes en Dieu. Origène était platonicien ; il prit ce qu’il put de Platon, il fit une trinité à sa mode. Ce système resta si obscur dans les premiers siècles que Lactance, du temps de l’empereur Constantin, parlant au nom de tous les chrétiens, expliquant la créance de l’Église, et s’adressant à l’empereur même, ne dit pas un mot de la Trinité ; au contraire, voici comme il parle, au chapitre XXIX du livre IV de ses Institutions : « Peut-être quelqu’un me demandera comment nous adorons un seul Dieu, quand nous assurons qu’il y en a deux, le Père et le Fils ; mais nous ne les distinguons point parce que le Père ne peut pas être sans son Fils, et le Fils sans son Père. »
Le Saint-Esprit fut entièrement oublié par Lactance, et quelques années après on n’en fit qu’une commémoration fort légère, et par manière d’acquit, au concile de Nicée : car après avoir fait la déclaration aussi solennelle qu’inintelligible de ce dogme son ouvrage, que le Fils est consubstantiel au Père, le concile se contente de dire simplement : Nous croyons aussi au Saint-Esprit[1][1].
On peut dire qu’Origène jeta les premiers fondements de cette métaphysique chimérique qui n’a été qu’une source de discorde, et qui était absolument inutile à la morale. Il est évident qu’on pouvait être aussi honnête homme, aussi sage, aussi modéré, avec une hypostase qu’avec trois, et que ces inventions théologiques n’ont rien de commun avec nos devoirs.
Origène attribue un corps délié à Dieu, aussi bien qu’aux anges et à toutes les âmes ; et il dit que Dieu le père et Dieu le fils sont deux substances différentes ; que le Père est plus grand que le Fils, le Fils plus grand que le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit plus grand que les anges. Il dit que le Père est bon par lui-même ; mais que le Fils n’est pas bon par lui-même ; que le Fils n’est pas la vérité par rapport à son Père, mais l’image de la vérité par rapport à nous ; qu’il ne faut pas adorer le Fils, mais le Père ; que c’est au Père seul qu’on doit adresser ses prières ; que le Fils apporta du ciel la chair dont il se revêtit dans le sein de Marie, et qu’en montant au ciel il laissa son corps dans le soleil.
Il avoue que la vierge Marie, en accouchant du Fils de Dieu, se délivra d’un arrière-faix comme une autre ; ce qui l’obligea de se purifier dans le temple juif : car on sait bien que rien n’est si impur qu’un arrière-faix. Le dur et pétulant Jérôme lui a reproché aigrement, environ cent cinquante années après sa mort, beaucoup d’opinions semblables qui valent bien les opinions de Jérôme : car dès que les premiers chrétiens se mêlèrent d’avoir des dogmes, ils se dirent de grosses injures, et annoncèrent de loin les guerres civiles qui devaient désoler le monde pour des arguments.
N’oublions pas qu’Origène se signala plus que tout autre en tournant tous les faits de l’Écriture en allégories ; et il faut avouer que ces allégories sont fort plaisantes. La graisse des sacrifices est l’âme de Jésus-Christ ; la queue des animaux sacrifiés est la persévérance dans les bonnes œuvres. S’il est dit dans l’Exode, chapitre XXXIII, que Dieu met Moïse dans la fente d’un rocher afin que Moïse voie les fesses de Dieu, mais non pas son visage, cette fente du rocher est Jésus-Christ, au travers duquel on voit Dieu le père par derrière[3].
En voilà, je pense, assez pour faire connaître les Pères, et pour faire voir sur quels fondements on a bâti l’édifice le plus monstrueux qui ait jamais déshonoré la raison. Cette raison a dit à tous les hommes : La religion doit être claire, simple, universelle, à la portée de tous les esprits, parce qu’elle est faite pour tous les cœurs ; sa morale ne doit point être étouffée sous le dogme, rien d’absurde ne doit la défigurer. En vain la raison a tenu ce langage ; le fanatisme a crié plus haut qu’elle. Et quels maux n’a pas produits ce fanatisme ?
Chapitre XXVI. Des martyrs.
Pourquoi les Romains ne persécutèrent-ils jamais pour leur religion aucun de ces malheureux Juifs abhorrés, ne les obligèrent-ils jamais de renoncer à leurs superstitions, leur laissèrent-ils leurs rites et leurs lois, et leur permirent-ils des synagogues dans Rome, les comptèrent-ils même parmi les citoyens à qui on faisait des largesses de blé ? Et d’où vient que ces mêmes Romains, si indulgents, si libéraux envers ces malheureux Juifs, furent-ils, vers le iiie siècle, plus sévères envers les adorateurs d’un Juif ? N’est-ce point parce que les Juifs, occupés de vendre des chiffons et des philtres, n’avaient pas la rage d’exterminer la religion de l’empire, et que les chrétiens intolérants étaient possédés de cette rage[1] ?
On punit en effet au IIIe siècle quelques-uns des plus fanatiques ; mais en si petit nombre qu’aucun historien romain n’a daigné en parler. Les Juifs, révoltés sous Vespasien, sous Trajan, sous Adrien, furent toujours cruellement châtiés comme ils le méritaient : on leur défendit même d’aller dans leur petite ville de Jérusalem, dont on abolit jusqu’au nom, parce qu’elle avait été toujours le centre de la révolte ; mais il leur fut permis de circoncire leurs enfants sous les murs du Capitole, et dans toutes les provinces de l’empire.
Les prêtres d’Isis furent punis à Rome sous Tibère. Leur temple fut démoli, parce que ce temple était un marché de prostitution, et un repaire de brigands ; mais on permit aux prêtres et prêtresses d’Isis d’exercer leur métier partout ailleurs. Leurs troupes allaient impunément en procession de ville en ville ; ils faisaient des miracles, guérissaient les maladies, disaient la bonne aventure, dansaient la danse d’Isis avec des castagnettes. C’est ce qu’on peut voir amplement dans Apulée. Nous observerons ici que ces mêmes processions se sont perpétuées jusqu’à nos jours. Il y a encore en Italie quelques restes de ces anciens vagabonds, qu’on appelle Zingari, et chez nous Gipsies, qui est l’abrégé d’Égyptiens, et qu’on a, je crois, nommés Bohèmes en France. La seule différence entre eux et les Juifs, c’est que les Juifs, ayant toujours exercé le commerce comme les Banians, se sont maintenus ainsi que les Banians, et que les troupes d’Isis, étant en très-petit nombre, sont presque anéanties.
Les magistrats romains, qui donnaient tant de liberté aux Isiaques et aux Juifs, en usaient de même avec toutes les autres sectes du monde. Chaque dieu était bienvenu à Rome :
Dignus Roma locus, quo deus omnis eat.
(Ovide, Fast., lib. IV, v. 270.)
Tous les dieux de la terre étaient devenus citoyens de Rome. Aucune secte n’était assez folle pour vouloir subjuguer les autres ; ainsi toutes vivaient en paix.
La secte chrétienne fut la seule qui, sur la fin du second siècle de notre ère, osât dire qu’elle voulait donner l’exclusion à tous les rites de l’empire, et qu’elle devait non-seulement dominer, mais écraser toutes les religions ; les christicoles ne cessaient de dire que leur Dieu était un Dieu jaloux : belle définition de l’Être des êtres, que de lui imputer le plus lâche des vices !
Les enthousiastes, qui prêchaient dans leurs assemblées, formaient un peuple de fanatiques. Il était impossible que parmi tant de têtes échauffées il ne se trouvât des insensés qui insultassent les prêtres des dieux, qui troublassent l’ordre public, qui commissent des indécences punissables. C’est ce que nous avons vu arriver chez tous les sectaires de l’Europe, qui tous, comme nous le prouverons, ont eu infiniment plus de martyrs égorgés par nos mains que les chrétiens n’en ont jamais eu sous les empereurs.
Les magistrats romains, excités par les plaintes du peuple, purent s’emporter quelquefois à des cruautés indignes ; ils purent envoyer des femmes à la mort, quoique assurément cette barbarie ne soit point prouvée. Mais qui osera reprendre les Romains d’avoir été trop sévères, quand on voit le chrétien Marcel, centurion, jeter sa ceinture militaire et son bâton de commandant au milieu des aigles romaines, en criant d’une voix séditieuse : « Je ne veux servir que Jésus-Christ, le roi éternel ; je renonce aux empereurs » ? Dans quelle armée aurait-on laissé impunie une insolence si pernicieuse ? Je ne l’aurais pas soufferte assurément dans le temps que j’étais secrétaire d’État de la guerre, et le duc de Marlborough ne l’eût pas soufferte plus que moi.
S’il est vrai que Polyeucte en Arménie, le jour où l’on rendait grâces aux dieux dans le temple pour une victoire signalée, ait choisi ce moment pour renverser les statues, pour jeter l’encens par terre, n’est-ce pas en tout pays le crime d’un insensé ?
Quand le diacre Laurent refuse au préfet de Rome de contribuer aux charges publiques ; quand, ayant promis de donner quelque argent du trésor des chrétiens, qui était considérable, il n’amène que des gueux au lieu d’argent, n’est-ce pas visiblement insulter l’empereur, n’est-ce pas être criminel de lèse-majesté ? Il est fort douteux qu’on ait fait faire un gril de six pieds pour cuire Laurent, mais il est certain qu’il méritait punition.
L’ampoulé Grégoire de Nysse fait l’éloge de saint Théodore, qui s’avisa de brûler dans Amazée le temple de Cybèle, comme on dit qu’Érostrate avait brûlé le temple de Diane. On a osé faire un saint de cet incendiaire, qui certainement méritait le plus grand supplice. On nous fait adorer ce que nous punissons par le dernier supplice.
Tous les martyres d’ailleurs, que tant d’écrivains ont copiés de siècle en siècle, ressemblent tellement à la Légende dorée qu’en vérité il n’y a pas un seul de ces contes qui ne fasse pitié. Un de ces premiers contes est celui de Perpétue et de Félicité. Perpétue vit une échelle d’or qui allait jusqu’au ciel. (Jacob n’en avait vu qu’une de bois : cela marque la supériorité de la loi nouvelle.) Perpétue monte à l’échelle : elle voit dans un jardin un grand berger blanc qui trayait ses brebis, et qui lui donne une cuillerée de lait caillé. Après trois ou quatre visions pareilles, on expose Perpétue et Félicité à un ours et à une vache.
Un bénédictin français, nommé Ruinart, croyant répondre à notre savant compatriote Dodwell, a recueilli de prétendus actes de martyrs, qu’il appelle les Actes sincères. Ruinart commence par le martyre de Jacques, frère aîné de Jésus, rapporté dans l’Histoire ecclésiastique d’Eusèbe, trois cent trente années après l’événement.
Ne cessons jamais d’observer que Dieu avait des frères hommes. Ce frère aîné, dit-on, était un Juif très-dévot ; il ne cessait de prier ni de sacrifier dans le temple juif, même après la descente du Saint-Esprit ; il n’était donc pas chrétien. Les Juifs l’appelaient Oblia le juste ; on le prie de monter sur la plate-forme du temple pour déclarer que Jésus était un imposteur : ces Juifs étaient donc bien sots de s’adresser au frère de Jésus. Il ne manqua pas de déclarer sur la plate-forme que son cadet était le sauveur du monde, et il fut lapidé.
Que dirons-nous de la conversation d’Ignace avec l’empereur Trajan, qui lui dit : Qui es-tu, esprit impur ? et de la bienheureuse Symphorose, qui fut dénoncée à l’empereur Adrien par ses dieux lares ? et de Polycarpe, à qui les flammes d’un bûcher n’osèrent toucher, mais qui ne put résister au tranchant du glaive ? et du soulier de la martyre sainte Épipode, qui guérit un gentilhomme de la fièvre ?
Et de saint Cassien, maître d’école, qui fut fessé par ses écoliers ? et de sainte Potamienne, qui, n’ayant pas voulu coucher avec le gouverneur d’Alexandrie, fut plongée trois heures entières dans la poix-résine bouillante, et en sortit avec la peau la plus blanche et la plus fine ?
Et de Pionius, qui resta sain et sauf au milieu des flammes, et qui en mourut je ne sais comment ?
Et du comédien Genest, qui devint chrétien en jouant une farce[2] devant l’empereur Dioclétien, et qui fut condamné par cet empereur dans le temps qu’il favorisait le plus les chrétiens ? Et d’une légion thébaine, laquelle fut envoyée d’Orient en Occident pour aller réprimer la sédition des Bagaudes, qui était déjà réprimée, et qui fut martyrisée tout entière dans un temps où l’on ne martyrisait personne, et dans un lieu où il n’est pas possible de mettre quatre cents hommes en bataille ; et qui enfin fut transmise au public par écrit, deux cents ans après cette belle aventure ?
Ce serait un ennui insupportable de rapporter tous ces prétendus martyres. Cependant je ne peux m’empêcher de jeter encore un coup d’œil sur quelques martyrs des plus célèbres.
Nilus, témoin oculaire à la vérité, mais qui est inconnu (et c’est grand dommage), assure que son ami saint Théodote, cabaretier de son métier, faisait tous les miracles qu’il voulait. C’était à lui de changer l’eau en vin ; mais il aimait mieux guérir les malades en les touchant du bout du doigt. Le cabaretier Théodote rencontra un curé de la ville d’Ancyre dans un pré ; ils trouvèrent ce pré tout à fait propre à y bâtir une chapelle dans un temps de persécution : « Je le veux bien, dit le prêtre, mais il me faut des reliques. — Qu’à cela ne tienne, dit le saint, vous en aurez bientôt ; et voilà ma bague que je vous donne en gage. » Il était bien sûr de son fait, comme vous l’allez voir.
On condamna bientôt sept vierges chrétiennes d’Ancyre, de soixante et dix ans chacune, à être livrées aux brutales passions des jeunes gens de la ville. La Légende ne manque pas de remarquer que ces demoiselles étaient très-ridées ; et ce qui est fort étonnant, c’est que ces jeunes gens ne leur firent pas la moindre avance, à l’exception d’un seul qui, ayant en sa personne de quoi négliger ce point-là, voulut tenter l’aventure, et s’en dégoûta bientôt. Le gouverneur, extrêmement irrité que ces sept vieilles n’eussent pas subi le supplice qu’il leur destinait, les fit prêtresses de Diane : ce que ces vierges chrétiennes acceptèrent sans difficulté. Elles furent nommées pour aller laver la statue de Diane dans le lac voisin ; elles étaient toutes nues, car c’était sans doute l’usage que la chaste Diane ne fût jamais servie que par des filles nues, quoiqu’on n’approchât jamais d’elle qu’avec un grand voile. Deux chœurs de ménades et de bacchantes, armées de thyrses, précédaient le char, selon la remarque judicieuse de l’auteur, qui prend ici Diane pour Bacchus ; mais, comme il a été témoin oculaire, il n’y a rien à lui dire.
Saint Théodote tremblait que ces sept vierges ne succombassent à quelques tentations : il était en prières, lorsque sa femme vint lui apprendre qu’on venait de jeter les sept vieilles dans le lac ; il remercia Dieu d’avoir ainsi sauvé leur pudicité. Le gouverneur fit faire une garde exacte autour du lac, pour empêcher les chrétiens, qui avaient coutume de marcher sur les eaux, de venir enlever leurs corps. Le saint cabaretier était au désespoir : il allait d’église en église, car tout était plein de belles églises pendant ces affreuses persécutions ; mais les païens, rusés, avaient bouché toutes les portes. Le cabaretier prit alors le parti de dormir : l’une des vieilles lui apparut dans son premier sommeil ; c’était, ne vous déplaise, sainte Thécuse, qui lui dit en propres mots : « Mon cher Théodote, souffrirez-vous que nos corps soient mangés par des poissons ? »
Théodote s’éveille, il résolut de repêcher les saintes du fond du lac au péril de sa vie. Il fait tant qu’au bout de trois jours, ayant donné aux poissons le temps de les manger, il court au lac par une nuit noire avec deux braves chrétiens.
Un cavalier céleste se met à leur tête, portant un grand flambeau devant eux pour empêcher les gardes de les découvrir : le cavalier prend sa lance, fond sur les gardes, les met en fuite ; c’était, comme chacun sait, saint Soziandre, ancien ami de Théodote, lequel avait été martyrisé depuis peu. Ce n’est pas tout ; un orage violent mêlé de foudres et d’éclairs et accompagné d’une pluie prodigieuse, avait mis le lac à sec. Les sept vieilles sont repêchées et proprement enterrées.
Vous croyez bien que l’attentat de Théodote fut bientôt découvert ; le cavalier céleste ne put l’empêcher d’être fouetté et appliqué à la question. Quand Théodote eut été bien étrillé, il cria aux chrétiens et aux idolâtres : « Voyez, mes amis, de quelles grâces notre Seigneur Jésus comble ses serviteurs ! il les fait fouetter jusqu’à ce qu’ils n’aient plus de peau, et leur donne la force de supporter tout cela ; » enfin il fut pendu.
Son ami Fronton le curé fit bien voir alors que le saint était cabaretier : car en ayant reçu précédemment quelques bouteilles d’excellent vin, il enivra les gardes, et emporta le pendu, lequel lui dit : « Monsieur le curé, je vous avais promis des reliques, je vous ai tenu parole. »
Cette histoire admirable est une des plus avérées. Qui pourrait en douter après le témoignage du jésuite Bollandus et du bénédictin Ruinart ?
Ces contes de vieilles me dégoûtent ; je n’en parlerai pas davantage. J’avoue qu’il y eut en effet quelques chrétiens suppliciés en divers temps, comme des séditieux qui avaient l’insolence d’être intolérants et d’insulter le gouvernement. Ils eurent la couronne du martyre, et la méritaient bien. Ce que je plains, c’est de pauvres femmes imbéciles, séduites par ces non-conformistes. Ils étaient bien coupables d’abuser de la facilité de ces faibles créatures, et d’en faire des énergumènes ; mais les juges qui en firent mourir quelques-unes étaient des barbares.
Dieu merci, il y eut peu de ces exécutions. Les païens furent bien loin d’exercer sur ces énergumènes les cruautés que nous avons depuis si longtemps déployées les uns contre les autres. Il semble que surtout les papistes aient forgé tant de martyres imaginaires dans les premiers siècles pour justifier les massacres dont leur Église s’est souillée.
Une preuve bien forte qu’il n’y eut jamais de grandes persécutions contre les premiers chrétiens, c’est qu’Alexandrie, qui était le centre, le chef-lieu de la secte, eut toujours publiquement une école du christianisme ouverte, comme le Lycée, le Portique, et l’Académie d’Athènes. Il y eut une suite de professeurs chrétiens. Pantène succéda publiquement à un Marc, qu’on a pris mal à propos pour Marc l’apôtre. Après Pantène vient Clément d’Alexandrie, dont la chaire fut ensuite occupée par Origène, qui laissa une foule de disciples. Tant qu’ils se bornèrent à ergoter, ils furent paisibles ; mais lorsqu’ils s’élevèrent contre les lois et la police publique, ils furent punis. On les réprima surtout sous l’empire de Décius ; Origène même fut mis en prison. Cyprien, évêque de Carthage, ne dissimule pas que les chrétiens s’étaient attiré cette persécution. « Chacun d’eux, dit-il dans son livre Des Tombés, court après les biens et les honneurs avec une fureur insatiable. Les évêques sont sans religion, les femmes sans pudeur ; la friponnerie règne ; on jure, on se parjure ; les animosités divisent les chrétiens ; les évêques abandonnent les chaires pour courir aux foires, et pour s’enrichir par le négoce ; enfin nous nous plaisons à nous seuls, et nous déplaisons à tout le monde. »
Il n’est pas étonnant que ces chrétiens eussent de violentes querelles avec les partisans de la religion de l’empire, que l’intérêt entrât dans ces querelles, qu’elles causassent souvent des troubles violents, et qu’enfin ils s’attirassent une persécution. Le fameux jurisconsulte Ulpien avait regardé la secte comme une faction très-dangereuse, et qui pouvait un jour servir à la ruine de l’État ; en quoi il ne se trompa point.
Chapitre XXVII. Des miracles.
Après les merveilles orientales de l’Ancien Testament ; après que, dans le Nouveau, Dieu, emporté sur une montagne par le diable, en est descendu pour changer des cruches d’eau en cruches de vin ; qu’il a séché un figuier, parce que ce figuier n’avait pas de figues sur la fin de l’hiver ; qu’il a envoyé des diables dans le corps de deux mille cochons ; après, dis-je, qu’on a vu toutes ces belles choses, il n’est pas étonnant qu’elles aient été imitées.
Pierre Simon Barjone a très-bien fait de ressusciter la couturière Dorcas : c’est bien le moins qu’on puisse faire pour une fille qui raccommodait gratis les tuniques des fidèles. Mais je ne passe point à Simon Pierre Barjone d’avoir fait mourir de mort subite Ananie et sa femme Saphire, deux bonnes créatures, qu’on suppose avoir été assez sottes pour donner tous leurs biens aux apôtres. Leur crime était d’avoir retenu de quoi subvenir à leurs besoins pressants.
Ô Pierre ! ô apôtres désintéressés ! quoi ! déjà vous persuadez à vos dirigés de vous donner leur bien ! De quel droit ravissez-vous ainsi toute la fortune d’une famille ? Voilà donc le premier exemple de la rapine de votre secte, et de la rapine la plus punissable ? Venez à Londres faire le même manége, et vous verrez si les héritiers de Saphire et d’Ananie ne vous feront pas rendre gorge, et si le grand juré vous laissera impunis. — Mais ils ont donné leur argent de bon gré ! — Mais vous les avez séduits pour les dépouiller de leur bon gré. — Ils ont retenu quelque chose pour eux ! — Lâches ravisseurs, vous osez leur faire un crime d’avoir gardé de quoi ne pas mourir de faim ! Ils ont menti, dites-vous.
Étaient-ils obligés de vous dire leur secret ? Si un escroc vient me dire : Avez-vous de l’argent ? je ferai très-bien de lui répondre : Je n’en ai point. Voilà, en un mot, le plus abominable miracle qu’on puisse trouver dans la légende des miracles. Aucun de tous ceux qu’on a faits depuis n’en approche ; et si la chose était vraie, ce serait la plus exécrable des choses vraies.
Il est doux d’avoir le don des langues ; il serait plus doux d’avoir le sens commun. Les Pères de l’Église eurent du moins le don de la langue, car ils parlèrent beaucoup ; mais il n’y eut parmi eux qu’Origène et Jérôme qui sussent l’hébreu. Augustin, Ambroise, Jean Chrysostome, n’en savaient pas un mot.
Nous avons déjà vu les beaux miracles des martyrs, qui se laissaient toujours couper la tête pour dernier prodige. Origène à la vérité, dans son premier livre contre Celse, dit que les chrétiens ont des visions, mais il n’ose prétendre qu’ils ressuscitent des morts.
Le christianisme opéra toujours de grandes choses dans les premiers siècles. Saint Jean, par exemple, enterré dans Éphèse, remuait continuellement dans sa fosse ; ce miracle utile dura jusqu’au temps de l’évêque d’Hippone Augustin. Les prédictions, les exorcismes, ne manquaient jamais : Lucien même en rend témoignage. Voici comme il rend gloire à la vérité dans le chapitre de la mort du chrétien Peregrinus, qui eut la vanité de se brûler : « Dès qu’un joueur de gobelets habile se fait chrétien, il est sûr de faire fortune aux dépens des sots fanatiques auxquels il a à faire. »
Les chrétiens faisaient tous les jours des miracles, dont aucun Romain n’entendit jamais parler. Ceux de Grégoire le thaumaturge, ou le merveilleux, sont en effet dignes de ce surnom. Premièrement, un beau vieillard descend du ciel pour lui dicter le catéchisme qu’il doit enseigner. Chemin faisant il écrit une lettre au diable ; la lettre parvient à son adresse, et le diable ne manque pas de faire ce que Grégoire lui ordonne.
Deux frères se disputent un étang ; Grégoire sèche l’étang, et le fait disparaître pour apaiser la noise. Il rencontre un charbonnier, et le fait évêque. C’est apparemment depuis ce temps-là que la foi du charbonnier est passée en proverbe. Mais ce miracle n’est pas grand ; j’ai vu quelques évêques dans mes voyages qui n’en savaient pas plus que le charbonnier de Grégoire. Un miracle plus rare, c’est qu’un jour les païens couraient après Grégoire et son diacre pour leur faire un mauvais parti ; les voilà qui se changent tous les deux en arbres. Ce thaumaturge était un vrai Protée. Mais quel nom donnera-t-on à ceux qui ont écrit ces inepties ? et comment se peut-il que Fleury les ait copiées dans son Histoire ecclésiastique ? Est-il possible qu’un homme qui avait quelque sens, et qui raisonnait tolérablement sur d’autres sujets, ait rapporté sérieusement que Dieu rendit folle une vieille pour empêcher qu’on ne découvrît saint Félix de Nole pendant la persécution[1] ?
On me répondra que Fleury s’est borné à transcrire, et moi je répondrai qu’il ne fallait pas transcrire des bêtises injurieuses à la Divinité ; qu’il a été coupable s’il les a copiées sans les croire, et qu’il a été un imbécile s’il les a crues.
Chapitre XXVIII. Des chrétiens depuis Dioclétien jusqu’à Constantin.
Les chrétiens furent bien plus souvent tolérés et même protégés qu’ils n’essuyèrent de persécutions. Le règne de Dioclétien fut, pendant dix-huit années entières, un règne de paix et de faveurs signalées pour eux. Les deux principaux officiers du palais, Gorgonius et Dorothée, étaient chrétiens. On n’exigeait, plus qu’ils sacrifiassent aux dieux de l’empire pour entrer dans les emplois publics. Enfin Prisca, femme de Dioclétien, était chrétienne ; aussi jouissaient-ils des plus grands avantages. Ils bâtissaient des temples superbes, après avoir tous dit, dans les premiers siècles, qu’il ne fallait ni temples ni autels à Dieu ; et, passant de la simplicité d’une église pauvre et cachée à la magnificence d’une église opulente et pleine d’ostentation, ils étalaient des vases d’or et des ornements éblouissants ; quelques-uns de leurs temples s’élevaient sur les ruines d’anciens périptères païens abandonnés. Leur temple, à Nicomédie, dominait sur le palais impérial ; et, comme le remarque Eusèbe, tant de prospérité avait produit l’insolence, l’usure, la mollesse, et la dépravation des mœurs. On ne voyait, dit Eusèbe, qu’envie, médisance, discorde, et sédition.
Ce fut cet esprit de sédition qui lassa la patience du césar Galère-Maximien. Les chrétiens l’irritèrent précisément dans le temps que Dioclétien venait de publier des édits fulminants contre les manichéens. Un des édits de cet empereur commence ainsi : « Nous avons appris depuis peu que des manichéens, sortis de la Perse, notre ancienne ennemie, inondent notre monde. »
Ces manichéens n’avaient encore causé aucun trouble : ils étaient nombreux dans Alexandrie et dans l’Afrique ; mais ils ne disputaient que contre les chrétiens, et il n’y a jamais eu le moindre monument d’une querelle entre la religion des anciens Romains et la secte de Manès. Les différentes sectes des chrétiens, au contraire, gnostiques, marcionites, valentiniens, ébionites, galiléens, opposées les unes aux autres, et toutes ennemies de la religion dominante, répandaient la confusion dans l’empire.
N’est-il pas bien vraisemblable que les chrétiens eurent assez de crédit au palais pour obtenir un édit de l’empereur contre le manichéisme ? Cette secte, qui était un mélange de l’ancienne religion des mages et du christianisme, était très-dangereuse, surtout en Orient, pour l’Église naissante. L’idée de réunir ce que l’Orient avait de plus sacré avec la secte des chrétiens faisait déjà beaucoup d’impression.
La théologie obscure et sublime des mages, mêlée avec la théologie non moins obscure des chrétiens platoniciens, était bien propre à séduire des esprits romanesques qui se payaient de paroles. Enfin, puisqu’au bout d’un siècle le fameux pasteur d’Hippone, Augustin, fut manichéen, il est bien sûr que cette secte avait des charmes pour les imaginations allumées. Manès avait été crucifié en Perse, si l’on en croit Chondemir ; et les chrétiens, amoureux de leur crucifié, n’en voulaient pas un second.
Je sais que nous n’avons aucune preuve que les chrétiens obtinrent l’édit contre le manichéisme ; mais enfin il y en eut un sanglant ; et il n’y en avait point contre les chrétiens. Quelle fut donc ensuite la cause de la disgrâce des chrétiens, les deux dernières années du règne d’un empereur assez philosophe pour abdiquer l’empire, pour vivre en solitaire, et pour ne s’en repentir jamais ?
Les chrétiens étaient attachés à Constance le Pâle, père du célèbre Constantin, qu’il eut d’une servante de sa maison nommée Hélène[1].
Constance les protégea toujours ouvertement. On ne sait si le césar Galérius fut jaloux de la préférence que les chrétiens donnaient sur lui à Constance le Pâle, ou s’il eut quelque autre sujet de se plaindre d’eux ; mais il trouva fort mauvais qu’ils bâtissent une église qui offusquait son palais. Il sollicita longtemps Dioclétien de faire abattre cette église et de prohiber l’exercice de la religion chrétienne. Dioclétien résista ; il assembla enfin un conseil composé des principaux officiers de l’empire. Je me souviens d’avoir lu dans l’Histoire ecclésiastique de Fleury que « cet empereur avait la malice de ne point consulter quand il voulait faire du bien, et de consulter quand il s’agissait de faire du mal ». Ce que Fleury appelle malice, je l’avoue, me paraît le plus grand éloge d’un souverain. Y a-t-il rien de plus beau que de faire le bien par soi-même ? Un grand cœur alors ne consulte personne ; mais dans les actions de rigueur, un homme juste et sage ne fait rien sans conseil.
L’église de Nicomédie fut enfin démolie en 303 ; mais Dioclétien se contenta de décerner que les chrétiens ne seraient plus élevés aux dignités de l’empire : c’était retirer ses grâces, mais ce n’était point persécuter. Il arriva qu’un chrétien eut l’insolence d’arracher publiquement l’édit de l’empereur, de le déchirer, et de le fouler aux pieds. Ce crime fut puni, comme il méritait de l’être, par la mort du coupable. Alors Prisca, femme de l’empereur, n’osa plus protéger des séditieux ; elle quitta même la religion chrétienne, quand elle vit qu’elle ne conduisait qu’au fanatisme et à la révolte. Galérius fut alors en pleine liberté d’exercer sa vengeance.
Il y avait en ce temps beaucoup de chrétiens dans l’Arménie et dans la Syrie : il s’y fit des soulèvements ; les chrétiens même furent accusés d’avoir mis le feu au palais de Galérius. Il était bien naturel de croire que des gens qui avaient déchiré publiquement les édits, et qui avaient brûlé des temples comme ils l’avaient fait souvent, avaient aussi brûlé le palais ; cependant il est très-faux qu’il y eût une persécution générale contre eux. Il faut bien qu’on n’eût sévi que légalement contre les réfractaires, puisque Dioclétien ordonna qu’on enterrât les suppliciés, ce qu’il n’aurait point fait si on avait persécuté sans forme de procès. On ne trouve aucun édit qui condamne à la mort uniquement pour faire profession du christianisme. Cela eût été aussi insensé et aussi horrible que la Saint-Barthélemy, que les massacres d’Irlande, et que la croisade contre les Albigeois : car alors un cinquième ou un sixième de l’empire était chrétien. Une telle persécution eût forcé cette sixième partie de l’empire de courir aux armes, et le désespoir qui l’eût armée l’aurait rendue terrible.
Des déclamateurs, comme Eusèbe de Césarée et ceux qui l’ont suivi, disent en général qu’il y eut une quantité incroyable de chrétiens immolés. Mais d’où vient que l’historien Zosime n’en dit pas un seul mot ? Pourquoi Zonare, chrétien, ne nomme-t-il aucun de ces fameux martyrs ? D’où vient que l’exagération ecclésiastique ne nous a pas conservé les noms de cinquante chrétiens livrés à la mort ?
Si on examinait avec des yeux critiques ces prétendus massacres que la Légende impute vaguement à Dioclétien, il y aurait prodigieusement à rabattre, ou plutôt on aurait le plus profond mépris pour ces impostures, et on cesserait de regarder Dioclétien comme un persécuteur.
C’est en effet sous ce prince qu’on place la ridicule aventure du cabaretier Théodote, la prétendue légion thébaine immolée, le petit Romain né bègue, qui parle avec une volubilité incroyable sitôt que le médecin de l’empereur, devenu bourreau, lui a coupé la langue ; et vingt autres aventures pareilles que les vieilles radoteuses de Cornouailles auraient honte aujourd’hui de débiter à leurs petits enfants.
Chapitre XXIX. De Constantin.
Quel est l’homme qui, ayant reçu une éducation tolérable, puisse ignorer ce que c’était que Constantin ? Il se fait reconnaître empereur au fond de l’Angleterre par une petite armée d’étrangers : avait-il plus de droit à l’empire que Maxence, élu par le sénat ou par les armées romaines ?
Quelque temps après, il vient en Gaule et ramasse des soldats chrétiens attachés à son père ; il passe les Alpes, grossissant toujours son armée ; il attaque son rival, qui tombe dans le Tibre au milieu de la bataille. On ne manque pas de dire qu’il y a eu du miracle dans sa victoire, et qu’on a vu dans les nuées un étendard et une croix céleste où chacun pouvait lire en lettres grecques : Tu vaincras par ce signe. Car les Gaulois, les Bretons, les Allobroges, les Insubriens, qu’il traînait à sa suite, entendaient tous le grec parfaitement, et Dieu aimait mieux leur parler grec que latin.
Cependant, malgré ce beau miracle qu’il fit lui-même divulguer, il ne se fit point encore chrétien ; il se contenta, en bon politique, de donner liberté de conscience à tout le monde, et il fit une profession si ouverte du paganisme qu’il prit le titre de grand pontife : ainsi il est démontré qu’il ménageait les deux religions ; en quoi il se conduisait très-prudemment dans les premières années de sa tyrannie. Je me sers ici du mot de tyrannie sans aucun scrupule, car je ne me suis pas acoutumé à reconnaître pour souverain un homme qui n’a d’autres droits que la force ; et je me sens trop humain pour ne pas appeler tyran un barbare qui a fait assassiner son beau-père Maximien-Hercule à Marseille, sous le prétexte le moins spécieux, et l’empereur. Licinius, son beau-frère, à Thessalonique, par la plus lâche perfidie.
J’appelle tyran sans doute celui qui fait égorger son fils Crispus, étouffer sa femme Fausta, et qui, souillé de meurtres et de parricides, étalant le faste le plus révoltant, se livrait à tous les plaisirs dans la plus infâme mollesse.
Que de lâches flatteurs ecclésiastiques lui prodiguent des éloges, même en avouant ses crimes ; qu’ils voient, s’ils veulent, en lui un grand homme, un saint, parce qu’il s’est fait plonger rois fois dans une cuve d’eau : un homme de ma nation et de mon caractère, et qui a servi une souveraine vertueuse, ne s’avilira jamais jusqu’à prononcer le nom de Constantin sans horreur.
Zosime rapporte, et cela est bien vraisemblable, que Constantin, aussi faible que cruel, mêlant la superstition aux crimes, comme tant d’autres princes, crut trouver dans le christianisme l’expiation de ses forfaits. À la bonne heure que les évêques intéressés lui aient fait croire que le Dieu des chrétiens lui pardonnait tout, et lui saurait un gré infini de leur avoir donné de l’argent et des honneurs ; pour moi, je n’aurais point trouvé de Dieu qui eût reçu en grâce un cœur si fourbe et si inhumain ; il n’appartient qu’à des prêtres de canoniser l’assassin d’Urie chez les Juifs, et le meurtrier de sa femme et de son fils chez les chrétiens.
Le caractère de Constantin, son faste et ses cruautés, sont assez bien exprimés dans ces deux vers, qu’un de ses malheureux courtisans, nommé Ablavius, afficha à la porte du palais :
Saturni aurea secla quis requirat ?
Sunt hæc gemmea, sed Nevoniana.
Qui peut regretter le siècle d’or de Saturne ?
Celui-ci est de pierreries, mais il est de Néron.
Mais qu’aurait dû dire cet Ablavius du zèle charitable des chrétiens, qui, dès qu’ils furent mis par Constantin en pleine liberté, assassinèrent Candidien, fils de l’empereur Galérius, un fils de l’empereur Maximien, âgé de huit ans, sa fille, âgée de sept, et noyèrent leur mère dans l’Oronte ? Ils poursuivirent longtemps la vieille impératrice Valérie, veuve de Galérius, qui fuyait leur vengeance. Ils l’atteignirent à Thessalonique, la massacrèrent, et jetèrent son corps dans la mer. C’est ainsi qu’ils signalèrent leur douceur évangélique ; et ils se plaignent d’avoir eu des martyrs !
Chapitre XXX. Des querelles chrétiennes avant Constantin et sous son règne.
Avant, pendant, et après Constantin, la secte chrétienne fut toujours divisée en plusieurs sectes, en plusieurs factions, et en plusieurs schismes. Il était impossible que des gens qui n’avaient aucun système suivi, qui n’avaient pas même ce petit Credo[1] si faussement imputé depuis aux apôtres, différant entre eux de nation, de langage, et de mœurs, fussent réunis dans la même créance.
Saturnin, Basilide, Carpocrate, Euphrate, Valentin, Cerdon, Marcion, Hermogène, Hermas, Justin, Tertullien, Origène, eurent tous des opinions contraires ; et tandis que les magistrats romains tâchaient quelquefois de réprimer les chrétiens, on les voyait tous, acharnés les uns contre les autres, s’excommunier, s’anathématiser réciproquement, et se combattre du fond de leurs cachots : c’était bien là le plus sensible et le plus déplorable effet du fanatisme.
La fureur de dominer ouvrit une autre source de discorde : on se disputa ce qu’on appelait une dignité d’évêque, avec le même emportement et les mêmes fraudes qui signalèrent depuis les schismes de quarante antipapes. On était aussi jaloux de commander à une petite populace obscure que les Urbain, les Jean, l’ont été de donner des ordres à des rois.
Novat disputa la première place chrétienne dans Carthage à Cyprien, qui fut élu. Novatien disputa l’évêché de Rome à Corneille ; chacun d’eux reçut l’imposition des mains par les évêques de son parti. Ils osaient déjà troubler Rome, et les compilateurs théologiques osent s’étonner aujourd’hui que Décius ait fait punir quelques-uns de ces perturbateurs ! Cependant Décius, sous lequel Cyprien fut supplicié, ne punit ni Novatien ni Corneille ; on laissa ces rivaux obscurs se déclarer la guerre, comme on laisse des chiens se battre dans une basse-cour, pourvu qu’ils ne mordent pas leurs maîtres.
Du temps de Constantin il y eut un pareil schisme à Carthage ; deux antipapes africains, ou anti-évêques, Cécilien et Majorin, se disputèrent la chaire, qui commençait à devenir un objet d’ambition. Il y avait des femmes dans chaque parti. Donat succéda à Majorin, et forma le premier des schismes sanglants qui devaient souiller le christianisme. Eusèbe rapporte qu’on se battait avec des massues, parce que Jésus, dit-on, avait ordonné à Pierre de remettre son épée dans le fourreau. Dans la suite on fut moins scrupuleux ; les donatistes et les cyprianistes se battirent avec le fer. Il s’ouvrait dans le même temps une scène de trois cents ans de carnage pour la querelle d’Alexandre et d’Arius, d’Athanase et d’Eusèbe, pour savoir si Jésus était précisément de la même substance que Dieu, ou d’une substance semblable à Dieu.
Chapitre XXXI. Arianisme et athanasianisme.
Qu’un Juif nommé Jésus ait été semblable à Dieu, ou consubstantiel à Dieu, cela est également absurde et impie.
Qu’il y ait trois personnes dans une substance, cela est également absurde.
Qu’il y ait trois dieux dans un dieu, cela est également absurde.
Rien de tout cela n’était un système chrétien, puisque rien de toute cette doctrine ne se trouve dans aucun Évangile, seul fondement reconnu du christianisme. Ce ne fut que quand on voulut platoniser qu’on se perdit dans ces idées chimériques. Plus le christianisme s’étendit, plus ses docteurs se fatiguèrent à le rendre incompréhensible. Les subtilités sauvèrent ce que le fond avait de bas et de grossier.
Mais à quoi servent toutes ces imaginations métaphysiques ? Qu’importe à la société humaine, aux mœurs, aux devoirs, qu’il y ait en Dieu une personne ou trois ou quatre mille ? En sera-t-on plus homme de bien pour prononcer des mots qu’on n’entend pas ? La religion, qui est la soumission à la Providence, et l’amour de la vertu, a-t-elle donc besoin de devenir ridicule pour être embrassée ?
Il y avait déjà longtemps qu’on disputait sur la nature du Logos, du verbe inconnu, quand Alexandre, pape d’Alexandrie, souleva contre lui l’esprit de plusieurs papes, en prêchant que la Trinité était une monade. Au reste, ce nom de pape était donné indistinctement alors aux évêques et aux prêtres. Alexandre était évêque ; le prêtre Arius se mit à la tête des mécontents : il se forma deux partis violents ; et la question ayant bientôt changé d’objet, comme il arrive souvent, Arius soutint que Jésus avait été créé, et Alexandre qu’il avait été engendré.
Cette dispute creuse ressemblait assez à celle qui a divisé depuis Constantinople, pour savoir si la lumière que les moines voyaient à leur nombril était celle du Thabor, et si la lumière du Thabor et de leur nombril était créée ou éternelle.
Il ne fut plus question de trois hypostases entre les disputants. Le Père et le Fils occupèrent les esprits, et le Saint-Esprit fut négligé.
Alexandre fit excommunier Arius par son parti. Eusèbe, évêque de Nicomédie, protecteur d’Arius, assembla un petit concile où l’on déclara erronée la doctrine qui est aujourd’hui l’orthodoxe ; la querelle devint violente ; l’évêque Alexandre, et le diacre Athanase, qui se signalait déjà par son inflexibilité et par ses intrigues, remuèrent toute l’Égypte. L’empereur Constantin était despotique et dur ; mais il avait du bon sens : il sentit tout le ridicule de la dispute.
On connaît assez cette fameuse lettre qu’il fit porter par Osius aux chefs des deux factions. « Ces questions, dit-il, ne viennent que de votre oisiveté curieuse ; vous êtes divisés pour un sujet bien mince. Cette conduite est basse et puérile, indigne d’hommes sensés. » La lettre les exhortait à la paix ; mais il ne connaissait pas encore les théologiens.
Le vieil Osius conseilla à l’empereur d’assembler un concile nombreux. Constantin, qui aimait l’éclat et le faste, convoqua l’assemblée à Nicée. Il y parut comme en triomphe avec la robe impériale, la couronne en tête, et couvert de pierreries. Osius y présida comme le plus ancien des évêques. Les écrivains de la secte papiste ont prétendu depuis que cet Osius n’avait présidé qu’au nom du pape de Rome Silvestre. Cet insigne mensonge, qui doit être placé à côté de la donation de Constantin, est assez confondu par les noms des députés de Silvestre, Titus et Vincent, chargés de sa procuration. Les papes romains étaient à la vérité regardés comme les évêques de la ville impériale, et comme les métropolitains des villes suburbicaires dans la province de Rome ; mais ils étaient bien loin d’avoir aucune autorité sur les évêques de l’Orient et de l’Afrique.
Le concile, à la plus grande pluralité des voix, dressa un formulaire dans lequel le nom de Trinité n’est pas seulement prononcé. « Nous croyons en un seul Dieu et en un seul Seigneur Jésus-Christ, fils unique de Dieu, engendré du Père, et non fait consubstantiel au Père. » Après ces mots inexplicables, on met, par surérogation : « Nous croyons aussi au Saint-Esprit, » sans dire ce que c’est que ce Saint-Esprit, s’il est engendré, s’il est fait, s’il est créé, s’il procède, s’il est consubstantiel. Ensuite on ajoute : « Anathème à ceux qui disent qu’il y a eu un temps où le Fils n’était pas. »
Mais ce qu’il y eut de plus plaisant au concile de Nicée, ce fut la décision sur quelques livres canoniques. Les Pères étaient fort embarrassés sur le choix des Évangiles et des autres écrits. On prit le parti de les entasser tous sur un autel, et de prier le Saint-Esprit de jeter à terre tous ceux qui n’étaient pas légitimes. Le Saint-Esprit ne manqua pas d’exaucer sur-le-champ la requête de Pères[1]. Une centaine de volumes tombèrent d’eux-mêmes sous l’autel ; c’est un moyen infaillible de connaître la vérité, et c’est ce qui est rapporté dans l’Appendix des actes de ce concile : c’est un des faits de l’histoire ecclésiastique les mieux avérés.
Notre savant et sage Middleton a découvert une chronique d’Alexandrie, écrite par deux patriarches d’Égypte, dans laquelle il est dit que non-seulement dix-sept évêques, mais encore deux mille prêtres, protestèrent contre la décision du concile.
Les évêques vainqueurs obtinrent de Constantin qu’il exilât Arius et trois ou quatre évêques vaincus ; mais ensuite Athanase ayant été élu évêque d’Alexandrie, et ayant trop abusé du crédit de sa place, les évêques et Arius exilés furent rappelés, et Athanase exilé à son tour. De deux choses l’une, ou les deux partis avaient également tort, ou Constantin était très-injuste. Le fait est que les disputeurs de ce temps-là étaient des cabaleurs comme ceux de ce temps-ci, et que les princes du ive siècle ressemblaient à ceux du nôtre, qui n’entendent rien à la matière, ni eux, ni leurs ministres, et qui exilent à tort et à travers. Heureusement nous avons ôté à nos rois le pouvoir d’exiler ; et si nous n’avons pu guérir dans nos prêtres la rage de cabaler, nous avons rendu cette rage inutile.
Il y eut un concile à Tyr, où Arius fut réhabilité, et Athanase condamné. Eusèbe de Nicomédie allait faire entrer pompeusement son ami Arius dans l’église de Constantinople ; mais un saint catholique, nommé Macaire, pria Dieu avec tant de ferveur et de larmes de faire mourir Arius d’apoplexie que Dieu, qui est bon, l’exauça. Ils disent que tous les boyaux d’Arius lui sortirent par le fondement ; cela est difficile : ces gens-là n’étaient pas anatomistes. Mais saint Macaire ayant oublié de demander la paix de l’Église chrétienne, Dieu ne la donna jamais. Constantin, quelque temps après, mourut entre les bras d’un prêtre arien ; apparemment que saint Macaire avait encore oublié de prier Dieu pour le salut de Constantin.
Chapitre XXXII. Des enfants de Constantin, et de Julien le philosophe, surnommé l’apostat par les chrétiens.
Les enfants de Constantin furent aussi chrétiens, aussi ambitieux, et aussi cruels que leur père ; ils étaient trois qui partagèrent l’empire, Constantin II, Constantius, et Constant. L’empereur Constantin Ier avait laissé un frère, nommé Jule, et deux neveux, auxquels il avait donné quelques terres. On commença par égorger le père, pour arrondir la part des nouveaux empereurs. Ils furent d’abord unis par le crime, et bientôt désunis. Constant fit assassiner Constantin, son frère aîné, et il fut ensuite tué lui-même.
Constantius, demeuré seul maître de l’empire, avait exterminé presque tout le reste de la famille impériale. Ce Jule, qu’il avait fait mourir, laissait deux enfants, l’un nommé Gallus, et l’autre le célèbre Julien. On tua Gallus, et on épargna Julien, parce qu’ayant du goût pour la retraite et pour l’étude on jugea qu’il ne serait jamais dangereux.
S’il est quelque chose de vrai dans l’histoire, il est vrai que ces deux premiers empereurs chrétiens, Constantin, et Constantius son fils, furent des monstres de despotisme et de cruauté. Il se peut, comme nous l’avons déjà insinué, que, dans le fond de leur cœur, ils ne crussent aucun Dieu ; et que, se moquant également des superstitions païennes et du fanatisme chrétien, ils se persuadassent malheureusement que la Divinité n’existe pas, parce que ni Jupiter le Crétois, ni Hercule le Thébain, ni Jésus le Juif, ne sont des dieux.
Il est possible aussi que des tyrans, qui joignent presque toujours la lâcheté à la barbarie, aient été séduits et encouragés au crime par la croyance où étaient alors tous les chrétiens sans exception que trois immersions dans une cuve d’eau avant la mort effaçaient tous les forfaits, et tenaient lieu de toutes les vertus. Cette malheureuse croyance a été plus funeste au genre humain que les passions les plus noires.
Quoi qu’il en soit, Constantius se déclara orthodoxe, c’est-à-dire arien, car l’arianisme prévalait alors dans tout l’Orient contre la secte d’Athanase ; et les ariens, auparavant persécutés, étaient dans ce temps-là persécuteurs.
Athanase fut condamné dans un concile de Sardique, dans un autre tenu dans la ville d’Arles, dans un troisième tenu à Milan : il parcourait tout l’empire romain, tantôt suivi de ses partisans, tantôt exilé, tantôt rappelé. Le trouble était dans toutes les villes pour ce seul mot consubstantiel. C’était un fléau que jamais on n’avait connu jusque-là dans l’histoire du monde. L’ancienne religion de l’empire, qui subsistait encore avec quelque splendeur, tirait de toutes ces divisions un grand avantage contre le christianisme.
Cependant Julien, dont Constantius avait assassiné le frère et toute la famille, fut obligé d’embrasser à l’extérieur le christianisme, comme notre reine Élisabeth fut quelque temps forcée de dissimuler sa religion sous le règne tyrannique de notre infâme Marie, et comme, en France, Charles IX força le grand Henri IV d’aller à la messe après la Saint-Barthélemy. Julien était stoïcien, de cette secte ensemble philosophique et religieuse qui produisit tant de grands hommes, et qui n’en eut jamais un méchant, secte plus divine qu’humaine, dans laquelle on voit la sévérité des brachmanes et de quelques moines, sans qu’elle en eût la superstition : la secte enfin des Caton, des Marc-Aurèle, et des Épictète.
Ce fut une chose honteuse et déplorable que ce grand homme se vît réduit à cacher tous ses talents sous Constantius, comme le premier des Brutus sous Tarquin. Il feignit d’être chrétien et presque imbécile pour sauver sa vie. Il fut même forcé d’embrasser quelque temps la vie monastique. Enfin Constantius, qui n’avait point d’enfants, déclara Julien césar ; mais il l’envoya dans les Gaules comme dans une espèce d’exil ; il y était presque sans troupes et sans argent, environné de surveillants, et presque sans autorité.
Différents peuples de la Germanie passaient souvent le Rhin et venaient ravager les Gaules, comme ils avaient fait avant César, et comme ils firent souvent depuis, jusqu’à ce qu’enfin ils les envahirent, et que la seule petite nation des Francs subjugua sans peine toutes ces provinces.
Julien forma des troupes, les disciplina, s’en fit aimer ; il les conduisit jusqu’à Strasbourg, passa le Rhin sur un pont de bateaux, et, à la tête d’une armée très-faible en nombre, mais animée de son courage, il défit une multitude prodigieuse de barbares, prit leur chef prisonnier, les poursuivit jusqu’à la forêt Hercynienne, se fit rendre tous les captifs romains et gaulois, toutes les dépouilles qu’avaient prises les barbares, et leur imposa des tributs.
À cette conduite de César il joignit les vertus de Titus et de Trajan, faisant venir de tous côtés du blé pour nourrir des peuples dans des campagnes dévastées, faisant défricher ces campagnes, rebâtissant les villes, encourageant la population, les arts et les talents par des priviléges, s’oubliant lui-même, et travaillant jour et nuit au bonheur des hommes.
Constantius, pour récompense, voulut lui ôter les Gaules, où il était trop aimé ; il lui demanda d’abord deux légions que lui-même avait formées. L’armée, indignée, s’y opposa : elle proclama Julien empereur malgré lui. La terre fut alors délivrée de Constantius, lorsqu’il allait marcher contre les Perses.
Julien le stoïcien, si sottement nommé l’Apostat par des prêtres, fut reconnu unanimement empereur par tous les peuples de l’Orient et de l’Occident.
La force de la vérité est telle que les historiens chrétiens sont obligés d’avouer qu’il vécut sur le trône comme il avait fait dans les Gaules. Jamais sa philosophie ne se démentit. Il commença par réformer dans le palais de Constantinople le luxe de Constantin et de Constantius. Les empereurs, à leur couronnement, recevaient de pesantes couronnes d’or de toutes les villes ; il réduisit presque à rien ces présents onéreux. La frugale simplicité du philosophe n’ôta rien à la majesté et à la justice du souverain. Tous les abus et tous les brigandages de. la cour furent réformés ; mais il n’y eut que deux concussionnaires publics d’exécutés à mort.
Il renonça, il est vrai, à son baptême ; mais il ne renonça jamais à la vertu. On lui reproche de la superstition : donc au moins, par ce reproche, on avoue qu’il avait de la religion. Pourquoi n’aurait-il pas choisi celle de l’empire romain ? pourquoi aurait-il été coupable de se conformer à celle des Scipion et des César plutôt qu’à celle des Grégoire de Nazianze et des Théodoret ? Le paganisme et le christianisme partageaient l’empire. Il donna la préférence à la secte de ses pères, et il avait grande raison en politique, puisque, sous l’ancienne religion, Rome avait triomphé de la moitié de la terre, et que, sous la nouvelle, tout tombait en décadence.
Loin de persécuter les chrétiens, il voulut apaiser leurs indignes querelles. Je ne veux pour preuve que sa cinquante-deuxième lettre. « Sous mon prédécesseur plusieurs chrétiens ont été chassés, emprisonnés, persécutés ; on a égorgé une grande multitude de ceux qu’on nomme hérétiques, à Samosate, en Paphlagonie, en Bithynie, en Galatie, en plusieurs autres provinces ; on a pillé, on a ruiné des villes. Sous mon règne, au contraire, les bannis ont été rappelés, les biens confisqués ont été rendus. Cependant ils sont venus à ce point de fureur qu’ils se plaignent de ce qu’il ne leur est plus permis d’être cruels, et de se tyranniser les uns les autres. »
Cette seule lettre ne suffirait-elle pas pour confondre les calomnies dont les prêtres chrétiens l’accablèrent ?
Il y avait dans Alexandrie un évêque nommé George, le plus séditieux et le plus emporté des chrétiens ; il se faisait suivre par des satellites ; il battait les païens de ses mains ; il démolissait leurs temples. Le peuple d’Alexandrie le tua. Voici comment Julien parle aux Alexandrins dans son épître dixième :
« Quoi ! au lieu de me réserver la connaissance de vos outrages, vous vous êtes laissé emporter à la colère ! vous vous êtes livrés aux mêmes excès que vous reprochez à vos ennemis ! George méritait d’être traité ainsi, mais ce n’était pas à vous d’être ses exécuteurs. Vous avez des lois, il fallait demander justice, etc. »
Je ne prétends point répéter ici et réfuter tout ce qui est écrit dans l’Histoire ecclésiastique, que l’esprit de parti et de faction a toujours dictée. Je passe à la mort de Julien, qui vécut trop peu pour la gloire et pour le bonheur de l’empire. Il fut tué au milieu de ses victoires contre les Perses, après avoir passé le Tigre et l’Euphrate, à l’âge de trente et un ans, et mourut comme il avait vécu, avec la résignation d’un stoïcien, remerciant l’Être des êtres, qui allait rejoindre son âme à l’âme universelle et divine.
On est saisi d’indignation quand on lit dans Grégoire de Nazianze et dans Théodoret que Julien jeta tout son sang vers le ciel en disant : Galiléen, tu as vaincu. Quelle misère ! quelle absurdité ! Julien combattait-il contre Jésus ? et Jésus était-il le Dieu des Perses ?
On ne peut lire sans horreur les discours que le fougueux Grégoire de Nazianze prononça contre lui après sa mort. Il est vrai que, si Julien avait vécu, le christianisme courait risque d’être aboli. Certainement Julien était un plus grand homme que Mahomet, qui a détruit la secte chrétienne dans toute l’Asie et dans toute l’Afrique ; mais tout cède à la destinée, et un Arabe sans lettres a écrasé la secte d’un Juif sans lettres, ce qu’un grand empereur et un philosophe n’a pu faire. Mais c’est que Mahomet vécut assez, et Julien trop peu.
Les christicoles ont osé dire que Julien n’avait vécu que trente et un ans, en punition de son impiété ; et ils ne songent pas que leur prétendu Dieu n’a pas vécu davantage.
Chapitre XXXIII. Considérations sur Julien.
Julien, stoïcien de pratique, et d’une vertu supérieure à celle de sa secte même, était platonicien de théorie : son esprit sublime avait embrassé la sublime idée de Platon, prise des anciens Chaldéens, que Dieu existant de toute éternité avait créé des êtres de toute éternité. Ce Dieu immuable, pur, immortel, ne put former que des êtres semblables à lui, des images de sa splendeur, auxquels il ordonna de créer les substances mortelles : ainsi Dieu fit les dieux, et les dieux firent les hommes.
Ce magnifique système n’était pas prouvé ; mais une telle imagination vaut sans doute mieux qu’un jardin dans lequel on a établi les sources du Nil et de l’Euphrate, qui sont à huit cents grandes lieues l’une de l’autre ; un arbre qui donne la connaissance du bien et du mal ; une femme tirée de la côte d’un homme ; un serpent qui parle, un chérubin qui garde la porte ; et toutes les dégoûtantes rêveries dont la grossièreté juive a farci cette fable, empruntée des Phéniciens. Aussi faut-il, voir, dans Cyrille, avec quelle éloquence Julien confondit ces absurdités. Cyrille eut assez d’orgueil pour rapporter les raisons de Julien, et pour croire lui répondre.
Julien daigne faire voir combien il répugne à la nature de Dieu d’avoir mis dans le jardin d’Éden des fruits qui donnaient la connaissance du bien et du mal, et d’avoir défendu d’en manger. Il fallait, au contraire, comme nous l’avons déjà remarqué, recommander à l’homme de se nourrir de ce fruit nécessaire. La distinction du bien et du mal, du juste et de l’injuste, était le lait dont Dieu devait nourrir des créatures sorties de ses mains. Il aurait mieux valu leur crever les deux yeux que leur boucher l’entendement.
Si le rédacteur de ce roman asiatique de la Genèse avait eu la moindre étincelle d’esprit, il aurait supposé deux arbres dans le paradis : les fruits de l’un nourrissaient l’âme, et faisaient connaître et aimer la justice ; les fruits de l’autre enflammaient le cœur de passions funestes. L’homme négligea l’arbre de la science, et s’attacha à celui de la cupidité.
Voilà du moins une allégorie juste, une image sensible du fréquent abus que les hommes font de leur raison. Je m’étonne que Julien ne l’ait pas proposée ; mais il dédaignait trop ce livre pour descendre à le corriger.
C’est avec très-grande raison que Julien méprise ce fameux Décalogue que les Juifs regardaient comme un code divin : c’était, en effet, une plaisante législation, en comparaison des lois romaines, de défendre le vol, l’adultère et l’homicide. Chez quel peuple barbare la nature n’a-t-elle pas dicté ces lois avec beaucoup plus d’étendue ? Quelle pitié de faire descendre Dieu au milieu des éclairs et des tonnerres, sur une petite montagne pelée, pour enseigner qu’il ne faut pas être voleur ! encore peut-on dire que ce n’était pas à ce Dieu qui avait ordonné aux Juifs de voler les Égyptiens, et qui leur proposait l’usure avec les étrangers comme leur plus digne récompense, et qui avait récompensé le voleur Jacob ; que ce n’était pas, dis-je, à ce Dieu, de défendre le larcin.
C’est avec beaucoup de sagacité que ce digne empereur détruit les prétendues prophéties juives, sur lesquelles les christicoles appuyaient leurs rêveries, et la verge de Juda qui ne manquerait point entre les jambes, et la fille ou la femme qui fera un enfant, et surtout ces paroles attribuées à Moïse, lesquelles regardent Josué, et qu’on applique si mal à propos à Jésus : « Dieu vous suscitera un prophète semblable à moi. » Certainement un prophète semblable à Moïse ne veut pas dire Dieu et fils de Dieu. Rien n’est si palpable, rien n’est si fort à la portée des esprits les plus grossiers.
Mais Julien croyait, ou feignait de croire, par politique, aux divinations, aux augures, à l’efficacité des sacrifices : car enfin les peuples n’étaient pas philosophes ; il fallait opter entre la démence des christicoles et celle des païens.
Je pense que si ce grand homme eût vécu, il eût, avec le temps, dégagé la religion des superstitions les plus grossières, et qu’il eût accoutumé les Romains à reconnaître un Dieu formateur des dieux et des hommes, et à lui adresser tous les hommages.
Mais Cyrille et Grégoire, et les autres prêtres chrétiens, profitèrent de la nécessité où il semblait être de professer publiquement la religion païenne, pour le décrier chez les fanatiques. Les ariens et les athanasiens se réunirent contre lui, et le plus grand homme qui peut-être ait jamais été devint inutile au monde.
Chapitre XXXIV. Des chrétiens jusqu’à Théodose.
Après la mort de Julien, les ariens et les athanasiens, dont il avait réprimé la fureur, recommencèrent à troubler tout l’empire. Les évêques des deux partis ne furent plus que des chefs de séditieux. Des moines fanatiques sortirent des déserts de la Thébaïde pour souffler le feu de la discorde, ne parlant que de miracles extravagants, tels qu’on les trouve dans l’histoire des papas du désert ; insultant les empereurs, et montrant de loin ce que devaient être un jour des moines.
Il y eut un empereur sage qui, pour éteindre, s’il se pouvait, toutes ces querelles, donna une liberté entière de conscience, et la prit pour lui-même : ce fut Valentinien Ier. De son temps, toutes les sectes vécurent au moins quelques années dans une paix extérieure, se bornant à s’anathématiser sans s’égorger ; païens, juifs, athanasiens, ariens, macédoniens, donatistes, cyprianistes manichéens, apollinaristes, tous furent étonnés de leur tranquillité. Valentinien apprit à tous ceux qui sont nés pour gouverner que si deux sectes déchirent un État, trente sectes tolérées laissent l’État en repos.
Théodose ne pensa pas ainsi, et fut sur le point de tout perdre : il fut le premier qui prit parti pour les athanasiens, et il fit renaître la discorde par son intolérance. Il persécuta les païens et les aliéna. Il se crut alors obligé de donner lâchement des provinces entières aux Goths, sur la rive droite du Danube ; et par cette malheureuse précaution, prise contre ses peuples, il prépara la chute de l’empire romain.
Les évêques, à l’imitation de l’empereur, s’abandonnèrent à la fureur de la persécution. Il y avait un tyran qui, ayant détrôné et assassiné un collègue de Théodose, nommé Gratien, s’était rendu maître de l’Angleterre, des Gaules et de l’Espagne. Je ne sais quel Priscillien en Espagne, ayant dogmatisé comme tant d’autres, et ayant dit que les âmes étaient des émanations de Dieu, quelques évêques espagnols, qui ne savaient pas plus que Priscillien d’où venaient les âmes, le déférèrent, lui et ses principaux sectateurs, au tyran Maxime. Ce monstre, pour faire sa cour aux évêques, dont il avait besoin pour se maintenir dans son usurpation, fit condamner à mort Priscillien et sept de ses partisans. Un évêque, nommé Itace, fut assez barbare pour leur faire donner la question en sa présence. Le peuple, toujours sot et toujours cruel quand on lâche la bride à sa superstition, assomma, dans Bordeaux, à coups de pierres, une femme de qualité qu’on disait être priscillianiste.
Ce jugement de Priscillien est plus avéré que celui de tous les martyrs, dont les chrétiens avaient fait tant de bruit sous les premiers empereurs. Les malheureux croyaient plaire à Dieu en se souillant des crimes dont ils s’étaient plaints. Les chrétiens, depuis ce temps, furent comme des chiens qu’on avait mis en curée : ils furent avides de carnage, non pas en défendant l’empire, qu’ils laissèrent envahir par vingt nations barbares, mais en persécutant tantôt les sectateurs de l’antique religion romaine, et tantôt leurs frères qui ne pensaient pas comme eux.
Y a-t-il rien de plus horrible et de plus lâche que l’action des prêtres de l’évêque Cyrille, que les chrétiens appellent saint Cyrille ? Il y avait dans Alexandrie une fille célèbre par sa beauté et par son esprit ; son nom était Hypatie. Élevée par le philosophe Théon, son père, elle occupait, en 415, la chaire qu’il avait eue, et fut applaudie pour sa science autant qu’honorée pour ses mœurs ; mais elle était païenne. Les dogues tonsurés de Cyrille, suivis d’une troupe de fanatiques, l’assaillirent dans la rue lorsqu’elle revenait de dicter ses leçons, la traînèrent par les cheveux, la lapidèrent et la brûlèrent, sans que Cyrille le saint leur fît la plus légère réprimande, et sans que Théodose le jeune et la dévote Pulchérie, sa sœur, qui le gouvernait et partageait l’empire avec lui, condamnassent cet excès d’inhumanité. Un tel mépris des lois en cette circonstance eût paru moins étonnant sous le règne de leur aïeul Théodose Ier, qui s’était souillé si lâchement du sang des peuples de Thessalonique[1].
Chapitre XXXV. Des sectes et des malheurs des chrétiens jusqu’à l’établissement du mahométisme.
Les disputes, les anathèmes, les persécutions, ne cessèrent d’inonder l’Église chrétienne. Ce n’était pas assez d’avoir uni dans Jésus la nature divine avec la nature humaine : on s’avisa d’agiter la question si Marie était mère de Dieu. Ce titre de mère de Dieu parut un blasphème à Nestorius, évêque de Constantinople. Son sentiment était le plus probable ; mais, comme il avait été persécuteur, il trouva des évêques qui le persécutèrent. On le chassa de son siége au concile d’Éphèse ; mais aussi trente évêques de ce même concile déposèrent ce saint Cyrille, l’ennemi mortel de Nestorius ; et tout l’Orient fut partagé.
Ce n’était pas assez ; il fallut savoir précisément si ce Jésus avait eu deux natures, deux personnes, deux âmes, deux volontés ; si, quand il faisait les fonctions animales de l’homme, la partie divine s’en mêlait ou ne s’en mêlait pas. Toutes ces questions ne méritaient d’être traitées que par Rabelais, ou par notre cher doyen Swift, ou par Punch[1]. Cela fit trois partis dans l’empire par le fanatisme d’un Eutychès, misérable moine ennemi de Nestorius, et combattu par d’autres moines. On voyait, dans toutes ces disputes, monastères opposés à monastères, dévotes à dévotes, eunuques à eunuques, conciles à conciles, et souvent empereurs à empereurs.
Pendant que les descendants des Camille, des Brutus, des Scipion, des Caton, mêlés aux Grecs et aux barbares, barbotaient ainsi dans la fange de la théologie, et que l’esprit de vertige était répandu sur la face de l’empire romain, des brigands du Nord, qui ne savaient que combattre, vinrent démembrer ce grand colosse devenu faible et ridicule,
Quand ils eurent vaincu, il fallut gouverner des peuples fanatiques ; il fallut prendre leur religion, et mener ces bêtes de somme par les licous qu’elles s’étaient faits elles-mêmes.
Les évêques de chaque secte tâchèrent de séduire leurs vainqueurs ; ainsi les princes ostrogoths, visigoths et bourguignons, se firent ariens ; les princes francs furent athanasiens[2].
L’empire romain d’Occident détruit fut partagé en provinces ruisselantes de sang, qui continuèrent à s’anathématiser avec une sainteté réciproque. Il y eut autant de confusion et une abjection aussi misérable dans la religion que dans l’empire.
Les méprisables empereurs de Constantinople affectèrent de prétendre toujours sur l’Italie, et sur les autres provinces qu’ils n’avaient plus, les droits qu’ils croyaient avoir. Mais au viie siècle il s’éleva une religion nouvelle qui ruina bientôt les sectes chrétiennes dans l’Asie, dans l’Afrique, et dans une grande partie de l’Europe.
Le mahométisme était sans doute plus sensé que le christianisme. On n’y adorait point un Juif en abhorrant les Juifs ; on n’y appelait point une Juive mère de Dieu ; on n’y tombait point dans le blasphème extravagant de dire que trois dieux font un dieu ; enfin on n’y mangeait pas ce dieu qu’on adorait, et on n’allait pas rendre à la selle son créateur. Croire un seul Dieu tout-puissant était le seul dogme, et si on n’y avait pas ajouté que Mahomet est son prophète, c’eût été une religion aussi pure, aussi belle que celle des lettrés chinois. C’était le simple théisme, la religion naturelle, et par conséquent la seule véritable. Mais on peut dire que les musulmans étaient en quelque sorte excusables d’appeler Mahomet l’organe de Dieu, puisque en effet il avait enseigné aux Arabes qu’il n’y a qu’un Dieu.
Les musulmans, par les armes et par la parole, firent taire le christianisme jusqu’aux portes de Constantinople ; et les chrétiens, resserrés dans quelques provinces d’Occident, continuèrent à disputer et à se déchirer.
Chapitre XXXVI. Discours sommaire des usurpations papales[1].
Ce fut un état bien déplorable que celui où l’inondation des barbares réduisit l’Europe. Il n’y eut que le temps de Théodoric et de Charlemagne qui fut signalé par quelques bonnes lois ; encore Charlemagne, moitié Franc, moitié Germain, exerça des barbaries dont aucun souverain n’oserait se souiller aujourd’hui. Il n’y a que de lâches écrivains de la secte romaine qui puissent louer ce prince d’avoir égorgé la moitié des Saxons pour convertir l’autre.
Les évêques de Rome, dans la décadence de la famille de Charlemagne, commencèrent à tenter de s’attribuer un pouvoir souverain, et de ressembler aux califes, qui réunissaient les droits du trône et de l’autel. Les divisions des princes et l’ignorance des peuples favorisèrent bientôt leur entreprise. L’évêque de Rome Grégoire VII fut celui qui étala ces desseins audacieux avec le plus d’insolence. Heureusement pour nous, Guillaume de Normandie, qui avait usurpé notre trône, ne distinguant plus la gloire de notre nation de la sienne propre, réprima l’insolence de Grégoire VII, et empêcha quelque temps que nous ne payassions le denier de saint Pierre, que nous avions donné d’abord comme une aumône, et que les évêques de Rome exigeaient comme un tribut.
Tous nos rois n’eurent pas la même fermeté, et lorsque les papes, si peu puissants par leur petit territoire, devinrent les maîtres de l’Europe par les croisades et par les moines ; lorsqu’ils eurent déposé tant d’empereurs et de rois, et qu’ils eurent fait de la religion une arme terrible qui perçait tous les souverains, notre île vit le misérable roi Jean sans Terre se déclarer à genoux vassal du pape, faire serment de fidélité aux pieds du légat Pandolfe, s’obliger, lui et ses successeurs, à payer aux évêques de Rome un tribut annuel de mille marcs[2] : ce qui faisait presque le revenu de la couronne. Comme un de mes ancêtres eut le malheur de signer ce traité, le plus infâme des traités, je dois en parler avec plus d’horreur qu’un autre : c’est une amende honorable que je dois à la dignité de la nature humaine avilie.
Chapitre XXXVII. De l’excès épouvantable des persécutions chrétiennes.
Il ne faut pas douter que les nouveaux dogmes inventés chaque jour ne contribuassent beaucoup à fortifier les usurpations des papes. Le hocus pocus[1], ou la transsubstantiation, dont le nom seul est ridicule, s’établit peu à peu, après avoir été inconnu aux premiers siècles du christianisme. On peut se figurer quelle vénération s’attirait un prêtre, un moine, qui faisait un dieu avec quatre paroles, et non-seulement un dieu, mais autant de dieux qu’il voulait : avec quel respect voisin de l’adoration ne devait-on pas regarder celui qui s’était rendu le maître absolu de tous ces faiseurs de dieux ? Il était le souverain des prêtres, il l’était des rois ; il était dieu lui-même, et à Rome encore, quand le pape officie, on dit : Le vénérable porte le vénérable.
Cependant, au milieu de cette fange dans laquelle l’espèce humaine était plongée en Europe, il s’éleva toujours des hommes qui protestèrent contre ces nouveautés : ils savaient que, dans les premiers siècles de l’Église, on n’avait jamais prétendu changer du pain en dieu dans le souper du Seigneur ; que la cène faite par Jésus avait été un agneau cuit avec des laitues, que cela ne ressemblait nullement à la communion de la messe ; que les premiers chrétiens avaient eu les images en horreur ; que même encore sous Charlemagne, le fameux concile de Francfort les avait proscrites.
Plusieurs autres articles les révoltaient ; ils osaient même douter quelquefois que le pape, tout dieu qu’il était, pût de droit divin déposer un roi pour avoir épousé sa commère ou sa parente au septième degré. Ils rejetaient donc secrètement quelques points de la créance chrétienne, et ils en admettaient d’autres non moins absurdes : semblables aux animaux, qu’on prétendit autrefois être formés du limon du Nil, et qui avaient la vie dans une partie de leur corps, tandis que l’autre n’était encore que de la boue.
Mais quand ils voulurent parler, comment furent-ils traités ? On avait, dans l’Orient, employé dix siècles de persécutions à exterminer les manichéens, et sous la régence d’une impératrice Théodora, dévote et barbare[2], on en avait fait périr plus de cent mille dans les supplices. Les Occidentaux, entendant confusément parler de ces boucheries, s’accoutumèrent à nommer manichéens tous ceux qui combattaient quelques dogmes de l’Église papiste, et à les poursuivre avec la même barbarie. C’est ainsi qu’un Robert de France fit brûler à ses yeux le confesseur de sa femme et plusieurs prêtres.
Quand les Vaudois et les Albigeois parurent, on les appela manichéens, pour les rendre plus odieux.
Qui ne connaît les cruautés horribles exercées dans les provinces méridionales de France, contre ces malheureux dont le crime était de nier qu’on pût faire Dieu avec des paroles ?
Lorsque ensuite les disciples de notre Wiclef, de Jean Hus, et enfin ceux de Luther et de Zuingle, voulurent secouer le joug papal, on sait que l’Europe presque entière fut bientôt partagée en deux espèces, l’une de bourreaux, et l’autre de suppliciés. Les réformés firent ensuite ce qu’avaient fait les chrétiens des ive et ve siècles : après avoir été persécutés, ils devinrent persécuteurs à leur tour. Si on voulait compter les guerres civiles que les disputes sur le christianisme ont excitées, on verrait qu’il y en a plus de cent. Notre Grande-Bretagne a été saccagée : les massacres d’Irlande sont comparables à ceux de la Saint-Barthélemy, et je ne sais s’il y eut plus d’abominations commises, plus de sang répandu en France qu’en Irlande. La femme de Sir Henri Spotswood[3], sœur de ma bisaïeule, fut égorgée avec deux de ses filles. Ainsi, dans cet examen, j’ai toujours à venger le genre humain et moi-même.
Que dirai-je du tribunal de l’Inquisition, qui subsiste encore ? Les sacrifices de sang humain qu’on reproche aux anciennes nations ont été plus rares que ceux dont les Espagnols et les Portugais se sont souillés dans leurs actes de foi.
Est-il quelqu’un maintenant qui veuille comparer ce long amas de destruction et de carnage au martyre de sainte Potamienne, de sainte Barbe, de saint Pionius, et de saint Eustache ? Nous avons nagé dans le sang comme des tigres acharnés pendant des siècles, et nous osons flétrir les Trajan et les Antonins du nom de persécuteurs !
Il m’est arrivé quelquefois de représenter à des prêtres l’énormité de toutes ces désolations dont nos aïeux ont été les victimes : ils me répondaient froidement que c’était un bon arbre qui avait produit de mauvais fruits ; je leur disais que c’était un blasphème de prétendre qu’un arbre qui avait porté tant et de si horribles poisons a été planté des mains de Dieu même. En vérité, il n’y a point de prêtre qui ne doive baisser les yeux et rougir devant un honnête homme.
Chapitre XXXVIII. Excès de l’église romaine.
Ce n’est que dans l’Église romaine incorporée avec la férocité des descendants des Huns, des Goths, et des Vandales, qu’on voit cette série continue de scandales et de barbaries inconnues chez tous les prêtres des autres religions du monde.
Les prêtres ont partout abusé, parce qu’ils sont hommes. Il fut même, et il est encore chez les brames des fripons et des scélérats, quoique cette ancienne secte soit sans contredit la plus honnête de toutes. L’Église romaine l’a emporté en crimes sur toutes les sectes du monde, parce qu’elle a eu des richesses et du pouvoir.
Elle l’a emporté en débauches obscènes, parce que, pour mieux gouverner les hommes, elle s’est interdit le mariage, qui est le plus grand frein à l’impudicité vulgivague et à la pédérastie.
Je m’en tiens à ce que j’ai vu de mes yeux, et à ce qui s’est passé peu d’années avant ma naissance. Y eut-il jamais un brigand qui respectât moins la foi publique, le sang des hommes, et l’honneur des femmes, que ce Bernard Van Galen, évêque de Munster, qui se faisait soudoyer tantôt par les Hollandais contre ses voisins, tantôt par Louis XIV contre les Hollandais ? Il s’enivra de vin et de sang toute sa vie. Il passait du lit de ses concubines aux champs du meurtre, comme une bête en rut et carnassière. Le sot peuple cependant se mettait à genoux devant lui, et recevait humblement sa bénédiction.
J’ai vu un de ses bâtards, qui, malgré sa naissance, trouva le moyen d’être chanoine d’une collégiale ; il était plus méchant que son père, et beaucoup plus dissolu : je sais qu’il assassina une de ses maîtresses.
Je demande s’il n’est pas probable que l’évêque, marié à une Allemande femme de bien, et son fils, né en légitime mariage et bien élevé, auraient mené l’un et l’autre une vie moins abominable. Je demande s’il y a quelque chose au monde plus capable de modérer nos fureurs que les regards d’une épouse et d’une mère respectée, si les devoirs d’un père de famille n’ont pas étouffé mille crimes dans leur germe.
Combien d’assassinats commis par des prêtres n’ai-je pas vus en Italie, il n’y a pas quarante ans ? Je n’exagère point ; il y avait peu de jours où un prêtre corse n’allât, après avoir dit la messe, arquebuser son ennemi ou son rival derrière un buisson ; et quand l’assassiné respirait encore, le prêtre lui offrait de le confesser et de lui donner l’absolution. C’est ainsi que ceux que le pape Alexandre VI faisait égorger pour s’emparer de leur bien lui demandaient unam indulgentiam in articulo mortis.
Je lisais hier ce qui est rapporté dans nos histoires d’un évêque de Liége, du temps de notre Henri V. Cet évêque n’est appelé que Jean sans pitié. Il avait un prêtre qui lui servait de bourreau ; et après l’avoir employé à pendre, à rouer, à éventrer plus de deux mille personnes, il le fit pendre lui-même.
Que dirai-je de l’archevêque d’Upsal, nommé Troll, qui, de concert avec le roi de Danemark, Christian II, fit massacrer devant lui quatre-vingt-quatorze sénateurs, et livra la ville de Stockholm au pillage, une bulle du pape à la main ?
Il n’y a point d’État chrétien où les prêtres n’aient étalé des scènes à peu près semblables.
On me dira que je ne parle que des crimes ecclésiastiques, et que je passe sous silence ceux des séculiers. C’est que les abominations des prêtres, et surtout des prêtres papistes, font un plus grand contraste avec ce qu’ils enseignent au peuple ; c’est qu’ils joignent à la foule de leurs forfaits un crime non moins affreux, s’il est possible, celui de l’hypocrisie ; c’est que plus leurs mœurs doivent être pures, plus ils sont coupables. Ils insultent au genre humain ; ils persuadent à des imbéciles de s’enterrer vivants dans un monastère. Ils prêchent une vêture, ils administrent leurs huiles, et au sortir de là, ils vont se plonger dans la volupté ou dans le carnage : c’est ainsi que l’Église fut gouvernée depuis les fureurs d’Athanase et d’Arius jusqu’à nos jours.
Qu’on me parle avec la même bonne foi que je m’explique ; pense-t-on qu’il y ait eu un seul de ces monstres qui ait cru les dogmes impertinents qu’ils ont prêchés ? Y a-t-il eu un seul pape qui, pour peu qu’il ait eu de sens commun, ait cru l’incarnation de Dieu, la mort de Dieu, la résurrection de Dieu, la Trinité de Dieu, la transsubstantiation de la farine en Dieu, et toutes ces odieuses chimères qui ont mis les chrétiens au-dessous des brutes ? Certes ils n’en ont rien cru, et parce qu’ils ont senti l’horrible absurdité du christianisme ils se sont imaginé qu’il n’y a point de Dieu. C’est là l’origine de toutes les horreurs dont ils se sont souillés ; prenons-y garde, c’est l’absurdité des dogmes chrétiens qui fait les athées.
Conclusion.
Je conclus que tout homme sensé, tout homme de bien, doit avoir la secte chrétienne en horreur. Le grand nom de théiste, qu’on ne révère pas assez[1], est le seul nom qu’on doive prendre. Le seul Évangile qu’on doive lire, c’est le grand livre de la nature, écrit de la main de Dieu, et scellé de son cachet. La seule religion qu’on doive professer est celle d’adorer Dieu et d’être honnête homme. Il est aussi impossible que cette religion pure et éternelle produise du mal qu’il était impossible que le fanatisme chrétien n’en fît pas.
On ne pourra jamais faire dire à la religion naturelle : Je suis venue apporter, non pas la paix, mais le glaive. Au lieu que c’est la première confession de foi qu’on met dans la bouche du Juif qu’on a nommé le Christ.
Les hommes sont bien aveugles et bien malheureux de préférer une secte absurde, sanguinaire, soutenue par des bourreaux, et entourée de bûchers ; une secte qui ne peut être approuvée que par ceux à qui elle donne du pouvoir et des richesses ; une secte particulière qui n’est reçue que dans une petite partie du monde ; à une religion simple et universelle qui, de l’aveu même des christicoles, était la religion du genre humain du temps de Seth, d’Énoch, de Noé. Si la religion de leurs premiers patriarches est vraie, certes la secte de Jésus est fausse. Les souverains se sont soumis à cette secte, croyant qu’ils en seraient plus chers à leurs peuples, en se chargeant eux-mêmes du joug que leurs peuples portaient. Ils n’ont pas vu qu’ils se faisaient les premiers esclaves des prêtres, et ils n’ont pu encore parvenir dans la moitié de l’Europe à se rendre indépendants.
Et quel roi, je vous prie, quel magistrat, quel père de famille, n’aimera pas mieux être le maître chez lui que d’être l’esclave d’un prêtre ?
Quoi ! le nombre innombrable des citoyens molestés, excommuniés, réduits à la mendicité, égorgés, jetés à la voirie, le nombre des princes détrônés et assassinés, n’a pas encore ouvert les yeux des hommes ! Et si on les entr’ouvre, on n’a pas encore renversé cette idole funeste !
Que mettrons-nous à la place ? dites-vous. Quoi ! un animal féroce a sucé le sang de mes proches : je vous dis de vous défaire de cette bête, et vous me demandez ce qu’on mettra à sa place ! Vous me le demandez ! vous, cent fois plus odieux que les pontifes païens, qui se contentaient tranquillement de leurs cérémonies et de leurs sacrifices, qui ne prétendaient point enchaîner les esprits par des dogmes, qui ne disputèrent jamais aux magistrats leur puissance, qui n’introduisirent point la discorde chez les hommes. Vous avez le front de demander ce qu’il faut mettre à la place de vos fables ! Je vous réponds : Dieu, la vérité, la vertu, des lois, des peines, et des récompenses. Prêchez la probité, et non le dogme. Soyez les prêtres de Dieu, et non d’un homme.
Après avoir pesé devant Dieu le christianisme dans les balances de la vérité, il faut le peser dans celles de la politique. Telle est la misérable condition humaine que le vrai n’est pas toujours avantageux. Il y aurait du danger et peu de raison à vouloir faire tout d’un coup du christianisme ce qu’on a fait du papisme. Je tiens que, dans notre île, on doit laisser subsister la hiérarchie établie par un acte de parlement, en la soumettant toujours à la législation civile, et en l’empêchant de nuire. Il serait sans doute à désirer que l’idole fût renversée, et qu’on offrît à Dieu des hommages plus purs ; mais le peuple n’en est pas encore digne. Il suffit, pour le présent, que notre Église soit contenue dans ses bornes. Plus les laïques seront éclairés, moins les prêtres pourront faire de mal. Tâchons de les éclairer eux-mêmes, de les faire rougir de leurs erreurs, et de les amener peu à peu jusqu’à être citoyens[2].
Donatien Alphonse François de Sade: La Vérité
Quelle est cette chimère impuissante et stérile,
Cette divinité que prêche à l’imbécile
Un ramas odieux de prêtres imposteurs ?
Veulent-ils me placer parmi leurs sectateurs ?
Ah ! jamais, je le jure, et je tiendrai parole,
Jamais cette bizarre et dégoûtante idole,
Cet enfant de délire et de dérision
Ne fera sur mon cœur la moindre impression.
Content et glorieux de mon épicurisme,
Je prétends expirer au sein de l’athéisme
Et que l’infâme Dieu dont on veut m’alarmer
Ne soit conçu par moi que pour le blasphémer.
Oui, vaine illusion, mon âme te déteste,
Et pour t’en mieux convaincre ici je le proteste,
Je voudrais qu’un moment tu pusses exister
Pour jouir du plaisir de te mieux insulter.
Quel est-il en effet ce fantôme exécrable,
Ce jean-foutre de Dieu, cet être épouvantable
Que rien n’offre aux regards ni ne montre à l’esprit,
Que l’insensé redoute et dont le sage rit,
Que rien ne peint aux sens, que nul ne peut comprendre,
Dont le culte sauvage en tous temps fit répandre
Plus de sang que la guerre ou Thémis en courroux
Ne purent en mille ans en verser parmi nous ? [1]
J’ai beau l’analyser, ce gredin déifique,
J’ai beau l’étudier, mon œil philosophique
Ne voit dans ce motif de vos religions
Qu’un assemblage impur de contradictions
Qui cède à l’examen sitôt qu’on l’envisage,
Qu’on insulte à plaisir, qu’on brave, qu’on outrage,
Produit par la frayeur, enfanté par l’espoir, [2]
Que jamais notre esprit ne saurait concevoir,
Devenant tour à tour, aux mains de qui l’érige,
Un objet de terreur, de joie ou de vertige
Que l’adroit imposteur qui l’annonce aux humains
Fait régner comme il veut sur nos tristes destins,
Qu’il peint tantôt méchant et tantôt débonnaire,
Tantôt nous massacrant, ou nous servant de père,
En lui prêtant toujours, d’après ses passions,
Ses mœurs, son caractère et ses opinions :
Ou la main qui pardonne ou celle qui nous perce.
Le voilà, ce sot Dieu dont le prêtre nous berce.
Mais de quel droit celui que le mensonge astreint
Prétend-il me soumettre à l’erreur qui l’atteint ?
Ai-je besoin du Dieu que ma sagesse abjure
Pour me rendre raison des lois de la nature ?
En elle tout se meut, et son sein créateur
Agit à tout instant sans l’aide d’un moteur. [3]
A ce double embarras gagné-je quelque chose ?
Ce Dieu, de l’univers démontre-t-il la cause ?
S’il crée, il est créé, et me voilà toujours
Incertain, comme avant, d’adopter son recours.
Fuis, fuis loin de mon cœur, infernale imposture ;
Cède, en disparaissant, aux lois de la nature
Elle seule a tout fait, tu n’es que le néant
Dont sa main nous sortit un jour en nous créant.
Évanouis-toi donc, exécrable chimère !
Fuis loin de ces climats, abandonne la terre
Où tu ne verras plus que des cœurs endurcis
Au jargon mensonger de tes piteux amis !
Quant à moi, j’en conviens, l’horreur que je te porte
Est à la fois si juste, et si grande, et si forte,
Qu’avec plaisir, Dieu vil, avec tranquillité,
Que dis-je ? avec transport, même avec volupté,
Je serais ton bourreau, si ta frêle existence
Pouvait offrir un point à ma sombre vengeance,
Et mon bras avec charme irait jusqu’à ton cœur
De mon aversion te prouver la rigueur.
Mais ce serait en vain que l’on voudrait t’atteindre,
Et ton essence échappe à qui veut la contraindre.
Ne pouvant t’écraser, du moins, chez les mortels,
Je voudrais renverser tes dangereux autels
Et démontrer à ceux qu’un Dieu captive encore
Que ce lâche avorton que leur faiblesse adore
N’est pas fait pour poser un terme aux passions.
Ô mouvements sacrés, fières impressions,
Soyez à tout jamais l’objet de nos hommages,
Les seuls qu’on puisse offrir au culte des vrais sages,
Les seuls en tous les temps qui délectent leur cœur,
Les seuls que la nature offre à notre bonheur !
Cédons à leur empire, et que leur violence,
Subjuguant nos esprits sans nulle résistance,
Nous fasse impunément des lois de nos plaisirs
Ce que leur voix prescrit suffit à nos désirs. [4]
Quel que soit le désordre où leur organe entraîne,
Nous devons leur céder sans remords et sans peine,
Et, sans scruter nos lois ni consulter nos mœurs,
Nous livrer ardemment à toutes les erreurs
Que toujours par leurs mains nous dicta la nature.
Ne respectons jamais que son divin murmure ;
Ce que nos vaines lois frappent en tous pays
Est ce qui pour ses plans eut toujours plus de prix.
Ce qui paraît à l’homme une affreuse injustice
N’est sur nous que l’effet de sa main corruptrice,
Et quand, d’après nos mœurs, nous craignons de faillir,
Nous ne réussissons qu’à la mieux accueillir. [5]
Ces douces actions que vous nommez des crimes,
Ces excès que les sots croient illégitimes,
Ne sont que les écarts qui plaisent à ses yeux,
Les vices, les penchants qui la délectent mieux ;
Ce qu’elle grave en nous n’est jamais que sublime ;
En conseillant l’horreur, elle offre la victime
Frappons-la sans frémir, et ne craignons jamais
D’avoir, en lui cédant, commis quelques forfaits.
Examinons la foudre en ses mains sanguinaires
Elle éclate au hasard, et les fils, et les pères,
Les temples, les bordels, les dévots, les bandits,
Tout plaît à la nature : il lui faut des délits.
Nous la servons de même en commettant le crime
Plus notre main l’étend et plus elle l’estime. [6]
Usons des droits puissants qu’elle exerce sur nous
En nous livrant sans cesse aux plus monstrueux goûts. [7]
Aucun n’est défendu par ses lois homicides,
Et l’inceste, et le viol, le vol, les parricides,
Les plaisirs de Sodome et les jeux de Sapho,
Tout ce qui nuit à l’homme ou le plonge au tombeau,
N’est, soyons-en certains, qu’un moyen de lui plaire.
En renversant les dieux, dérobons leur tonnerre
Et détruisons avec ce foudre étincelant
Tout ce qui nous déplaît dans un monde effrayant.
N’épargnons rien surtout : que ses scélératesses
Servent d’exemple en tout à nos noires prouesses.
Il n’est rien de sacré : tout dans cet univers
Doit plier sous le joug de nos fougueux travers. [8]
Plus nous multiplierons, varierons l’infamie,
Mieux nous la sentirons dans notre âme affermie,
Doublant, encourageant nos cyniques essais,
Pas à pas chaque jour nous conduire aux forfaits.
Après les plus beaux ans si sa voix nous rappelle,
En nous moquant des dieux retournons auprès d’elle
Pour nous récompenser son creuset nous attend ;
Ce que prit son pouvoir, son besoin nous le rend.
Là tout se reproduit, là tout se régénère ;
Des grands et des petits la putain est la mère,
Et nous sommes toujours aussi chers à ses yeux,
Monstres et scélérats que bons et vertueux.
Donatien Alphonse François de Sade:
La Vérité. Poème inédit publié sur le manuscrit autographe par G. Lely.
Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1961.
Octavo. 203 × 149 mm. 30, [2 weiße] Seiten.
Handgefertigter Halbledereinband der Zeit mit Rücken und breiten Ecken aus schwarzbraunem Saffianleder, fünf erhabenen Bünden auf dem Rücken, auf zweitem Feld goldgeprägt der Titel, unten das Erscheinungsjahr, Deckel mit rot-schwarzem Marmorpapier bezogen, Kopfgoldschnitt, Vorsätze aus Ikarus-Marmor, Originalumschläge beigebunden.
Eins von nur 450 in der Presse numerierten Exemplaren auf „papier vergé de pur fil“, Gesamtauflage 500 Exemplare Die Gedicht fand sich unter den Aufzeichnungen La Mettries und ist hier nach der Handschrift des Verfassers von Gilbert Lely erstmals wiedergegeben.
¶ « En effet si ’la Vérité’ s’offre avant tout comme une satire anti-religieuse, plus d’un tiers de son contenu est une apologie du déchaînement intégral des instincts immoraux. Ajoutons que six notes sur huit (les deux autres concernent la religion) viennent renforcer cette apologie, et qu’une estampe liminaire projetée par l’auteur devait la revêtir d’un éclat suprême, sous les espèces conjuguées de meurtre et de la pédication hétérosexuelle. Mais le crime n’est pas seulement le plus puissant des aphrodisiaques: conforme aux intentions sacrées de la Nature, qui ne détruit pour transmuter et multiplier, il engendre une ivresse métaphysique. Tel, chez Sade, à l’idée de Dieu, s’oppose un panthéisme barbare » (Vorwort, pp. 9-10). Fast neuwertig. Erstdruck.
Reliure à dos à nerfs et coins de chagrin noir, tête dorée, couverture et dos conservés. Pièce trouvée dans les papiers de La Mettrie et publiée par Gilbert Lely sur le manuscrit autographe de l’auteur. Édition originale, tirée de 500 exemplaires, de ce poème qui « nous rend compte sous une forme lapidaire, souvent non dépourvue de lyrisme, des principaux aspects de la doctrine de Sade » (préface). Exemplaire numéroté sur papier vergé pur fil, bien relié.
— Manuscrit: 1787. Deutsch: Die Wahrheit. In: Ausgewählte Werke, Herausgegeben von Marion Luckow. I. Hamburg: Merlin, 1962. p. 435 sqq.
Donatien Alphonse François de Sade: Juliette
Je lève les yeux sur l’univers, je vois le mal, le désordre et le crime y régner partout en despotes. Je rabaisse mes regards sur l’être le plus intéressant de cet univers, je le vois également pétri de vices, de contradictions, d’infamies : quelles idées résultent de cet examen ? Que ce que nous appelons improprement le mal, ne l’est réellement point, et que ce mode est d’une telle nécessité aux vues de l’être qui nous a créée, qu’il cesserait d’être le maître de son propre ouvrage si le mal n’existait pas universellement sur la terre. Bien convaincu de ce système, je me dis : il existe un Dieu ; une main quelconque a nécessairement créé tout ce que je vois, mais elle ne l’a créé que pour le mal, elle ne se plaît que dans le mal, le mal est son essence, et tout celui qu’elle nous fait commettre est indispensable à ses plans : que lui importe que je souffre de ce mal, pourvu qu’il lui soit nécessaire ? Ne semble-t-il pas que je sois son enfant chéri ! Si les malheurs dont je suis accablé depuis le jour de ma naissance jusqu’à celui de ma mort prouvent son insouciance envers moi, je puis très bien me tromper sur ce que j’appelle mal. Ce que je caractérise ainsi, relativement à moi, est vraisemblablement un très grand bien relativement à l’être qui m’a mis au monde ; et si je reçois du mal des autres, je jouis du droit de le leur rendre, de la facilité même de leur en faire le premier : voilà dès lors le mal un bien pour moi, comme il l’est pour l’auteur de mes jours relativement à mon existence ; je suis heureux du mal que je fais aux autres, comme Dieu est heureux de celui qu’il me fait ; il n’y a plus erreur que dans l’idée attribuée au mot, mais, dans le fait, voilà et le mal nécessaire, et le mal un plaisir : pourquoi dès lors ne l’appellerais-je pas un bien !
N’en doutons pas, le mal, ou du moins ce que nous nommons ainsi, est absolument utile à l’organisation vicieuse de ce triste univers. Le Dieu qui l’a formé est un être vindicatif, très barbare, très méchant, très injuste, très cruel, et cela, parce que la vengeance, la barbarie, la méchanceté, l’iniquité, la scélératesse, sont des modes nécessaires aux ressorts de ce vaste ouvrage, et dont nous ne nous plaignons que quand ils nous nuisent : patients, le crime a tort ; agents, il a raison. Or, si le mal, ou du moins ce que nous nommons tel, est l’essence, et de Dieu qui a tout créé, et des individus formés à son image, comment ne pas être certain que les suites du mal doivent être éternelles ? C’est dans le mal qu’il a créé le monde ; c’est par le mal qu’il le soutient ; c’est par le mal qu’il le perpétue ; c’est imprégnée de mal que la créature doit exister ; c’est dans le sein du mal qu’elle retourne après son existence. L’âme de l’homme n’est que l’action du mal sur une matière déliée, et qui n’est susceptible d’être organisée que par lui : or, ce mode étant l’âme du Créateur comme il est celle de la créature, ainsi qu’il existait avant cette créature qui en est pétrie, il existera de même après elle. Tout doit être méchant, barbare, inhumain comme votre Dieu : voilà les vices que doit adopter celui qui veut lui plaire, sans néanmoins aucun espoir d’y réussir, car le mal qui nuit toujours, le mal qui est l’essence de Dieu, ne saurait être susceptible d’amour ni de reconnaissance. Si ce Dieu, centre du mal et de la férocité, tourmente et fait tourmenter l’homme par la nature et par d’autres hommes pendant tout le temps de son existence, comment douter qu’il n’agisse de même, et peut-être involontairement, sur ce souffle qui lui survit, et qui, comme je viens de vous le dire, n’est autre chose que le mal lui-même ? Mais comment, allez-vous m’objecter, le mal peut-il être tourmenté par le mal ? Parce qu’il s’augmente en retombant sur lui-même, et que la partie admise doit nécessairement être écrasée par la partie qui admet : cela par la raison qui soumet toujours la faiblesse à la force. Ce qui survit de l’être naturellement mauvais, et ce qui doit lui survivre, puisque c’est l’essence de sa constitution existante avant lui, et qui existera nécessairement après, en retombant dans le sein du mal, et n’ayant plus la force de se défendre, parce qu’il deviendra le plus faible, sera donc éternellement tourmenté par l’essence entière du mal, à laquelle il sera réuni ; et ce sont ces molécules malfaisantes qui, dans l’opération d’englober celles que ce que nous appelons la mort réunit à elle, composent ce que les poètes et les imaginations ardentes ont nommé démons. Aucun homme, comme vous le voyez, quelle que soit sa conduite en ce monde, ne peut échapper à ce sort affreux, parce qu’il faut que tout ce qui est émané du sein de la nature, c’est-à-dire du mal, y entre : telle est la loi de l’univers. Ainsi, les détestables éléments de l’homme mauvais s’absorbent dans le centre de la méchanceté, qui est Dieu, pour retourner animer encore d’autres êtres, qui naîtront d’autant plus corrompus, qu’ils seront le fruit de la corruption.
— La nouvelle Justine, ou Les malheurs de la vertu, suivie de l’histoire de Juliette, sa soeur. Tome sixième. En Hollande, 1797. pp. 341-345.
Ich erhebe meine Augen zum Universum und erblicke, daß das Böse, die Unordnung und das Verbrechen überall als Despoten herrschen. Richte ich meine Blicke auf das interessanteste Wesen dieses Universums, so sehe ich, daß es ebenfalls von Lastern, Widersprüchen und Schandtaten durchsetzt ist: Welche Ideen ergeben sich aus dieser Untersuchung? Daß das, was wir fälschlicherweise als das Böse bezeichnen, in Wirklichkeit nicht böse ist, und daß diese Art und Weise in den Augen des Wesens, das uns geschaffen hat, so notwendig ist, daß es aufhören würde, Herr über sein eigenes Werk zu sein, gäbe es das Böse nicht überall auf der Erde. Von diesem System überzeugt, sage ich mir: Es gibt einen Gott; irgendeine Hand hat notwendigerweise alles erschaffen, was ich sehe, aber sie hat es nur für das Böse geschaffen, sie gefällt sich nur im Bösen, das Böse ist ihr Wesen, und alles, was sie uns begehen läßt, ist für ihre Pläne unentbehrlich: Was kümmert es sie, ob ich unter diesem Bösen leide, so lange es für sie notwendig ist? Scheint es nicht, daß ich ihr geliebtes Kind bin! Wenn das Unglück, mit dem ich vom Tag meiner Geburt bis zum Tag meines Todes behaftet bin, ihre Rücksichtslosigkeit mir gegenüber beweist, kann ich mich sehr wohl darüber täuschen, was ich als Übel bezeichne. Was ich in Bezug auf mich selbst so bezeichne, ist wahrscheinlich ein sehr großes Gut in Bezug auf das Wesen, das mich in die Welt gesetzt hat; und wenn ich von anderen Böses empfange, habe ich das Recht, es ihnen zu vergelten, und es fällt mir sogar leicht, ihnen solches zu tun: Ich bin glücklich über das Böse, das ich anderen zufüge, so wie Gott glücklich über das Böse ist, das er mir zufügt; es gibt nur noch einen Irrtum in der Idee, die dem Wort zugeschrieben wird, aber das Böse ist in der Tat notwendig, und es ist eine Freude!
Zweifellos ist das Böse, oder zumindest das, was wir so nennen, absolut nützlich für die lasterhafte Organisation dieses traurigen Universums. Der Gott, der es geschaffen hat, ist ein rachsüchtiges, sehr barbarisches, sehr böses, sehr ungerechtes, sehr grausames Wesen, und zwar deshalb, weil Rache, Barbarei, Bosheit, Ungerechtigkeit, Schurkerei notwendige Modi für die Triebfedern dieses großen Werkes sind, über die wir uns nur beschweren, wenn sie uns schaden: Erleidende — das Verbrechen hat unrecht; Agierende — es hat recht. Wenn nun das Böse, oder zumindest das, was wir als solches bezeichnen, das Wesen sowohl Gottes, der alles geschaffen hat, als auch der Individuen ist, die nach seinem Bilde geformt wurden, wie kann man dann nicht sicher sein, daß die Folgen des Bösen ewig sein müssen? Im Bösen hat er die Welt erschaffen; durch das Böse erhält er sie; durch das Böse verewigt er sie; vom Bösen durchdrungen muß das Geschöpf existieren; nach seinem Dasein kehrt es in den Schoß des Bösen zurück. Die Seele des Menschen ist bloß die Wirkung des Bösen auf eine lockere Materie, die nur durch sie organisiert werden kann. Da diese Art und Weise die Seele des Schöpfers ist, wie sie die Seele des Geschöpfes ist, so wie sie vor dem Geschöpf existierte, das mit ihr durchtränkt wurde, so wird sie auch nach ihm existieren. Alles muß böse, barbarisch, unmenschlich sein wie euer Gott: Das sind die Laster, die derjenige annehmen muß, der ihm gefallen will, ohne jedoch irgendeine Hoffnung auf Erfolg zu besitzen, denn das Böse, das immer schadet, das Böse, das das Wesen Gottes ist, kann nicht der Liebe oder der Dankbarkeit zugänglich sein. Wenn dieser Gott, das Zentrum des Bösen und der Grausamkeit, den Menschen während der gesamten Zeit seiner Existenz quält, durch die Natur und andere Menschen quälen läßt, wie kann man dann zweifeln, daß er nicht in gleicher Weise und vielleicht unbeabsichtigt auf den Atem einwirkt, der ihn überlebt und der, wie ich Ihnen soeben gesagt habe, nichts anderes ist als das Böse selbst? Aber wie, werden Sie einwenden, kann das Böse vom Bösen gequält werden? Weil es sich vergrößert, indem es auf sich selbst zurückfällt, und weil der zugegebene Teil notwendigerweise von dem zugebenden Teil zerquetscht werden muß: dies aus der Vernunft, die der Stärke stets die Schwäche unterwirft. Was von dem von Natur aus bösen Wesen überlebt und was es überleben muß, da es das Wesen seiner Konstitution ist, das vor ihm existiert, und das notwendigerweise auch danach existieren wird, indem es in den Schoß des Bösen zurückfällt und nicht mehr die Kraft hat, sich zu verteidigen, weil es das schwächste Wesen wird, wird also ewig von dem gesamten Wesen des Bösen gequält werden, mit dem es vereint wird. Und es sind diese bösen Moleküle, die in dem Vorgang, jene zu umfassen, die das, was wir Tod nennen, mit sich vereinigt, das bilden, was die Dichter und die feurige Phantasie Dämonen genannt haben. Wie Sie sehen, kann kein Mensch, egal wie er sich in dieser Welt verhält, diesem schrecklichen Schicksal entgehen, weil alles, was aus dem Schoß der Natur, das bedeutet des Bösen, hervorgeht, in ihn eindringen muß: Das ist das Gesetz des Universums. So gehen die abscheulichen Elemente des bösen Menschen im Zentrum der Bosheit, das Gott ist, auf, um wieder andere Wesen zu beleben, die umso verdorbener geboren werden, je mehr sie die Frucht der Verdorbenheit sind.
— Eine andere Übersetzung: Donatien Alphonse François de Sade: Ausgewählte Werke. Herausgegeben von Marion Luckow. III. Hamburg: Merlin, 1965. p. 584 sqq.